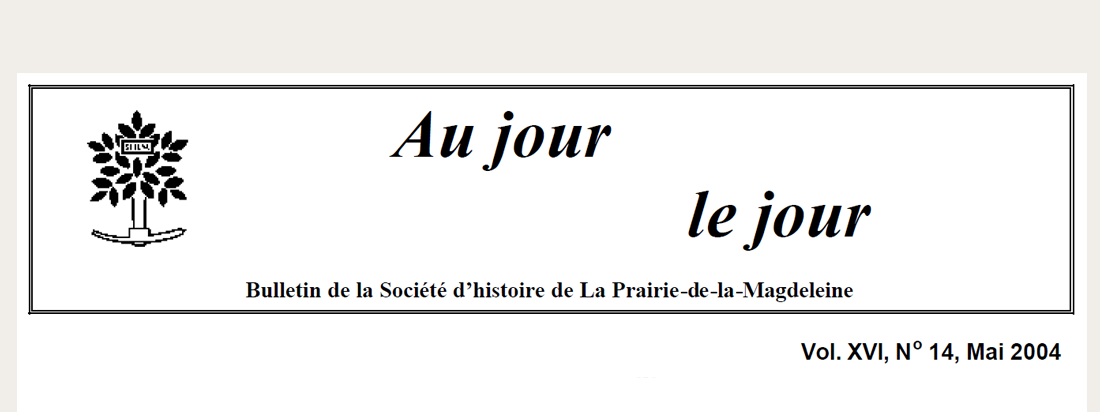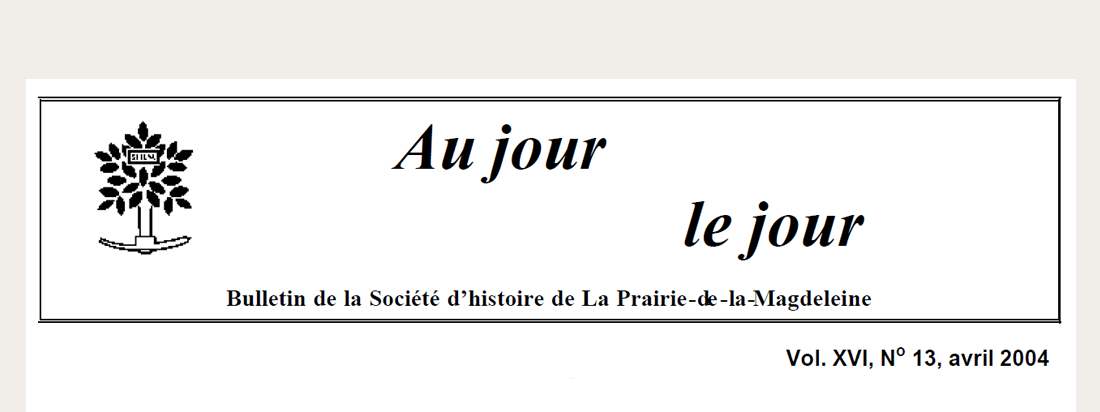Au jour le jour, octobre 2004

Nous vous présentons ici quelques textes un peu disparates, mais qui ont pour mérite de nous révéler les premières allusions à La Prairie, faites par certains personnages historiques. Ces textes furent colligés par le Frère Damase Rochette.
En 1535, lors de son deuxième voyage au Canada, Jacques Cartier visita la puissante bourgade d’Hochelaga (Montréal). Le Père Charlevoix, jésuite, lui met dans la bouche ces paroles, alors qu’il était au sommet du Mont-Royal et qu’il regardait du côté du Fleuve Saint-Laurent, donc dans la direction de La Prairie : « Il en est peu au monde de plus beau et de meilleur ». (Mémoires du Père Charlevoix)

Nous avons aussi le témoignage de Samuel de Champlain qui, le 7 juin 1611, remonta la rivière Saint-Jacques – limite actuelle entre la ville de La Prairie et celle de Brossard – jusqu’au bassin de Chambly : « Elle est fort plaisante, y ayant plus de trois lieues de circuit de prairies et force terres qui se peuvent labourer ». (Les Communes, par Élisée Choquet ptre, p. 76)

Dans les Annales de l’Hôtel-Dieu de Montréal, Jeanne Mance raconte que Sœur Morin, arrivée à Ville-Marie le 17 mai 1642, relate ceci : « Le long de la grève, plus d’une demi-lieue de chemin ci-devant, on ne voyait que prairies émaillées de fleurs, de toutes couleurs, qui faisaient une beauté charmante ». (p. 76)
L’établissement de La Prairie de La Magdeleine fait partie de la Seigneurie donnée aux Révérends Pères Jésuites, le 1er avril 1647, par Monsieur de Lauzon, alors gouverneur de la colonie. (Joseph Chevalier, Notes historiques, p. 19) Mais s’il faut en croire le « Journal des Jésuites », octobre-novembre 1667, ce n’est que le 4 octobre que les Révérends Pères Jésuites en furent notifiés par l’Intendant. On lit ceci :
… Le 4 octobre, M. l’Intendant nous répond favorablement à la requête présentée pour aller établir une colonie en La Prairie de La Magdeleine. Le 5, le Père Raffeix s’embarque pour aller hiverner aux îles Percées et reconnaître en toutes les saisons les La Prairie de La Magdeleine. Caron, quatrième, monte avec luy pour en prendre connaissance. Le 14, Jean François Élie sort de la compagnie avec la permission; il s’embarque en habit séculier sous le nom de Hennevouy, conduit par deux de nos frères après avoir changé d’habit à la hâte et tout secrètement.
… Le 22, Caron retourne de là hault avec beaucoup d’estime de la terre qu’il a visitée où il a trouvé tout ce que l’on peut souhaiter dans la fin qu’on le propose en cette habitation, à la réserve de l’abord qui est difficile surtout les moys de septembre et d’octobre. (Journal des Jésuites, J 58 Jo 971 – 023, consulté à la Bibliothèque municipale de Montréal.)

Quelqu’un a dit un jour que « l’histoire c’est la répétition des faits ». On ne saurait donner tort à cette affirmation lorsqu’on observe ce qui se passe dans le dossier des fouilles archéologiques dans le Vieux La Prairie; sauvetage, incertitudes et absence de plan de fouilles à long terme.
Pendant un mois (de la mi-août à la mi-septembre) l’archéologue François Grondin et deux techniciens ont procédé à des fouilles sur l’ancien site Oligny rue du Boulevard. Il s’agissait en fait de la dernière phase d’une opération de sauvetage et de supervision sur un site déjà envahi par des condominiums.

L’objectif avoué de toute l’opération était de comprendre l’organisation globale du site. Outre la découverte de plusieurs latrines datant de la fin du 18e siècle et la mise à jour d’artefacts amérindiens : pipes micmacs, perles et clôture de bois (on pense ici à la mission St-François-Xavier dont on ignore toujours l’emplacement), l’élément le plus intéressant de cette opération fut la mise à jour, en plein centre du terrain, d’une structure de pierre rectangulaire de 11,5 m par 7 m avec mur de refend et foyer central.
Cette structure est légèrement désaxée par rapport à la rue actuelle et aurait été, lors de sa construction, alignée sur l’ancien Chemin de Saint-Jean.
M. Grondin croit avoir découvert là la fameuse maison fortifiée. Cet édifice au toit à quatre versants a été incendié en 1901; selon le Dr T.A. Brisson, alors maire de La Prairie, une partie de la pierre des murs aurait été utilisée dans les fondations de la maison Bouthillier, angle Ste-Marie et du Boulevard.
On a également identifié plus à l’ouest les bases d’un autre édifice qui correspondrait à celui représenté sur un croquis (1815) de Louis-René Chaussegros de Léry, grand voyer dans le district de Montréal depuis 1806. L’archéologue Grondin croit être en présence du fameux blockhaus, solide construction de pierre à deux étages avec balcon et quatre cheminées qui aurait été utilisé par les Américains lors de l’invasion de 1775. Cette structure est sur l’ancienne terre de Soumande (lot 301) ou de Gagné sur la Côte de la Borgnesse. Malheureusement les chaînes de titres sont incomplètes et demeurent muettes quant à la présence d’un édifice aussi imposant sur ce lot.
Bref, l’incertitude demeure au sujet de l’emplacement exact de la maison fortifiée et du blockhaus.
Ces fouilles ont également permis d’exhumer une multitude de graines d’arbres fruitiers, d’ossements d’animaux et d’insectes. L’étude ultérieure de ces éléments permettra d’en savoir davantage sur la composition de la faune, de la flore et du régime alimentaire des habitants de La Prairie aux 18e et 19e siècles. Qu’en saurons-nous un jour? C’est un dossier à suivre…
Gaétan Bourdages
Avec la collaboration de Marcel Lamarche

Un vieux contrat de mariage
Je veux vous faire lire aujourd’hui un ancien contrat de mariage. J’ai choisi l’ancêtre TREMBLAY parce que je crois qu’il a la descendance la plus nombreuse en Amérique et surtout au Saguenay. Avant de vous faire lire ce document, je voudrais vous rapporter un fait qui intéressera beaucoup de lecteurs.
Il y a plusieurs années, alors que l’Exposition 67 était en marche à Montréal, un groupe nombreux de Français, surtout des Normands, vinrent visiter la métropole. Ils décidèrent de se rendre à Québec et furent reçus au Musée provincial par le Ministre des Affaires Culturelles. Beaucoup de personnes de la ville furent invitées pour la circonstance et j’étais du nombre. Mgr Victor Tremblay de Chicoutimi avait été invité comme président d’honneur. Voici des paroles qu’il prononça qui furent chaudement applaudies : En 1760, lorsque la France perdit le Canada, 70 000 Français demeurèrent dans notre province de Québec. Dans la suite, on les appela la nation canadienne-française. Or, depuis des années, j’ai relevé 72 000 noms de familles Tremblay. Je crois que je ne fais pas erreur en les appelant la nation des Tremblay. Des applaudissements chaleureux surgirent dans la salle.
* * *
Par devant Claude Auber Notaire et greffier en La Coste et Seigneurye de beaupré et tesmoingts soubnés (soussignés) furent presents en leur personne pierre Le Trenblé habitant en ce pays fils et héritier de philibert trenblé et Jeanne Coingnet ses pere et mere de la Paroisse de Randonnè au perche évesché de chartre dune part et Osanne Achonne (Achon) fille de Jean Achonne et de helayne Regnaude de la Paroisse de pierreavant évesché de La Rochelle en aulnix (Aunis) dautre Lesquelles partyeassistée de leurs parents et amis à sçavoir le dict trenblé du Sieur Martin grouvel habitant de la Coste et Seigneurye de beaupré Héloy Tavernier et Marguerite Gasgnon sa femme Mascé Gravelle Mathurin Jean et Pierre dict Gasgnon habitants de la Coste et Seigneurye de beaupré Marie Tavernier veufve de feu Gille Bacon vivant habitant de quebec dune part et la dicte Achonne assistée comme dit est de parents et amis à sçavoir Me pierre Masse et Marie Pivert sa femmeLe Sieur Mathurin Giraud Le Sieur Jean Rivereau et le Sieur Mathurin Morier Marchands demeurant pour le present en la basse ville de quebec et Léonard Pillot estant de present audict quebec dautre Lesquelles partyes a lautorisation de leur susd. (susdits) parents et amis se sont et par ces presentes se promettent prendre Lun Lautre par foy et loy de Mariage qui au plaisir de dieu sera ft (fait) et accomply en face de Nostre Mere La Ste esglise catholique apostolique et Romaine Le plustot que faire ce pourra et ainsy quil sera delibere entre leur susd. Parents et amis sy Ladicte Ste eglise y Consent et accorde et seront les futurs espoux en communs biens suiv. (suivant) La Coustume de La prevosté et viconté de paris a quoy ce pays ycy est regy et Ne seront tenus lesd. futurs epoux des debtes Lun de Lautre crée avant le Mariage et a Ledict futur espoux doué sadicte future espouse outre son douaire coustumier de la Somme de cent Livres ts lequel douaire se prendra aur le plus beau et plus clair bien d’entre les partyes et advenant dissolution de Mariage entre lesd. partye estant des le present en communauté de biens conquests et acquests immeubles Sera permis a lad. Future espouse de renoncer ou acopter ladicte communauté et en cas de renonciation elle reprendra franchement et quittement tout ce quelle aura apporté audict Mariage et tout ce qui luy sera advenu et escheu par succession donation ou autre et sans ces clauses et conditions porté par iceluy contract ledict mariage nauroict esté ft (fait) et accomply Ce fut ft et passé a quebec le Mercredy dix-neufe de Septembre M Vie cinquante sept (1657) en presence de Sr Jacques Mascé Marchand et Charles le françoys tesmoingts qui ont avec lesd. Sieur giraud Morier, pillot Marie Tavernier avec Moy Notaire susd. et soubné (soussigné) a la presente minute et ont lesd. Sieur grouvel gravelle et les susd. partye dict et déclaré ne sçavoir escrire ni signer et aues (Autres) de ce interpellez suiv. lordonnance.
Pierre Masse, J. Massé, Charles Lefrançois, Mai Tavernier, Morier, Mathurin Girau, L. P. Léonar Pillo, Marque dud. Futur espoux, Marque de Lad. Future espouse, Marque du Sieur Grouvel, Marque du Sieur Rivereau.
Auber Not.
Texte tiré de « Sainte-Anne-de-Beaupré », septembre 1971, et présenté par monsieur Yvon Trudeau.

Le 15 septembre dernier avait lieu la première conférence de l’année organisée par la SHLM. C’est madame Marie Gagné qui, devant une nombreuse assemblée, est venue nous entretenir de Pierre Gagnier, un des premiers colons de La Prairie.
Avec un souci du détail où on reconnaissait la formation scientifique, madame Gagné nous a d’abord donné des notes généalogiques et historiques sur les origines de son ancêtre. Ensuite, elle nous a expliqué où et comment Pierre Gagnier s’est installé à La Prairie en portant une attention particulière au terrain qu’il possédait au village, à l’angle des rues Saint-Ignace et Saint-François-Xavier (aujourd’hui chemin de Saint-Jean). Suivit une explication complète de la chaîne de titres de ce terrain. En guise de conclusion, madame Gagné nous a présenté les membres de cette famille pionnière en enjolivant son propos de liens avec certains personnages célèbres de notre histoire.
Merci, madame Gagné


Vente de livres usagés
Cette année, notre vente annuelle aura lieu le samedi, 16 octobre 2004, de 8h30 à 17h00.
Voici quelques catégories de livres à vendre :
archéologie, architecture, art (art roman, encyclopédie), biographies, dictionnaire biographique, familles (histoire), généalogie (répertoires), greffes de notaires (inventaire), histoire (Canada, Nouvelle -France, Québec, universelle), magazines (RHAF, Mémoires de la SGCF, Cap-aux-Diamants) romans, villes (histoire), etc.
Plusieurs aubaines sont à votre portée, surtout pour les « lève-tôt ».
Les recettes de cette vente sont consacrées exclusivement à l’achat de nouveaux livres pour notre bibliothèque. Donc, vos achats contribueront à l’enrichissement de votre bibliothèque.
Rappel
L’hiver dernier, une réglementation de base a été mise de l’avant et publicisée au niveau de la bibliothèque. Nous estimons que la période de rodage est terminée et nous vous demandons de respecter cette réglementation en ce début d’année. Ne soyez pas surpris si on doit vous rappeler à l’ordre.
Cette réglementation est affichée sur la porte d’entrée de la bibliothèque.
Merci de votre collaboration.
Acquisitions
– Lettres des nouvelles missions du Canada, 1843-1852; avec commentaires et annotations; par Cadieux, Lorenzo (don de Mme Louise Archambault)
– Joseph Laurent Pinsonneault; Collectif 1993; (donateur inconnu)
– Glossaire du parler français au Canada; Collectif; (don de M. Philippe Bourdeau)
– Duplessis, L’ascension, tome 1; Le pouvoir, tome 2; par Black, Conrad (don de monsieur Philippe Bourdeau)
– Invasion du Canada, À l’assaut du Québec, tome 2, 1813-1814, par Berton, Pierre (don de monsieur Philippe Bourdeau)
– Chronologie du Québec, 1534-200; par Provencher, Jean, 2000 (achat SHLM)
– Identifier la céramique et le verre ancien au Québec; par Brassard, Michel; 2001; (achat SHLM)
– Champlain, La naissance de l’Amérique française; par Vaugeois, Denis, Litalien, Raymonde et collaborateurs; 2004; (achat SHLM)
– Histoire de la Banque de Montréal; collectif; traduction de l’anglais; 2 tomes; (don de madame Linda Crevier)
– Beaujeu; Histoire de Lacolle; par Romme Jules, o. prém. ; 1993 (Don de la Société
d’Histoire Lacolle -Beaujeu)
Dons
Un grand merci aux donateurs dont les noms suivent :
– Madame Louise Archambault
– Monsieur Philippe Bourdeau
– Madame Linda Crevier

Jules Verne, qui se plaisait surtout à produire des œuvres d’anticipation, a écrit un roman historique sur les troubles de 1837-1838 au Canada et un long chapitre de cette histoire se déroule dans la région de La Prairie.
Sur un fond de vérité historique, Jules Verne a imaginé l’histoire d’une famille qui tente, par des actions patriotiques, de redresser les torts qu’a entraînés la traîtrise de leur père. Ce roman s’intitule « Famille-Sans-Nom ».
Parmi les lectures que l’on suggère dans nos écoles, ce roman de Jules Verne devrait se retrouver parmi les incontournables.

Chers membres,
Encore une fois, le brunch annuel de la SHLM s’est avéré un franc succès avec une salle pleine à craquer émaillée de plusieurs personnalités qui nous ont honorés de leur présence. Cette nouvelle performance témoigne de la bonne santé de notre Société comme en font foi aussi les nombreuses réalisations de nos bénévoles dont certaines trouvent régulièrement leur écho dans la revue Au jour le jour et d’autres, plus discrètes, qui n’en sont pas moins nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble.
C’est cette synergie qui nous vaut des jugements aussi favorables que celui que nous faisait parvenir, il y a quelques semaines, madame Jocelyne Landry-Guay et que je vous cite ici en guise de félicitations :
« Étant membre du Conseil d’administration de la Société d’Histoire de Lacolle-Beaujeu, j’ai eu le privilège, le premier septembre dernier, de visiter les locaux si bien aménagés de votre Société. Il est facile et agréable d’effectuer des recherches chez vous. C’est un modèle pour les autres organismes. »
René Jolicoeur, président

Prochaine conférence
Légendes de la Nouvelle-France
par monsieur Robert Payant
le 20 octobre, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :
– madame Julienne Bouchard (497)
Nous rappelons à nos membres que, l’été terminé, les heures d’ouverture des locaux de la Société sont revenues à l’horaire régulier, c’est-à-dire de 8h30 à 16h30, et ce du mardi au jeudi inclusivement. Toutefois, il y a portes ouvertes pour les amateurs de généalogie le lundi soir, de 19h30 à 21h30 (Ce ne sont pas des cours de généalogie).
Brunch d’ouverture, version 2004
Comme l’a si bien mentionné monsieur René Jolicoeur dans son « Mot du président », le brunch qui s’est tenu au restaurant « Le Vieux Fort », le 19 septembre dernier, a été une réussite. Le mot d’ouverture de notre ineffable président a été suivi des allocutions aussi sympathiques qu’encourageantes de monsieur Guy Dupré, maire de La Prairie, et de monsieur Jean Dubuc, notre député provincial.
Ensuite, madame Patricia Fontaine, avec sa verve habituelle, nous a fait part des grands services qu’a rendus à la Société celle qui, pour l’ensemble de son œuvre à titre de bénévole, méritait d’être honorée ce jour- là, madame Lucille Demers-Lamarre (ci-contre). Enfin, il ne faut pas oublier qu’avant, pendant et après un excellent repas, ont lieu des rencontres et des échanges historico-généalogiques qui, pour moi qui ne suis qu’un néophyte, ne cessent de surprendre tant par leur cordialité que par leur érudition.


Dans notre dernier numéro, nous avons attribué à mesdames Marcoux Chopin et Riendeau Houle le grade de « Maître généalogiste agréé » alors qu’on leur avait décerné le titre de « Généalogiste recherchiste agréé ». Toutefois, nous pensons n’avoir fait preuve que d’anticipation, mais nous nous en excusons, le grand talent de ces dames ayant sûrement été la cause de notre méprise.
NDLR

Je ne connais pas encore les statistiques exactes, mais il semblerait que le nombre de visiteurs accueillis par la Société cette année a dépassé celui de l’an passé d’une bonne centaine… par mois!
L’excellent travail de nos jeunes guides y est sûrement pour beaucoup. Cependant la merveilleuse exposition « Splendeur de la table » qui vient de se terminer a indubitablement constitué une attraction de choix.
En effet, de nombreuses personnes, venues seules ou en groupes, revenaient avec des amis pour admirer ces merveilles d’un autre âge ou y associer des souvenirs de leur enfance.
Félicitations aux organisateurs et merci à ceux qui ont bien voulu prêter leurs trésors.

Participez à votre revue Au jour le jour
Envoyez-nous vos articles!

Éditeur :
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Internet : www.laprairie-shlm.com
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
Collaborateurs :
Coordination : Jacques Brunette
Rédaction : Raymond et Lucette Monette (284); Gaétan Bourdages; Jacques Brunette (280); Yvon Trudeau
Révision : Jacques Brunette (280)
Infographie : SHLM
Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.
Siège social :
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Tél. : 450-659-1393
Téléc. : 450-659-1393
Courriel : [email protected]
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.
Au jour le jour, septembre 2004

Un extrait du livre « LA VIE QUOTIDIENNE EN NOUVELLE FRANCE Le Canada, de Champlain à Montcalm » de Raymond Douville et Jacques-Donat Casanova. HACHETTE 1964, pages 152-154.
Le diocèse du Canada est immense, et les communications sont rendues encore plus difficiles et souvent impossibles par un long et rigoureux hiver. C’est une vie rude pour l’évêque. Son existence s’apparente davantage à celle d’un missionnaire qu’à celle d’un prélat.
De Montréal à Tadoussac, la distance est de cinq cents kilomètres. Le prélat utilise le canot en été, la raquette et le traîneau en hiver. Mgr de Laval parcourt deux fois d’un bout à l’autre l’immense territoire habité de son diocèse : en 1669 et en 1681. En cette dernière année, il a près de soixante ans. Il entreprend quand même cette randonnée pastorale et paraît inlassable, traversant plusieurs fois le fleuve pour visiter les seigneuries des deux rives. Il s’attache, particulièrement aux missions des indiens, et ces derniers lui réservent une réception qui réconforte l’éminent prélat. Le 20 mai, il se rend à la mission de la Prairie de la Madeleine, près de Montréal, où l’on a tracé une allée depuis le fleuve jusqu’à la chapelle, et préparé une petite estrade près du lieu d’arrivée.
Quand le canot du prélat est en vue, la cloche de l’église commence à tinter, appelant tous les membres de la mission. Un des capitaines hurons apostrophe respectueusement l’évêque au moment où il doit mettre pied à terre : « Évêque, arrête ton canot et écoute ce que j’ai à te dire! » Suivent des harangues de bienvenue. Le visage rayonnant de bienveillance, Mgr de Laval débarque et, revêtu du camail et du rochet, il bénit les fidèles agenouillés. L’aumônier de la mission, le père Frémin, entonne le Veni Creator en langue iroquoise, « secondé par tous les sauvages, hommes et femmes, selon leur coutume ».
Et tous, en procession, entourant l’évêque, qu’accompagnent M. de Bouy, son prêtre, et M. Souart, supérieur du séminaire de Saint-Sulpice à Montréal, se dirigent en chantant vers le premier arc de feuillage dressé par les Indiens.
Monseigneur s’arrête au-dessus pour écouter l’allocution d’un Indien nommé Paul, le « savant dogique » de la mission. Il entre ensuite dans l’église où le père Cholénec, en surplis, lui présente l’eau bénite; Mgr de Laval donne alors la bénédiction du Saint-Sacrement tandis que l’assistance, Indiens et Français, entonne en deux « chœurs bilingues » le Pange lingua, l’Ave Maris stella et le Domine salvum fac regem. Après la cérémonie, Monseigneur présente son anneau à baiser aux assistants, « leur faisant mille caresses », surtout à ceux qui sont les plus fervents.
Le lendemain, l’évêque baptise dix adultes, bénit trois mariages, après quoi il dit la messe. Les Indiens chantent pendant le saint office et communient de la main du prélat. À la fin de l’office, l’évêque procède à la cérémonie de confirmation. Il accepte que des Français soient confirmés, mais après les sauvages, « pour lesquels seuls, dit-il, je suis venu ».
À midi, grand repas selon l’habitude des sauvages qui ont déployé leurs plus belles couvertures pour l’évêque et ses adjoints. Et nouvelles harangues.
Monseigneur veut alors visiter les familles, ce qui rend les Indiens très fiers. Ils ornent leurs cabanes de ce qu’ils ont de plus précieux, étendent par terre des couvertures, des peaux ou des branchages. Mgr de Laval pénètre dans chaque foyer, a des paroles bienveillantes pour tous. Le soir l’évêque confère le baptême à sept enfants, assiste au salut. Le lendemain, la messe chantée par les Indiens termine la visite pastorale du prélat. Et sur le bord du fleuve, tous les assistants reçoivent la bénédiction de l’évêque du Canada.
Le bilan de l’œuvre de Mgr. de Laval est éloquent : érection de trente-trois paroisses, établissement de l’administration diocésaine, fondation de nombreuses confréries pieuses, présidence de centaines de cérémonies religieuses dont cent vingt-six de confirmation.

Les contestations au sujet de la construction des routes ne datent pas d’aujourd’hui. Voici un exemple : dans une lettre du Dr. Thomas Auguste Brisson datée du 22 juillet 1916 adressée à Mr. J. Lévesque, assistant ingénieur du District de Montréal au Ministère des Travaux Publics du Canada, il écrit ceci :
« Voici mes notes sur l’histoire du "Chemin de Saint-Lambert" et de son statut vis-à-vis de la loi municipale et des propriétés. Jusqu’au 21 juin 1886, ce chemin était en vertu d’un procès-verbal sous la juridiction de la municipalité de la Paroisse de La Prairie pour laquelle, aussi bien que pour le public est un sujet de disgrâce. Par un statut de Québec les limites du Village de La Prairie furent étendues dans une direction nord-est jusqu’à la rivière Saint-Jacques, de façon que la responsabilité du chemin passe à la Municipalité du village de La Prairie. Une section du même acte dit expressément que la dite corporation aura le droit d’exécuter dans les limites du village, les travaux de terrassement et autres jugés convenables contre les inondations du fleuve St-Laurent et voilà pourquoi elle n’a cessé depuis lors d’en exécuter ou d’en faire exécuter par qui de droit ces travaux.
Durant quinze années, la corporation du Village de La Prairie se chargera du "Chemin de Saint- Lambert" au prix de troubles et d’avanies sans nombre. Comme les eaux du fleuve le recouvraient deux fois l’an régulièrement à la prise et au départ des glaces, l’ouvrage était toujours à recommencer. Il devient donc nécessaire d’adopter des mesures énergiques, d’autant plus que le pont Victoria ayant été livré à la circulation des voitures en 1900, la servitude de ce chemin fut au moins décuplée. C’est afin de répondre à ces nécessités nouvelles que l’expropriation mentionnée au document ci-joint fut entreprise par le conseil à sa séance du 5 mars 1900. Le 20 décembre, la corporation ayant obtenu la somme de mille piastres comme assistance de la part du gouvernement de la province, prit possession du terrain tel qu’exproprié, redressa le chemin, le nivela et en éleva le lit de deux trois pieds en moyenne. Tous ces travaux, bien insuffisants, il est vrai, furent faits sous contrôle et le coût fixé directement par elle.
Ce n’est qu’au cours de l’année 1909 et après les efforts suscités par la terrible inondation de 1904, que le gouvernement du Canada entre en scène. (photo d’inondation)?
À la suite d’une requête datée du 8 septembre 1909 et présentée le même jour au Premier Ministre et au ministre des Travaux Publics par une délégation très importante du district intéressé, un rapport spécial fut demandé à l’ingénieur J.L. Michaud, qui le présente le 27 octobre 1904. Ce rapport contient une admission formelle de responsabilité des dommages causés en amont du pont Victoria, par les travaux exécutés dans le lit du fleuve sous la direction de la Commission du Havre avec l’approbation du gouvernement fédéral depuis de nombreuses années. Ce dernier prit action immédiatement en faisant insérer dans la loi du budget un premier crédit de onze mille piastres pour commencer la construction de la digue actuelle sur la base même du chemin de Saint-Lambert et dont le sommet ou couronnement devait servir à la circulation du public à la place du vieux chemin d’antan. »
N’avez-vous pas l’impression de lire les mêmes tergiversations au sujet de l’autoroute 30? L’histoire est un éternel recommencement

L’une de mes arrières arrière-grand-mères s’appelait Scholastique Bencette. Baptisée à LaPrairie, elle était la fille de Pierre Bencette et de Catherine Brossard. Le lundi 18 février 1833, Scholastique Bencette épouse à LaPrairie François Lériger de Laplante; les deux demeurent alors à la « Côte Sainte-Catherine ». Après quelques années passées à Mercier, ils vont s’établir dans le Rang du six à Saint-Louis-de-Gonzague. C’est sur une terre de 200 arpents, l’endroit où je suis né. Leur fille, qui se nomme aussi Scholastique, épousera Jean-Baptiste Myre, mon arrière-grand-père.
La présente chronique a pour but de présenter les origines des Bencette et de raconter, pour fins de la petite histoire de LaPrairie, des égarements que certains d’entre eux ont vécus il y a deux siècles.
L’ancêtre, Jean-Baptiste Bencette dit Jolibois, naît en 1740, fils de Jean-Baptiste Bencette et de Marie-Marguerite Fortier. Il est originaire de la paroisse Saint-Pierre de l’évêché de Koblenz (Coblence). Cette ville faisait partie de la principauté libre de Nassau en Allemagne. On ne sait pas la date, ni les circonstances de sa venue au Canada. Il se peut qu’il ait été recruté avec d’autres français de l’endroit, pour venir défendre la colonie, peu avant la conquête de 1760.
Jean-Baptiste Bencette s’installe à LaPrairie. Le 3 octobre 1767, il contracte mariage avec Marie-Louise Bourdeau, qui n’a que 15 ans. Deux jours plus tard, le mariage est célébré à l’église de LaPrairie de La Magdeleine. Les nouveaux mariés avaient eu l’occasion de fréquenter l’école, car ils ont une belle signature. Le mari signe Jean Baptiste Peincette, et l’épouse, Marie Louise Bourdaux.
Ils auront six enfants dont au moins trois laisseront une descendance : Jean-Baptiste, Pierre et Marie-Louise. Ce Pierre Bencette est le père de Scholastique qui s’établira à Saint-Louis-de-Gonzague avec son mari François Lériger de Laplante. Marie -Louise épousera Gabriel Gagnier à LaPrairie le 14 octobre 1799. Quant à Jean-Baptiste fils, avec lui commence une petite histoire qui animera un peu LaPrairie.
Le tout débute par un certain Julien Thierry de Montréal, qui a une aventure avec une sauvagesse, dont le nom demeurera inconnu. De lui, cette amérindienne donne naissance à une fille, que l’on baptise Marie-Anne. D’après un acte de baptême du 3 septembre 1776 à
Montréal, elle aurait été baptisée à l’âge d’environ deux ans et demi, et sous condition, étant gravement malade.
Sans savoir les circonstances, on retrouve Marie-Anne à LaPrairie. Elle pourrait avoir été prise en charge par les sœurs de la Congrégation Notre-Dame, déjà installées à cet endroit. Marie-Anne est une petite fille très douée, car elle apprend à lire et à écrire, ce qui n’est pas très courant à l’époque.
Jean-Baptiste Bencette fils est voyageur de métier. Lors d’un séjour à LaPrairie, il fait la connaissance de Marie-Louise Thierry, qui devient enceinte de lui. Puis, sans contrat au préalable, le mariage a lieu à LaPrairie le 16 février 1695. Le curé ne peut éviter de rappeler par écrit les origines de la mariée du jour :
« L’an mil Sept cent quatre-vingt-quinze le Seize février Nous Pretre Soussigné après la publication de bans de mariage aux prones de cette paroisse par trois dimanches consécurifs entre Jean Baptiste Bencette dit Jolibois fils de Jean Baptiste Bencet dit Jolibois et de Marie Louise Bourdeau ses pere et mere de cette paroisse d’une part, et Marie-Anne Thierry fille naturelle de Julien Thierry de Montréal et d’une sauvagesse anonyme de cette paroisse d’autre part, ne s’étant trouvé aucun empêchement leur avons donné la bénédiction nuptiale après avoir reçu leur mutuel consentement presence de jean Baptiste Bincet pere, Louis Roussin, Alexis Portelance, Henry André, Pierre Guerin, Jacques Hubert Lacroix, François Dupuy, Pierre Cardinal & plusieurs autres ».
Au bas de l’acte de mariage, Marie-Anne Thierry est fière d’apposer son élégante signature avec celle de son mari. On remarque que le mariage est célébré en la présence de nombreux invités. Le premier enfant est baptisé Joseph le 2 septembre de la même année. Elle aura en tout huit enfants. Mais, ce Joseph Bencette, l’aîné, fera scandale à LaPrairie.
Comme son père, Joseph Bencette devient voyageur, probablement aux Grands Lacs. De retour à LaPrairie, il courtise Florence Payant, une fille de 19 ans de la paroisse, qui devient enceinte. Mais, le père refuse de reconnaître sa paternité. L’enfant est baptisé à LaPrairie et l’acte est rédigé selon les règles de l’époque.
« L’an mil huit cent vingt-neuf le vingt-cinq Mars par Nous prêtre soussigné a été baptisée sous condition Marie Adéline née d’avant-Hier sur cette paroisse de parens inconnus le parrain a été Stephen May et la Marraine Catherine Lériger de Laplante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis lecture faite. J. B. Boucher ptre ».
Il est d’usage d’inscrire « de parents inconnus », même si l’on connaissait, évidemment le nom de la mère. La petite Adéline n’est pas assurée de survivre; elle est baptisée sous condition, comme sa mère l’avait été. Quelques mois plus tard, peut-être sous les incitations du curé ou de certains paroissiens, Joseph Bencette se ravise et accepte d’épouser Florence Payant. Ils s’adressent au curé Boucher pour planifier leurs épousailles. Après avoir obtenu la dispense de deux bans, le curé annonce en chaire la promesse de mariage, le dimanche 27 septembre 1829. Comme il est de rigueur, il déclare aux fidèles : « Si vous connaissez des empêchements à ce mariage, prière de nous en faire part ».
La conduite des futurs mariés provoque une opposition au mariage de la part d’un paroissien. Le curé croit bon de référer le cas à son évêque, surtout qu’il a appris que les deux candidats au mariage demeurent déjà ensemble. Voici la réponse que lui transmet Mgr Jean-Jacques Lartigue, le premier évêque de Montréal et portant le titre d’Évêque de Telmesse : « Montréal, Le 17 octobre 1829, Mr. – après avoir vu l’opposition qui vous a été signifiée, je juge que vous pouvez passer outre, sans y avoir égard, parce qu’elle n’a été faite ni par la fille, ni par les pere, mere, ou tuteur, qui sont les seuls qui auront eu droit de s’opposer si elle était mineure. Vous pourrez procéder au mariage en question dès lundi prochain avec seulement 2 témoins; & que d’ici à ce temps-là on ne connaît aucun soupçon, le mariage aura lieu. Afin d’éviter quelque nouvelle esclandre ou opposition, les conditions étant que les parties se séparent immédiatement, de manière à ne point coucher ni manger dans la même maison; qu’elles se préparent par la confession; que toutes 2 vous prient, en présence de 2 témoins, de demander pour eux au prône pardon du scandale qu’elles ont donné. Vous leur direz devant les deux témoins, la formule suivante que vous direz en conséquence à votre Prône de dimanche prochain, sans faire mention de leur futur mariage "J. Bincet & Florence Payant, de cette paroisse ont donné publiquement scandale par leur mauvaise conduite, m’ont chargé de déclarer ici de leur part que par ordre de Mgr l’Év. De Telmesse et en même temps de leur bonne volonté, ils ont sincère regret et demandent pardon à Ste. Mère l’Église du scandale qu’ils ont occasionné par leur faute; et qu’ils ont résolu d’en faire pénitence". Si les parties se refusaient à ces conditions, vous refuserez de les marier. Je suis un véritablement, J. J. Év. De Telmesse ». (Archives nationales du Québec à Montréal)
C’est tout un acte de repentir que l’évêque demande à Florence Payant et à Joseph Bencette. Mais, après réflexion, ils décident d’accepter les conditions qu’on leur impose. À la messe du dimanche 1er novembre, le curé Boucher prononce textuellement la formule commandée par son évêque, à qui il a juré obéissance. Puis, dans un registre, il écrit cette note : « L’annonce cidessus a été faite au prône de La Prairie hier 1er jour Nov. Après demande faite à moi par led(it) J. Bincet & Frorence Payant en presence des Srs. J Mousset Frs Couturier. Le 2 novembre 1829. J. B. Boucher Ptre ». (Archives nationales du Québec à Montréal).
Le lendemain, après la bénédiction du mariage, le curé note au registre une description qui demeurera écrite pour la postérité :
« L’an mil huit cent vingt neuf le deux Novembre, après une publication de promesse de mariage faite le vingt-sept septembre, année présente, au prône de la Messe paroissiale de cette paroisse et la dispense de publication de deux bans obtenue de Messire Roque vicaire général, entre Joseph Bincet dit Jolibois voyageur, de cette paroisse, fils majeur de defunt Jean Baptiste Bincet dit jolibois et de Marie Anne Thierry, d’une part, et Florence Payant dite Xaintonge, de cette paroisse fille mineure de Basile Payant dit Xaintonge et de Marguerite Rousseau ses pere et mere de cette Paroisse d’autre part, ne s’étant découvert aucun empêchement au dit Mariage, et Monseigneur de Telmesse ayant ordonné de passer outre à une opposition qui avait été faite comme illégale, Nous prêtre soussigné, curé en cette paroisse leur avons, du consentement des parens requis par le droit donné la bénédiction Nuptiale, après avoir reçu leur consentement mutuel par paroles de présents, et les dits Joseph Bincet et Florence Payant ont reconnu pour leur enfant Marie Adéline ici Baptisée le vingt cinq mars année présente comme née d’eux pour auparavant de parens inconnus et nous avons prononcé sur la dite Marie Adéline avec les cérémonies présentes les prières de légitimation du Rituel et ce en présence des Srs Joseph Mousset, François Couturier et Basile Payant pere de l’épouse qui ainsi que les époux ont déclaré ne savoir signer de ce enquis lecture faite. J. B. Boucher ptre ».
Tout indique que la petite Adéline, âgée de sept mois, est amenée à l’église pour recevoir les prières, qui la font passer d’enfant naturelle à fille légitime. C’est pourquoi, le curé inscrit en marge : « Légitimation de Marie Adéline au 28 (25) mars ». Puis, il reprend l’acte de baptême du 25 mars et note en marge : « Reconnue Bincet au 2 Nov. ».
Entre 1829 et 1853 – donc pendant 24 ans – Florence Payant donne naissance à 14 enfants, dont seulement trois décèdent en bas âge. À l’époque, la vocation première d’une épouse est d’avoir de nombreux enfants. À cet égard, Florence Payant donna l’exemple et ne méritait point l’humiliation lors de son mariage.
Ces événements se passent au début du XIXe siècle, lorsque les autorités ecclésiastiques ont encore beaucoup d’influence sur leurs fidèles. Selon nos valeurs d’aujourd’hui, on pourrait juger sévèrement le clergé pour avoir posé de tels actes humiliants. Toutefois, il faut reconnaître que, dans l’ensemble, la population acceptait ces décisions et s’accommodait assez bien de pénitences semblables. Autres temps, autres mœurs! comme on dit. En outre, il faut rappeler que l’enregistrement par le prêtre, des baptêmes, des mariages et des sépultures, constituait avant tout un acte d’ordre civil, dont la procédure était reconnue et acceptée par les pouvoirs de l’État. À cet égard, quelques milliers d’actes de la paroisse de LaPrairie de La Magdeleine furent rédigés par l’abbé Jean-Baptiste Boucher. En effet, il en a été le curé pendant 47 ans, soit de 1792 jusqu’à son décès en 1839.
Quelque 150 ans plus tard, en 1994, dans le Récré-o-parc de la ville de Sainte-Catherine, on aménage un poste d’observation de la faune et des cascades du majestueux fleuve Saint-Laurent. Le 5 juin, à son inauguration, on dévoile une plaque sur laquelle on lit à la fin de l’écriteau : « Site de l’ancienne demeure de Edouard Bencette un pionnier de Côte Sainte- Catherine ». Il s’agirait d’Edouard Bencette qui a épousé Anna Létourneau le 11 octobre 1904. Malheureusement, après dix ans, le texte sur la plaque est devenu presque illisible. Souhaitons que bientôt on la rafraîchira pour redonner un peu de rayonnement aux Bencette.

Lors du dernier congrès de la Fédération Québécoise des Sociétés de Généalogie qui s’est tenu en mai dernier, à Rimouski, trois de nos membres se sont vus spécialement honorés.
En effet, madame Lina Marcoux Chopin (340) et madame Lucille Riendeau Houle (390) ont toutes deux reçu leur certificat de « maître généalogiste agréé » (MGA) ce qui leur confère la plus haute distinction remise par le BQACG (Bureau québécois d’attestation de compétence en généalogie).
Toutes nos félicitations à ces deux travailleuses émérites!

En même temps, monsieur Marcel Myre (446) recevait des mains de monsieur Gaston Deschênes, président du jury, le prix Septentrion pour son œuvre primée, L’AUTRE MARIE MORIN, Une femme abandonnée en Nouvelle-France. En plus d’une bourse de 500$ offerte par la Fédération, monsieur Myre a vu son ouvrage publié par Les Éditions du Septentrion, QC. À vous aussi, monsieur Myre, nos plus sincères félicitations!

Acquisitions
Voici quelques titres de nouveaux livres apparaissant sur les rayons de notre bibliothèque :
- Répertoire toponymique du Québec, éditeur officiel du Québec, 1978 (don de madame Céline Lussier)
- Petites choses de notre histoire (Les), par Roy, Pierre Georges (don de monsieur Roger Hébert)
- Histoire de la Nouvelle -France, 1504-1603, par Trudel, Marcel (don de monsieur Roger Hébert)
- Frontenac, par W.J. Eccles (don de monsieur Roger Hébert)
- Autre Marie Morin (L’), Une femme abandonnée en Nouvelle-France, par Marcel Myre (un de nos membres #446) (Achat de la SHLM)
- Cyprien Tanguay (1819-1902), Documents annotés par Jacques Grignon (Ville de La Prairie)
- À travers les registres, par Cyprien Tanguay (Ville de La Prairie)
Vente de livres usagés
Cette année, notre vente annuelle aura lieu le samedi, 16 octobre 2004, de 8h30 à 17h00.
Voici quelques catégories de livres à vendre :
archéologie, architecture, art (art roman, encyclopédie), biographies, dictionnaire biographique, familles (histoire), généalogie (répertoires), greffes de notaires (inventaire), histoire (Canada, Nouvelle-France, Québec, universelle), magazines (RHAF, Mémoires de la SGCF, Cap-aux-Diamants) romans, villes (histoire), etc.
Plusieurs aubaines sont à votre portée, surtout pour les « lève-tôt ».
Les recettes de cette vente sont consacrées exclusivement à l’achat de nouveaux livres pour notre bibliothèque. Donc, vos achats contribueront à l’enrichissement de votre bibliothèque.
Dons
Merci de tout cœur aux donateurs dont les noms suivent :
– Madame Louise Archambault
– Monsieur Roger Hébert
– Madame Céline Lussier
– Ville de La Prairie
Tous ceux qui ont des livres qui prennent trop de place, ou qu’ils n’utilisent plus, ou dont ils veulent se départir à la suite d’un déménagement, ou qu’ils ont acquis lors d’une succession à la suite d’un décès, sont fortement invités à faire don de ces livres à notre Société d’histoire.
Suggestions
Toute suggestion concernant le fonctionnement de la bibliothèque ou l’achat de nouveaux livres est fort bienvenue.

Chers membres,
Pendant tout l’été qui s’achève, les locaux de la Société et les sites du Vieux La Prairie ont été fréquentés par de très nombreux visiteurs, bien accueillis par des guides affables et dynamiques.
Nous amorçons maintenant une nouvelle année qui s’annonce déjà pleine de promesses : des conférenciers, tous plus captivants les uns que les autres se sont déjà inscrits, les activités permanentes comme la bibliothèque, la cartographie, la photographie et la généalogie continuent sur leur lancée et l’archiviste poursuit son travail de réorganisation du système de classification et l’élaboration d’un calendrier de conservation.
Il me faut aussi mentionner l’exposition actuellement en place, Splendeur de la table, qui demeure accessible aux visiteurs jusqu’au 1er octobre.
Enfin vous remarquerez que votre revue Au jour le jour a été prise en charge par monsieur Jacques Brunette, à qui nous promettons d’apporter toute notre collaboration.
Encore une fois, je vous invite à venir nous voir et à profiter des services que vous offre votre Société d’histoire.
René Jolicoeur, président

Conférence de septembre
Le 15 septembre, notre conférencière sera madame Marie Gagné, membre de la SHLM. Biologiste de formation, Mme Gagné s’intéresse à la généalogie et plus particulièrement à l’histoire de la famille Gagné. Elle a écrit plusieurs articles dont entre autres, « Inventaire des biens de Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon », « Un pont réclamé », etc.
Sa conférence portera sur « Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon, une famille pionnière ».

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :
– Monsieur Paul Hemingway, jr (491)
– Madame Gisèle Monarque (492)
– Monsieur Pierre Brosseau (493)
– Monsieur Alain Gervais (494)
– Madame Mona-Andrée Rainville (495)
Don : En juin 2004, monsieur J. Raymond Denault a fait don à la Société d’une boîte contenant des documents photographiques et cartographiques, ainsi que plusieurs dossiers historiques. Nous tenons à l’en remercier.

Est- il possible que vous n’ayez pas encore remarqué la nouvelle enseigne qui orne fièrement le fronton de l’édifice où siège la SHLM ?
Ce magnifique panonceau nous a été gracieusement offert par monsieur Gary Chartrand.
Au nom de tous nos membres, nous tenons à exprimer toute notre gratitude à monsieur Chartrand pour son geste aussi sublime que désintéressé.

Participez à votre revue Au jour le jour.
Envoyez-nous vos articles!

Éditeur :
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Internet : www.laprairie-shlm.com
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
Collaborateurs :
Coordination : Jacques Brunette
Rédaction : Raymond et Lucette Monette (284); Jacques Brunette (280); Hélène Charuest (59); Marcel Myre
Révision : Jacques Brunette (280)
Infographie : SHLM
Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.
Siège social :
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Tél. : 450-659-1393
Téléc. : 450-659-1393
Courriel : [email protected]
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.
Au jour le jour, mai 2004

Ce que je vais vous raconter remonte aux années 1944-1945. J’étais à cette époque employé à l’Hôtel de Ville de La Prairie, situé sur la rue St-Ignace dans le vieux La Prairie.
J’ai travaillé une bonne douzaine d’années à ce bureau en compagnie de messieurs Léopold Péladeau, Hercule Serres et autres…
Mon travail consistait, entre autres, à remplacer les employés qui prenaient leurs vacances durant l’été, à ouvrir le bureau le samedi matin de 9h à 12h pour permettre à quelques personnes de payer leurs comptes à la ville. En plus, les samedis après-midi, j’étais percepteur des comptes d’électricité en souffrance et on me donnait 10% sur les argents ainsi collectés.
Mon travail m’amenait à sillonner la ville en tous sens et je pouvais ainsi, à cause de mon travail, être au courant de plusieurs faits plutôt cocasses.
La Prairie, à cette époque, était un gros village et les commérages et les faits inusités ensoleillaient nos journées un peu ternes. En voici un exemple que je n’oublierai jamais; je vais le nommer « Le petit jardin de l’abbé Vaillancourt ».
Ayant un petit chalet et une chaloupe, j’amenais souvent l’abbé à la pêche avec moi et, lorsque je prenais des poissons et lui pas ou peu, il exigeait que je porte les agrès et lui, les poissons. On ne contredisait pas un abbé à cette époque.
Je dois avouer que je le trouvais quelquefois un peu fatigant comme compagnon, car je devais bêcher pour trouver les vers, appâter les lignes, décrocher les poissons, etc.
Toujours est-il que, pour me récompenser et faire en sorte que je l’invite encore, il me conduisait dans son jardin situé juste en arrière de l’Église de la Nativité. Ce jardin était borné par un gros mur de pierres qui séparait le terrain de l’église de celui de monsieur Brossard; le morceau de terre de ce dernier était une douzaine de pieds plus bas que celui de l’Église.
Je le vois encore écartant les mauvaises herbes, car il ne sarclait jamais, ramasser ou arracher tomates, concombres, carottes qui étaient toujours plus gros que la moyenne. Je m’empressais d’apporter ces victuailles à la maison comme récompenses pour mes efforts.
Voulez-vous savoir pourquoi ces légumes étaient si beaux et si gros? Eh! Bien, tenez-vous bien; je vous raconte le secret de ce maraîcher exceptionnel!
Eh! Bien, un autre événement inattendu vous expliquera et compètera le premier.
Monseigneur Chevalier, alors curé de La Prairie, avait remarqué que des couples d’amants prenaient le dit jardin pour épancher leurs besoins amoureux et le bon curé était contre ces divertissements, cela va de soi. Il exigea de la ville de La Prairie qu’elle pose un poteau électrique muni d’une grosse lumière dans le dit jardin pour essayer de contrer les aspirations sentimentales trop ferventes.
La chose fut faite telle que demandée et quelle ne fut pas la surprise des hommes comme messieurs Cyrille Bisaillon et Félix Lavoie qui en creusant le trou nécessaire pour poser le poteau, heurtèrent avec leur pelle, un cercueil! Eh! oui, un cercueil, avec une petite vitre sur le dessus!
Les hommes cessèrent les travaux et demandèrent aux autorités religieuses et civiles, comme il se doit, s’ils devaient continuer?
Après consultation au sommet on demanda à ces hommes d’enterrer le fameux cercueil un peu plus loin du poteau et à la même profondeur.
Après le départ des autorités, la curiosité humaine aidant, les hommes décidèrent de nettoyer la petite vitre pour apercevoir à l’intérieur un petit homme bien vêtu portant cravate et lunettes; sa peau était de couleur gris foncé… Monsieur Lavoie, qui était un homme brave et hasardeux, décida d’ouvrir le couvercle avec une pince monseigneur…et après moult efforts, il réussit à glisser la pince entre le cercueil et le couvercle et quelle ne fut pas la surprise de voir les restes du petit homme s’affaisser comme un ballon…
Lorsque le couvercle fut complètement ouvert, il ne restait plus qu’un peu de cendre de couleur gris foncé et les lunettes qui reposaient sur les dites cendres.
Je peux vous raconter tous ces détails puisque j’étais présent lors de ces événements. Je me fis donc un devoir de rapporter tous ces événements aux employés du bureau.
J’avoue que j’ai été longtemps à ne pas manger de tomates après ce jour mémorable, encore aujourd’hui lorsque je mange de ce fruit il m’arrive de penser à mon petit homme de couleur gris foncé… et à l’abbé Vaillancourt…
Me croyez-vous?…
PS. Ce texte a été retrouvé dans les archives données à la SHLM par Laurent Houde, frère de feue Claudette Houde.

Eugénie Saint-Germain fait partie de la lignée de mes enfants, François et Rachel Cardinal. Elle est la fille de Bernard Saint-Germain, interprète au département des Affaires indiennes. Elle épouse, le 31 mai 1831 à Montréal, Joseph-Narcisse Cardinal, notaire à Châteauguay, député de La Prairie, pendu le 21 décembre 1838 comme Patriote (une anecdote pour vous : les parents de Joseph-Narcisse, de Joseph et Marguerite Cardinal sont cousins germains).
Si je choisis de parler d’elle dans le « Au jour le jour » du mois de mai, c’est que le 24 mai prochain aura lieu la deuxième édition de la « Journée internationale des Patriotes ». Cette journée décrétée par le gouvernement provincial souligne, et je cite :
… La lutte des Patriotes 1837-1838 pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l’obtention d’un système de gouvernement démocratique […]. Nous avons choisi d’honorer de cette manière la mémoire des hommes et des femmes qui, depuis l’implantation des institutions parlementaires, en 1791, ont milité pour les droits de la majorité, dont celui du peuple à se gouverner lui-même. http://cgi.cvm.qc.ca/Patriotes

Le 21 décembre 1838, Eugénie Saint-Germain pleure le corps inerte de son mari devant l’échafaud. Ses quatre enfants sont avec elle et elle attend son cinquième.
J’ai relevé pour vous, pour l’occasion, des témoignages de femmes dont fait partie Eugénie Saint-Germain.
Témoignages de femmes pendant la révolte des patriotes de 1837-1838 Collectif Clio, Histoire des femmes au Québec, Le jour éditeur, 1992, p. 158-163.
Eugénie Saint-Germain, épouse de Joseph-Narcisse Cardinal, député de Laprairie condamné à l’échafaud, intercède auprès des autorités pour sauver la vie de leurs proches. Malgré sa lettre à Lady Colborne, épouse du chef militaire qui a combattu les Patriotes, Eugénie Saint-Germain ne sera pas exaucée; le lendemain, elle sera veuve.
« Vous êtes femme et vous êtes mère! Une femme… tombe à vos pieds tremblante d’effroi et le cœur brisé pour vous demander la vie de son époux bien-aimé et du père de ses cinq enfants! L’arrêt de mort est déjà signé!! »
Julie Papineau écrit à son époux, Louis-Joseph Papineau, chef du Parti patriote :
« […] Si l’état de Montréal n’est pas changé […], si on ne peut rien obtenir il faudra inévitablement l’avoir par la violence… » [17 février 1836]
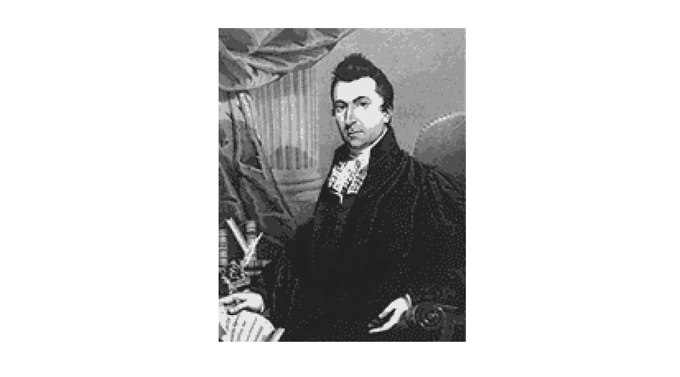
Émilie Boileau-Kimber, de Chambly, est armée et tient des assemblées de Patriotes dans sa demeure. Une autre met elle-même le feu à sa demeure pour démontrer aux Anglais qu’elle n’a pas peur d’eux et pour les empêcher de profiter de ses biens.
D’une manière moins visible, plusieurs femmes collaborent à la rébellion : elles fondent des balles, fabriquent des cartouches, dessinent et tissent les drapeaux tricolores des Patriotes.
Au risque de voir leur propre maison incendiée, des femmes soignent et cachent des Patriotes et des membres de leurs familles poursuivis ou recherchés. La majorité d’entre elles sont seules avec les enfants et les vieillards pour affronter sans armes les troupes britanniques qui pillent et incendient les maisons des Patriotes ainsi que des villages entiers tels Saint-Denis, Saint-Benoît et Saint-Eustache.
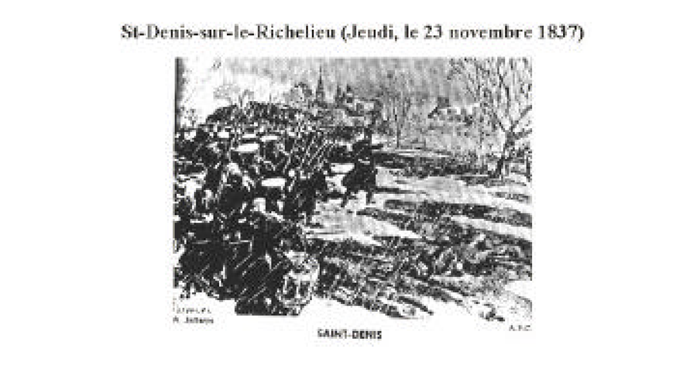
Rosalie Dessaules, sœur de Louis-Joseph Papineau, seigneuresse de Saint-Hyacinthe, dans un texte daté du 13 avril 1839, décrit l’état des campagnes au lendemain des troubles :
« On commence à ressentir vivement le tort qu’a fait ici le pillage. Il ne s’amène pas de viande au marché pour la moitié des besoins du village et le peu qu’il en vient est excessivement cher et de la plus mauvaise qualité et on n’a pas comme les autres années l’avantage de trouver dans la cour ce qu’il en manque au marché. Ils m’ont tué, emporté et détruit bœuf, vache, cochon, mouton, volaille de toutes espèces et je suis encore la moins à plaindre. Combien à qui on a fait la même chose et qui sont dénués de moyens pour voir les premières nécessités de la vie et qui sont chargés de famille ou âgés ou infirmes. »
Henriette Cadieux épouse du notaire Chevalier De Lorimier, mère de trois enfants dont l’aîné n’a que quatre ans et qui n’a pour vivre « que le produit du travail et de la profession de leur père ».

Euphrosine Lamontagne-Perreault! Cette femme « particulièrement touchée par les troubles puisqu’elle y perd deux fils, l’un tué et l’autre en exil, n’en affirme pas moins » :
« … si c’était à refaire et que mes enfants voulussent agir comme ils l’ont fait, je n’essayerais pas à les détourner parce qu’ils n’agissent nullement par ambition mais par amour du pays et par haine contre les injustices qu’ils endurent. »
J’espère que cet article à caractère exclusivement historique vous a plu.
À voir
- « Quand je serai parti…vous vivrez encore », Michel Brault.
- « 15 février 1839 », Pierre Falardeau.
- « http://www.vigile.net//ds-patriotes »
Sources :
1 http://cgi.cvm.qc.ca/Patriotes
2 Collectif Clio, Histoire des femmes au Québec, Le jour éditeur, 1992, p. 158-163.
3 Robert Prévost, Québécoises d’hier et d’aujourd’hui, éd. Alain Stanké.
Toutes les images proviennent de différents sites internet.

Encore un désastre. Le village de La Prairie en cendres. Un bras de fer s’appesantit depuis quelque temps sur notre pays. Tous les jours nous avons à enregistrer des calamités, des désastres qui étaient autrefois inconnus parmi nous. Et ces calamités, ces désastres se multiplient et se succèdent les uns aux autres avec une rapidité effrayante.
Le beau et florissant village de La Prairie est en cendres; quelques heures ont suffi pour accomplir cet acte de destruction et la ruine totale procurés sur les lieux, touchant cette affreuse catastrophe.
Mardi soir, vers 7 heures et quart, on s’aperçut que le feu s’était déclaré au toit d’une forge située à l’extrémité sud-ouest du village près du chemin de fer. Malgré les efforts des citoyens qui étaient accourus, les flammes sortirent bientôt d’un grenier à foin qui avoisinait la forge.
C’est alors qu’on s’aperçut du danger que courait le village entier. Le vent soufflait avec force du sud-ouest, et portait des tisons enflammés à une grande distance. En effet, le feu se déclara bientôt à une maison en bois, située à plusieurs arpents du siège de l’incendie et au milieu du village. Pour le coup, tout espoir de salut semblait perdu, et le découragement se manifesta au milieu de cette population sans expérience de ces sortes de désastres, et dépourvue entièrement de cette organisation si nécessaire dans les grandes conflagrations.
D’ailleurs, les pompes à feu qui appartiennent au village, n’étaient pas, faute d’entretien, en état de fonctionner, et l’élément destructeur qui ne reconnaît pour ainsi dire aucune opposition et qui était attisé par le vent qui redoublait de violence à mesure que la nuit s’avançait, s’étendit sur tout le village et consuma tout ce qui se trouvait sur son chemin, à l’exception de quinze ou vingt édifices qui échappèrent comme par miracle.
C’est ici le lieu de remarquer que la pompe qui appartient aux casernes, et qui est en très bon ordre, aurait pu être d’un grand secours; mais, il faut le dire sans déguisement, les habitants de La Prairie n’ont pas à se louer de la conduite des soldats en cette occasion. Ces hommes dont la mission est de veiller à la sûreté des citoyens ont forfait à leurs devoirs dans cette déplorable circonstance. Au plus fort du danger, la plupart des soldats étaient ivres; on les a vus enfoncer les magasins, ouvrir les vaisseaux qui contenaient de la boisson et s’amuser à boire au lieu de porter secours. On vante beaucoup la belle conduite du colonel en cette occasion. Aussi les citoyens de La Prairie n’en parlent que dans des termes de respect et de reconnaissance.
Aussitôt qu’on s’aperçut, à Montréal, que les flammes dévastaient le village de La Prairie, une foule immense se porta sur les quais, impatiente de voler à son secours. On attendait de minute en minute l’arrivée du steamboat traversier, le prince Albert, afin d’embarquer des pompes et des bras qui auraient été d’un secours efficace. Mais le steamboat ne vint pas. Il ne faut pas blâmer l’administration des chemins de fer, car malgré le clair de lune, l’atmosphère était obscurcie par les vapeurs et la fumée, et le trajet de Montréal à la Prairie, si difficile en plein jour vu la baisse des eaux, était impraticable de nuit. D’ailleurs, le pilote, l’ingénieur et l’équipage qui habitent La Prairie, avaient déserté le vaisseau pour courir au secours de leur famille et de leurs propriétés. Il aurait été impossible au capitaine de les rallier.
Cependant, des citoyens courageux et zélés, les capitaines des pompes de Montréal, l’Union et le Protector, ne purent contempler d’un œil indifférent le désastre qui avait lieu de l’autre côté du fleuve. Ils rassemblèrent quelques-uns de leurs hommes et engagèrent le petit steamboat Lord Stanley, pour transporter leurs pompes à Longueuil, seule route praticable de nuit pour se rendre à la Prairie. Un autre obstacle les attendait là. Ils eurent mille difficultés à se procurer des chevaux pour traîner leurs pompes. Le Herald signale un nommé McVey, de la traverse, qui avait plusieurs chevaux dans son écurie et qui refusa de les prêter ou de les louer, menaçant de tuer ceux des pompiers qui oseraient s’en emparer. Cet homme devait être marqué au front d’un stigmate de réprobation ineffaçable! Nous avons appris depuis que les pompiers se sont rendus jusqu’au village de Longueuil, où ils ont obtenu les chevaux dont ils avaient besoin.
Malgré toutes les difficultés que les courageux pompiers eurent à rencontrer, ils arrivèrent à La Prairie, vers une heure du matin, exténués de fatigue. Mais ils furent récompensés de leurs peines, car ils arrivèrent à temps pour sauver l’église, où le feu venait de se déclarer. Ce vaste et superbe édifice, bâti tout récemment, aurait infailliblement été la proie des flammes sans le secours des pompiers, à la tête desquels était le capitaine Lyman. On nous a parlé aussi de M. Benjamin Lespérance, de Longueuil, qui est monté sur l’édifice et qui a porté le premier secours avec un seau d’eau. On ne saurait trop apprécier de semblables dévouements et en particulier celui des pompiers qui parvinrent à arrêter le progrès des flammes, car sans eux, le peu d’édifices qui restent debout auraient sans doute été réduits en cendres. Les RR. PP. Jésuites qui desservent la cure de La Prairie, ont été infatigables; ils ont été sur pied toute la nuit, excitant par l’exemple les citoyens à travailler et à ne pas perdre courage. Nous ne pouvons passer sous silence l’acte généreux du capitaine Lambert, du steamer Pioneer, qui a volontairement pris le commandement du steamer Lord Stanley avec son propre équipage (le capitaine du Lord Stanley et son équipage étaient absents), a fait embarquer les pompes avec les pompiers et autant de personnes que le steamer a pu en contenir, pour aller au secours des incendiées, et qui, ne pouvant à cause de la noirceur, monter à La Prairie, s’est dirigé vers Longueuil où il a tout débarqué sans incident.
Malgré tous les efforts réunis, l’élément destructeur a triomphé; le beau village de La Prairie est en cendres; il ne reste maintenant de tous ces beaux et vastes édifices que quinze à vingt maisons dispersées çà et là; tout le milieu du village n’offre plus qu’un immense monceau de ruines.
Parmi les édifices qui ont échappé aux flammes se trouvent l’église catholique, le couvent, la maison et le magasin (seul magasin qui ait été épargné) de M. Gariépy, la maison et le moulin de la succession Plante, l’ancien hôtel Duclos et quelques autres petites maisons le long du fleuve qui se trouvaient hors de la portée des flammes; le vent comme nous l’avons dit déjà, soufflait du sud-ouest.
Il nous est impossible de donner la liste des victimes de ce terrible incendie. Le progrès des flammes a été si rapide que presque rien n’a pu échapper à leur ravage. Des meubles, des marchandises, qu’on avait transportés à une certaine distance sont devenus leur proie. Parmi ceux dont la perte est considérable, se trouvent : M. Sauvageau dont les maisons, brasserie et distillerie ont été consumées. Mm. Varin, Dupré, Dr. D’Eschambault, Hébert, Mme Denault, McFarlane, Lanctôt, Fortin, Dupuis, Gagnon et une foule d’autres personnes, dont il est impossible de donner la liste. Il suffit d’ajouter que le nombre de maisons incendiées se monte à près de 150 avec un plus grand nombre d’autres édifices, ce qui porterait la quantité de bâtisses réduites en cendres à plus de 350.
Hier encore, après 9 heures du matin, les pompes de Montréal venant de partir, le feu se déclara de nouveau dans l’asile de la providence dont l’étage supérieur avait été détruit. Le vent soufflait encore avec force et le feu se serait bientôt communiqué à quelques vieux édifices voisins s’il n’avait été éteint de suite. On s’aperçut ensuite que tout l’intérieur d’un hangar en pierre, couvert de fer-blanc avec contrevents en tôle, était en flammes. Mais par les efforts réunis des citoyens de Montréal et de ceux de la paroisse, le feu fut bientôt éteint.
Une foule immense se porta hier vers La Prairie : le bateau était encombré à ses deux voyages. Les uns, mus par un sentiment de devoir, allaient porter des secours et des consolations aux malheureux incendiés, tandis que d’autres ne se rendaient là que pour contempler les ruines! Du nombre des premiers, se trouvaient Monrg. De Montréal, accompagné d’un nombreux clergé, et M. le maire de Montréal, qui avait fait embarquer à bord une quantité de pain et plusieurs quarts de lard, Monseigneur, aidé des RR. PP. et de quelques citoyens, fit distribuer de suite des secours à la population indigente qui était dispersée sur la grève et dans les champs. Et vous, qui allez contempler cette scène de désolation sans répandre une larme et sans donner une obole à cette population, hier dans l’aisance et aujourd’hui dénuée de tout, vous n’avez donc pas d’entrailles?
Cependant on nous dit qu’à la suggestion de C. S. Hodier, écr., le prix du passage au second voyage du steamboat a été augmenté de vingt sous à un écu et que le surplus était destiné aux infortunés incendiés. Cette collecte indirecte, à laquelle se sont volontiers prêtés tous les passagers, a produit une somme assez considérable.
Hier après-midi, la Banque du Peuple a envoyé à La Prairie, un secours de 14 barils de fleur et 11 sacs de biscuits, ce qui suffira pour quelques jours à donner le strict nécessaire aux indigents.
On estime la perte causée par cet incendie tant en propriétés qu’en marchandises de $75,0000 à $80,000.
On espère que le maire convoquera tout de suite une assemblée des citoyens de Montréal pour aviser aux moyens de porter les premiers secours à cette population infortunée.
Nous n’avons pu nous procurer encore des détails corrects sur les assurances effectuées sur les propriétés qui ont été détruites. Mais ce dont nous sommes certains, c’est que pas un quart de ces propriétés n’étaient assurées.
LA MINERVE-Montréal, jeudi le 6 août 1846
Source : Fonds Damase Rochette (Archives SHLM)
Note : Mme Hélène Charuest, bénévole à la SHLM, a trouvé ce texte dans les archives du fonds Damase Rochette

Dons
Merci aux donateurs dont les noms suivent :
Madame Louise Archambault
Madame Patricia McGee-Fontaine
Monsieur Roger Hébert
Monsieur Michel Robert
Ces dons de livres, consacrés surtout à l’histoire et à la généalogie, sont toujours appréciés et nous permettent d’enrichir notre bibliothèque.
Bienvenue aux nouveaux donateurs.
Acquisitions (ville de La Prairie)
Cette année, nous poursuivons toujours notre partenariat avec la bibliothèque municipale et la ville de La Prairie.
Entre autres, nous avons fait l’acquisition de :
- Dictionnaire biographique du Canada, en 14 volumes, plus un index onomastique couvrant les 12 premiers volumes : Ces livres sont déjà sur les rayons de la bibliothèque.
De plus, nous avons fait l’acquisition de nombreux répertoires de mariages. En voici quelques-uns qui sont déjà cataloguées et sur les rayons :
- Mariages de Vancouver, paroisse Très-St-Sacrement.
- Mariages du Manitoba, région de St-Boniface.
- Mariages d’Ottawa : paroisses La Cathédral, Sacré-Coeur, St-Joseph et Ste-Brigide.
- Mariages du comté de Wolfe.
- Mariages du diocèse de Timmins.
- Mariages du comté de Témiscamingue.
Un grand merci à la ville de La Prairie et à M. Michel Robert de la bibliothèque municipale pour leur collaboration étroite avec notre société.
Acquisitions (membres)
- Biographies françaises d’Amérique; Journalistes associés, 1950 (Don de Mme Louise Archambault).
- Cahiers des Dix, numéro 19, 1954. (Don de Mme Louise Archambault).
- Histoire de la nation Métisse dans l’Ouest canadien, par Auguste-Henri TRÉMAUDAN, 1935 (Don de Mme Louise Archambault).
- Journal des Jésuites, par les abbés Lavudière et Casgrain, 1973 (Don de Mme Louise Archambault).
À vendre
Dictionnaire biographique du Canada, édition non complète (don de Michel Robert).

Chers membres
Nous sommes déjà rendus à notre dernière édition de l’année! À cause des nombreux projets qui ont sollicité mon attention, cette première année de mon mandat de président a passé comme un éclair.
En effet, une foule de changements ont été apportés aux différents rouages de notre Société : bibliothèque, salle d’ordinateurs, etc… À cela, s’ajoutent les nombreuses conférences et le travail quotidien de nos bénévoles qui contribuent, souvent dans l’ombre, au progrès de notre société.
Je profite de l’occasion pour remercier ces bénévoles qui font en sorte que notre société est l’une des plus dynamiques de la région.
Dernièrement, nous avons eu le regret d’apprendre le décès d’un de nos membres qui fut bénévole pendant plus d’une décennie à titre de trésorier de la SHLM, monsieur Jean Girard. Après avoir lutté avec la maladie depuis plusieurs années, il est décédé mercredi le 28 avril 2004. La famille Girard a doublement été éprouvée au mois d’avril puisque François, le fils de Cécile Girard, est décédé. Nous désirons donc souhaiter nos plus sincères condoléances à la famille Girard.
En guise de conclusion, je vous annonce une dernière conférence en mai et je vous invite à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 16 juin prochain.
Je vous y attendrai en grand nombre et je vous remercie de votre confiance.
René Jolicoeur, président

Conférence : « Chassés d’Acadie »
Notre prochaine conférence aura lieu le 19 mai au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.
« CHASSÉS D’ACADIE »
La conférencière : Nicole Martin-Verenka nous parlera de son livre et de la tentative de génocide du peuple acadien. L’an prochain marquera le 250e anniversaire de la déportation des Acadiens (Voir page 2 pour plus de détails).

Conférence : Chassés d’Acadie
Nos ancêtres venus de France rêvent de fonder une colonie française en Amérique. Mais…ils sont CHASSÉS D’ACADIE. On les maltraite en pays hostile. On leur vole leurs enfants. On les humilie, on piétine leur âme française.
Pour fuir ces terres de mille peines, péniblement, hommes, femmes, vieillards et enfants marchent un millier de kilomètres, semant derrière eux un long chapelet de petites croix noires, témoins muets de leur passage.
Exténués, déguenillés, fort « épuisés d’argent », ils trouvent asile chez nous, à La Prairie et dans les environs.
La tentative de génocide du peuple acadien nous touche particulièrement en ce 400e anniversaire de la fondation de l’Acadie. L’an prochain marquera le 250e anniversaire de la déportation des Acadiens. Le village de L’Acadie se prépare à commémorer, entre autres, l’accueil des Acadiens par les Pères Jésuites dans leur Seigneurie de La prairie. Ce sera une fête de taille puisque, de La Prairie à L’Acadie, tant de familles sont apparentées.
Même si vous vous appelez Bouchard, Roy et autres, vous pourriez fort bien avoir du sang acadien. De toute façon, à l’occasion de ce quatrième centenaire, ne vous sentez-vous pas tous un peu Acadiens?
Nicole Martin-Verenka, conférencière
Assemblée annuelle
Au mois de mai, tous les membres de la SHLM recevront par courrier l’avis de convocation, l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal 2003 pour l’assemblée générale annuelle qui se déroulera le mercredi 22 juin 2004 à 20h00, à l’étage du Musée du Vieux-Marché, au 247 de la rue Sainte-Marie, à La Prairie.
Horaire estival
Veuillez prendre note que nous débuterons notre horaire estival à partir du 7 juin 2004, dès 9h le matin.
Vous pourrez donc venir à la SHLM du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et les samedis et dimanches, de 12h à 17h.
Soirée de généalogie
N’oubliez pas d’inscrire à votre calendrier que les lundis soirs de généalogie se termineront lundi le 30 mai 2004.
Le conseil d’administration de la SHLM évaluera les derniers mois afin de s’assurer de la pertinence d’offrir à nos membres et aux nombreux chercheurs l’ouverture en soirée de ses locaux.
Une décision sera prise à cet effet et nous vous en ferons part dans notre bulletin mensuel « Au jour le Jour » de septembre puisque nous faisons relâche pour la période estivale.
Félicitations reçues et invitation
La SHLM a reçu un courriel de M. Jacques Désautels de Chambly pour la féliciter de son site Internet qui est remarquable. Voici donc ces propos : « Bravo aux concepteurs et à ceux qui le mettent à jour aussi régulièrement. Vous avez des liens avec les pages des associations de famille et désirons ajouter une référence à l’association La descendance de Pierre Desautels, de la Grande Recrue à : www.descendancedesautels.com. »
L’Association des Desautels d’Amérique cherche à retracer les membres de la famille, ainsi que les Lapointe qui descendent de Pierre Desautels, pour les inviter à un premier grand rassemblement qui aura lieu le dimanche 22 août 2004, à Sainte-Christine de Bagot. Sainte-Christine est située à une heure de Montréal et à 30 ou 40 minutes de Granby, Drummondville et Sherbrooke. Pour informations : (450) 658-6147 ou [email protected].

Éditeur :
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Internet : www.laprairie-shlm.com
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
Collaborateurs :
Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.
Rédaction : Raymond et Lucette Monette (284); Cécile Girard (426); Hélène Charuest (59)
Révision : Jacques Brunette (280)
Infographie : SHLM
Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.
Siège social :
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Tél. : 450-659-1393
Téléc. : 450-659-1393
Courriel : [email protected]
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.
Au jour le jour, avril 2004

1ère partie
Aujourd’hui, alors que le téléphone est à la portée de tous, que les moyens de transport sont nombreux et rapides pour se visiter, les amoureux ont moins tendance à s’écrire pour communiquer. Ce qui n’empêche pas qu’il y ait à l’occasion des sentiments particuliers que l’écrit permet d’exprimer avec plus de facilité et avec de plus jolis mots.
La lettre ou la note d’amour qu’on fait parvenir à l’être aimé n’est pas toujours le fait d’une lointaine et douloureuse séparation. Elle peut être préparatoire à une rencontre en touchant des sujets chargés d’émotivité trop difficiles à aborder en face à face. On l’emploie aussi après coup pour dire ce qu’on n’a pas osé alors qu’on était ensemble.
Mes grands-mères paternelle et maternelle avaient conservé des pièces de ce genre de correspondance datant de leur temps de jeune fille, dans les années 1887 et 1894. Un aspect intéressant de ces lettres et mots d’amour est le fait qu’assez souvent on s’y exprimait en vers. À l’époque, plusieurs journaux inséraient entre les articles qu’ils publiaient des pensées et des poèmes d’écrivains d’ici ou d’ailleurs, ce qui était apprécié d’une partie de leurs lecteurs et lectrices. Certains s’en inspiraient quand cela correspondait à leurs sentiments et les utilisaient même dans leurs écrits en les modifiant ou non.
Ma grand-mère paternelle avait conservé dans un petit carnet le texte de messages destinés à son amoureux dont on ne peut dire s’ils lui furent tous expédiés. Au début de la vingtaine, elle allait découvrir bientôt que celui qu’elle aimait était en voie de la laisser pour une autre. Un soir, elle a l’âme romantique et écrit à son amoureux :
Lorsque le doux zéphyr ira te caresser
Sur ses ailes oh Zémir
Renvoie-moi un baiser
Ces vers ont sans doute été inspirés par des lectures. Le zéphyr est ce vent d’ouest tiède, léger et agréable que les Grecs avaient divinisé et qui a par la suite été utilisé comme symbole poétique. Zémir(e) est un personnage d’un opéra-comique italien datant du 18ième siècle. Les vers qui suivent sont plus simples et de sa propre création :
Tu sais combien je t’aime
Toi mon bonheur suprême.
Que tu m’aimes de même
Vient me rendre l’espoir.
Tiens toujours ta promesse
Ha pour moi quelle ivresse
Quand je vais te revoir.
Puis, quand le rêve s’est brisé :
Éloigne-toi, ne sois plus mon idole
Laisse-moi libre et reçois mes vrais adieux.
J’ai trop vécu sous ta vive auréole
Mes sens glacés ne sont plus soucieux…
Quelques années plus tard, grand-mère s’unit à un homme fidèle avec qui elle vécut jusqu’à sa mort. Mais elle conserva son petit carnet et les élans de son cœur qu’elle y avait consignés.

Dans un nouvel arrondissement aux limites de la Ville de La Prairie, une artère est nommée au nom d’Emmanuel Desrosiers.
Cet écrivain est le fils d’Arthur Desrosiers et de Pacifique DeMontigny. Il naît à La Prairie, sur les rives du fleuve Saint-Laurent, le 6 octobre 1897.
Après avoir étudié la pédagogie à l’École Normale Jacques-Cartier à Montréal, il devient instituteur d’une école de rang à la Côte Sainte-Catherine. À cause du maigre salaire qui lui est dévolu, il opte pour le métier de linotypiste à l’imprimerie des Frères de l’Instruction Chrétienne, attenante à leur maison provinciale de La Prairie.
Emmanuel Desrosiers est un conteur-né. Son village natal, la nature belle en toutes saisons, le majestueux fleuve Saint-Laurent, seront ses sources d’inspirations.
Son désir de s’exprimer par l’écriture le conduit à offrir sa collaboration à différentes revues et à quelques magazines.
Certains contes et récits traduisent bien les réactions de ses concitoyens francophones devant la guerre 1914-1918. Pour le Service fédéral de l’information, il écrit une trentaine d’articles dont « 300 ans d’histoire », en 1942, à l’occasion du troisième centenaire de la Ville de Montréal. Au début des années 40, il aborde le roman policier.
En 1931, il publie le roman « LA FIN DE LA TERRE », volume illustré par Jean-Paul Lemieux, peintre québécois, et devenu depuis de renommée internationale. Ce roman d’anticipation scientifique à la Jules Verne intéresse vivement tous ceux qui sont soucieux de ce dont demain pourra être fait. Emmanuel Desrosiers anticipe la fin de la Terre vers l’an 2400. Un deuxième volume, « RIEN QUE DES HOMMES », écrit pour faire suite à « LA FIN DE LA TERRE » est demeuré à l’état manuscrit.
Les textes d’Emmanuel Desrosiers porteront la marque des deux conflits mondiaux majeurs qu’il a connus : les guerres de 1914-1918 et 1939-1945. La grave crise économique de 1929 l’influencera profondément. Tantôt, il décrira la misère qui frappe ses compatriotes, tantôt il publiera contes et récits humoristiques, espérant ainsi susciter une évasion aux misères du temps.
Décédé trop tôt le 28 janvier 1945 à l’âge de 47 ans, ce prolifique auteur mérite l’honneur d’associer son nom à une petite partie de son La Prairie qu’il appréciait tant.
Sa fille, Claire Desrosiers Leroux (169)

En date du 2 mai 1921, Sœur Ste-Sylvie, supérieure du Couvent de Notre-Dame de La Prairie écrit au Maire et aux échevins de la Ville de La Prairie pour exprimer sa vive gratitude pour les dons d’arbres précieux, destinés à accroître le bien-être des élèves et l’attrait de leur séjour au couvent.
Déjà dans le passé, le conseil avait fait preuve d’esprit public et de générosité vis-à-vis d’eux en contribuant à l’érection d’un poulailler modèle et qui est toujours ouvert aux visites et à l’examen, dans l’intention de faciliter au public l’acquisition de connaissances agricoles et ménagères.
La liste d’arbres d’ornement est comme suit : pour le parterre de devant : 1 bouleau blanc, un seringa grandiflora, 1 épine-vinette commune et thunbergie, 1 seringa faux-oranger et 1 bouleau commun.
Au côté nord, 1 seringa doré, 1 orme américain, 1 frêne américain et 1 tilleul. Le tout au prix de $5.50.
Il serait intéressant de vérifier s’il reste des spécimens de ces arbres et arbustes sur le terrain?

Marie-Louise-Emma-Cécile Lajeunesse naît à Chambly le 1er novembre 1847; elle est la fille de Joseph Saint-Louis dit Lajeunesse et de Mélina Mignault.

Cantatrice, Emma Lajeunesse, nom de scène Albani, (Chambly 1847-Londres 1930) a fait une longue et magnifique carrière internationale. Après des études avec les maîtres Duprez à Paris et Lamperti à Milan, elle chante sur les plus grandes scènes du monde entier.
Elle fait ses débuts en 1870 à Messine puis est engagée en 1872 au Covent Garden où elle chante presque chaque saison jusqu'en 1896. En 1883, au sommet de sa gloire, la soprano donne enfin un concert à Montréal, après 20 ans d'absence. À son arrivée, selon les journaux de l'époque, dix mille personnes l'attendent à la gare Windsor et Louis Fréchette, fidèle à ses habitudes, récite une longue pièce en vers écrite en son honneur. Elle a 36 ans.
En plus de faire partie du nombre restreint de Canadiens de l'époque à faire une carrière internationale, Albani aura été exceptionnelle dans son destin de femme. Rares étaient celles qui étaient soutenues dans l'expression de leur talent artistique; ceci est vrai aussi pour les hommes de l'époque. Gravures dans l’Histoire des Canadiens-Français, Benjamin Sulte, www.er.uqam.ca/nobel/r14310
Sa grand- mère, Rachel McCutcheson, était arrivée au Canada à un âge tendre, en provenance de New York. Emma eut sa première éducation dans une école anglophone de Plattsburg, N.Y., puis au couvent du Sacré-Cœur du Sault-au- Récollet.
C'est son père, musicien talentueux, qui lui donna sa première formation musicale. À sept ans, elle fit une première apparition publique au Mechanics' Hall, à Montréal, devant un auditoire de la bonne société de la ville. À 15 ans, elle se vit offrir, par le vicaire-général Conroy (qui sera plus tard évêque d'Albany, N.Y.), un poste d'organiste à Saratoga Springs. Elle œuvra également durant trois ans comme professeur de chant et de piano au couvent du Sacré-Cœur de Kellwood.
Lors du Jubilé de la reine Victoria en 1887, elle reçut un magnifique présent de la souveraine, soit une figurine représentant la victoire en or pur, dessiné par la comtesse Feodora Gleicheu. Une inscription s'y lisait, en pierres précieuses : Victoria.
En 1878, elle épousa Ernest Gye, directeur de théâtre, dont elle a eu un fils qui deviendra diplomate. Elle meurt, après une longue maladie, le 3 avril 1930, à Londres. L’Encyclopédie de L’Agora www.agora.qc.ca/mot.nsf
Prochain article : Eugénie Saint-Germain

PRAIRIE DE MAGDELEINE
Dimanche 1er octobre 1749
Temps nuageux et pluvieux; durant l’après-midi, forte pluie. Température : à 8 heures du matin, 13o, Vent S.S.E.
J’avais bien l’intention de quitter Prairie et de poursuivre mon voyage dès ce matin, mais le prêtre d’ici, monsieur Lignerie, homme assez noble et instruit, ainsi que le Capitaine de la région me font demander si je veux bien, dans la mesure du possible, repousser mon départ jusqu’après la messe pour permettre aux gens de l’entendre; j’estime donc mon devoir de ne pas m’opposer à un désir aussi légitime.
Monsieur Lignerie célèbre d’ailleurs le service divin plus brièvement qu’à l’ordinaire. A midi, après la messe, nous quittons Prairie. Pour porter mes bagages, je dispose de quatre charrettes, tirées chacune par deux chevaux, ainsi qu’un cheval que je monte moi-même, le tout offert par le gouvernement du Canada, aux frais du trésor royal. Le mauvais état des chemins n’a pas son égal; ils sont trempés et défoncés au point que mon cheval entre maintes fois dans la boue jusqu’au ventre; le temps est également assez mauvais et si pluvieux qu’on peut à peine lever les yeux; la plupart des arbres, maintenant ont perdu leurs feuilles et la forêt apparaît déjà passablement dépouillée.
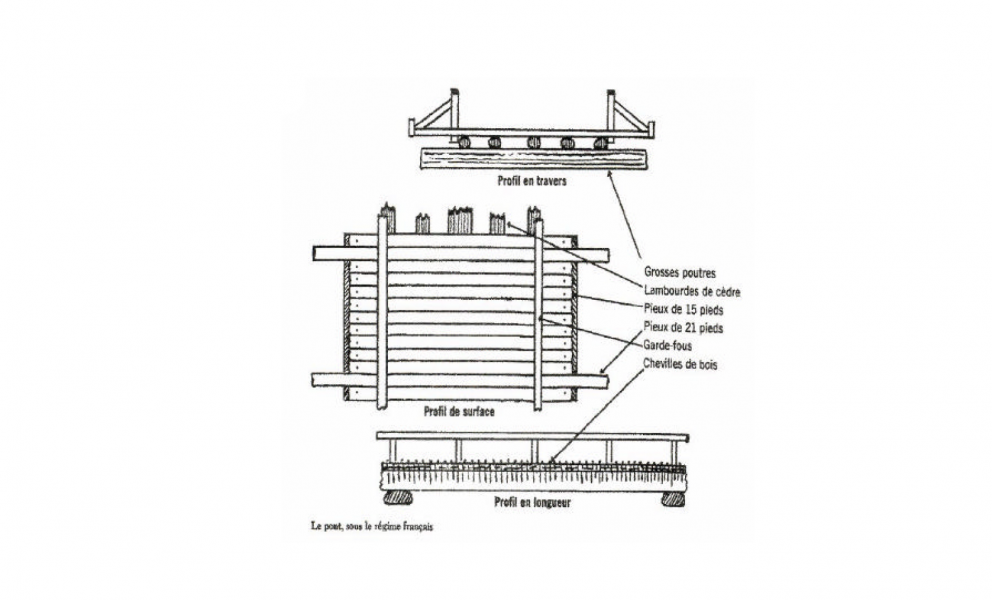
Voici quelques coordonnées sur la construction des ponts sous le régime français livrées par l'historien Marcel Trudel :
« Les routes de terre apparaissent dans le premier quart du XVIIe siècle : ce sont d'abord des chemins seigneuriaux qui longent le fleuve pour unir les habitations d'une même seigneurie; puis après la mise en place d'un grand-voyer, un petit réseau de chemins du roi se développe en tronçons.
Les ponts, d'une largeur de 15 pieds et d'une longueur maximale d'environ 40, ne servent guère à enjamber que les ruisseaux; dès qu'un cours d'eau a quelque peu d'importance, on se contente d'y établir un service de bac.
De plus, on construit les ponts par corvées, en prenant le bois, sans le payer, sur les terres les plus voisines puisque, dit-on, les propriétaires des terres environnantes retirent plus de commodités de ces ponts ».
La Construction du pont de la rivière de La Tortue
Le 23 février 1724, devant le notaire Guillaume Barette, Pierre Lefebvre, un maître charpentier de La Prairie, convient avec le père d’Heu, s.j., délégué par les habitants de la Prairie, des « marches Et Convantions » pour la construction du pont sur la rivière de la Tortue; je vous présente des extraits du devis de menuiserie Barette Guillaume, Marché entre les jésuites et Pierre Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E.
Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E. :
§ 1. « led Sr Le feibvre promet Et Soblige de faire et parfaire a Ces fraix Et depent un pont public Sur La Riviere de la tortue a Lendroit ou Il a Esté marque par Le Sr René dupuy Comis a la grand voirie,
§ 2. lequel pont Sera fait du bois dont La teneur Ensuit premieremt Tous Les poteaux Semeles appuis de poteaux Et Les grosses pieces quy se planteront En haut Sur Les poteaux Seront tous de Chesne blanc,
Les poteaux semelles (de quatorze pouces de diamètre) correspondent aux « Lambourdes de cèdre » sur le croquis. Les appuis de poteaux correspondent aux « Grosses poutres » sur le croquis.
« Les grosses pièces quy se planteront En haut Sur Les poteaux » sont plus difficiles à identifier. On peut aisément penser que l’on désigne ainsi, ici, la suprastructure des garde-fous et de leurs poteaux de soutien. Car ainsi, le texte aura précisé – cela semble son intention – que tout le pont, si ce n’est le cas échéant les chevilles ou les pitons, d’une part, et les pièces de travers « du meillieur bois que led feivre poura trouver a portée » sera de chêne blanc.
§ 3. Les pieces de traver Sur Lesquels ont passera Et quy Serviront de Chemin Seront du meillieur bois que led feivre poura trouver a portée Et Seront Escaris du moins Sur une face afin que le dessus dud pont fait uny Et auront au moins quinze pied de long,
Les pièces de travers correspondent aux « pieux de 15 pieds »sur le croquis et comprennent vraisemblablement les « pieux de 21 pieds » sur le croquis.
§ 4. Les gardes foux Seront aussy de bon bois, Les poteaux auront pour Le moins quatorze pousce de diametre Les Semelles autant Et Les apuis presque autant Le tout bien Enchasse dans de bonnes mortoises Et arresté avec de gros pitons de fer ou du moins de bonnes chevilles de bois de Chesne blanc
« Les garde foux » correspondent aux « Gardefous » sur le croquis. Les poteaux dont il est question ne sont pas spécifiés, mais ils désignent vraisemblablement les poteaux de soutien des garde-fous, que l’on voit sur le profil en travers et sur le profil en longueur du croquis. Les « apuis » correspondent eux, aux « Grosses poutres » sur le croquis. Enfin les gros pitons de fer ou du moins de bonnes chevilles de bois de chêne blanc correspondent aux « Chevilles de bois » sur le croquis.
§ 5. Lequel dit Sr Le feivre promet Et Soblige de Rendre Led pont parfait Sur Lade riviere de La tortue Et achevé pour le plus tard au vingt Sixiesme de Juillet prochain de tel Sorte quil Sera loisible aud temps a toutes personne dy passer avec Leur harnois autant que Sera Leur besoin
§ 6. Comme aussy Led Le feibvre promet Et Soblige de garantir Led pont pour un an Et Jour apres La perfection diceluy Selon La Coutume ordinaire En Sorte que Sil Est Emporté ou Endommagé par Les glaces ou autrement avant Led t temps de lad e garantie Il Sera tenu Comme Il promet Et Soblige de Le Refaire de nouveau a Ces fraix Et de pans
§ 7. Et outre moyennant La Somme de quatre Cens Livre monnaye de France que Led Reverand pere dheu Sengage de Luy payer Sur ce que les habitants Luy doivent donner Comme Ils En Sont convenus tous Ensemble
§ 8. Savoir deux cent Livre a fur Et a mesure que les ouvrages dud pont Se feront Et les deux Cent Livre Restant Luy Seront payés a la Toussain prochain ou plutot Sy faire Se peut
§ 9. fait Et passe aud Lieu de la prairie de la magne maison de madame dumay En pnce des Sr Estienne detaily Et Jean francois dumay Tesmoins »
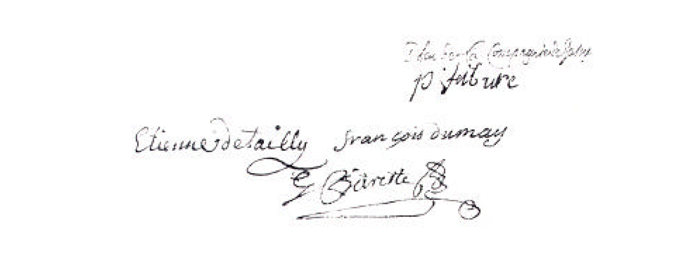
Il est toujours intéressant de faire les liens entre les personnes présentes lors d’actes notariés ou autres documents. Ainsi à la lecture de ce contrat on peut noter :
– que madame Dumay, c’est Jeanne Roinay veuve d’Étienne Bisaillon et de François Demers, la mère de Jean-François Demers.
– que les parents de Jean-François Demers (un des deux témoins) sont Jeanne Roinay (la demi-sœur de Catherine Daubigeon) et François Demers. À noter que Jean-François Demers signe François Dumay.
– que le notaire Guillaume Barette, l’époux de Jeanne Gagné est le gendre de mon ascendant Pierre Ganier.
– que le menuisier Pierre Lefebvre est le fils de Pierre Lefebvre et de Marguerite Gagné, la sœur de Pierre Ganier. Pierre Lefebvre est donc le neveu de Pierre Ganier comme le prouve sa signature, identique sur le devis de menuisier et sur l’acte de baptême de sa fille Anne Catherine. En effet, lorsque Pierre Lefebvre et son épouse, Marie Louise Brosseau, font baptiser leur fille Anne Catherine, le 17 janvier 1718, à La Prairie, le père présent signe ainsi :
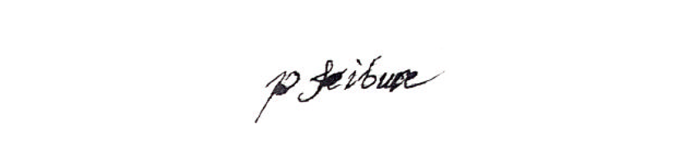
– qu’Étienne Deniau dit Détaillis, témoin, a épousé en 1718, Catherine Anne Bisaillon, la petite-fille de Pierre Ganier, la fille de Catherine Gagné et de Benoît Bisaillon.
Le pont construit
Qu’advint-il de ce pont tant réclamé par les habitants de La Tortue à La Prairie? Eh bien il fut construit en 1724 et il remplit ses fonctions durant huit ans quand, à ce moment, il fut nécessaire de construire un nouveau pont. Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170.
Michelet a bien dit : « l’histoire est d’abord toute géographique ». Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170.
Bibliographie
(1) Gagné Robert, Instrument de recherche sur Pierre Ganier fils de Pierre Gasnier et de Marguerite Rosée, Association des familles Gagné et Bellavance, 1994, p.8.
(2) Beaudry Charles, La Borgnesse : une légende vivante, Deux mille ans d’histoire, Le Reflet, Trans Mag, 2000, p. 10.
(3) Lacroix Yvon, Les origines de La Prairie, (1667-1697), Cahiers d’histoire des jésuites, No 4, Bellarmin, 1981, p. 96-104.
(4) Trudel Marcel, Histoire de la Nouvelle-France, Tome IV, La Seigneurie de la Compagnie des Indes Occidentales, (1663-1674), Fides, 1997, p. 391.
(5) Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167 – 170.
(6) Procès-verbaux des grands voyers, 9 août 1708, Société de généalogie des Cantons de l’Est (S.G.C.E.)
(7) Barette Guillaume, Assemblée des habitants de La Prairie, 25 janvier 1722, S.G.C.E.
(8) Raimbault Pierre, Assemblée des habitants de La Prairie, 10 août 1722, S.G.C.E.
(9) Ordonnance de l’intendant Michel Bégon, 17 janvier 1723, S.G.C.E.
(10) Barette Guillaume, Assemblée des habitants de La Prairie, 25 août 1723, S.G.C.E.
(11) Trudel Marcel, Initiation à la Nouvelle-France, histoire et institutions, HRW, 1971, p. 204-206.
(12) Barette Guillaume, Marché entre les jésuites et Pierre Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E.
Remerciements
Merci à monsieur Gilbert Beaulieu de la Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine, à madame Muguette Toupin, à monsieur Frédéric Brochu, archiviste, tous deux membres de la Société de généalogie des Cantons de l’Est, sans oublier Jean Gagné, mon frère, pour sa contribution à la correspondance, croquis – devis de menuiserie.

Acquisitions
- Carignan-Salière, 1665-1668, par Michel Langlois, Maison des ancêtres, 2004 (achat de la SHLM)
- Lieux et monuments historiques de Québec et environs, par Rodolphe Fournier (achat SHLM)
- Répertoire des municipalités du Québec, éd. 2002 (achat SHLM)
Livres à vendre
Une nouvelle liste de livres à vendre a été produite et mise à jour. Elle est affichée sur le babillard, à l’entrée de la SHLM.
De plus, nous avons une vingtaine de livres de Robert Rumilly, Histoire de la province de Québec, lesquels ne sont pas intégrés à cette liste.
Règlements de la bibliothèque
Suite à une rencontre entre les responsables de la bibliothèque et les membres du c.a. de la SHLM, une réglementation minimale a été produite. Elle est affichée à l’entrée de la bibliothèque, sur la porte.
Merci de votre collaboration.
Ameublement de la bibliothèque
La grande table a quitté le local de la bibliothèque pour faire place à 4 tables de dimensions réduites. Nous espérons que cette modification répondra à des attentes longtemps manifestées par nos membres.
Quant aux chaises, dans un avenir pas trop lointain, elles seront remplacées par d’autres plus fonctionnelles et plus confortables.
Le sort de la grande table n’est pas encore défini.
Index des répertoires de mariages
Tel que promis, nous avons publié un index des répertoires BMS que vous retrouverez sur une table de la bibliothèque.
Cet index remplace le cardex qui était incomplet et nous espérons que le tout sera beaucoup plus fonctionnel.
Il s’agit d’une base de données en Excel, produite par Luc-Pierre Laferrière, membre de la SHLM, que nous remercions de tout cœur.
C’est le modèle que nous adopterons à l’avenir et que nous améliorerons au fil du temps.

Bonjour à vous tous, chers membres.
Enfin le printemps est arrivé et la chaleur est à nos portes. Voici quelques nouvelles de votre société.
Monsieur Gaétan Bourdages a accepté de former un comité dans le but de rebâtir notre site Web devenu désuet. C’était une des priorités de votre Société pour cette année. Si tout va bien, ce mandat devrait être complété d’ici quelques mois.
À la demande de certains de nos membres, monsieur Jean L’Heureux et Monsieur Raymond Monette ont réaménagé la salle de généalogie.
Premièrement, plusieurs tables de travail sont maintenant disponibles dans la salle de la bibliothèque. Nous espérons que ce réaménagement rendra le milieu de travail des chercheurs plus pratique. Deuxièmement, nous avons réorganisé la disposition de certains répertoires sur les étagères et ce, afin d’en faciliter l’accès.
En terminant, veuillez prendre note que madame Johanne McLean est présentement en congé pour une période indéterminée. C’est madame Linda Crevier qui assume présentement le poste de secrétaire-coordonnatrice.
Je vous souhaite à tous Joyeuses Pâques et profitez-en pour refaire le plein d’énergie.
René Jolicoeur, président

Notre prochaine conférence aura lieu le 21 avril au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.
« Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon, une famille pionnière »
La conférencière : Marie Gagné

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :
– Pauline Crevier, La Prairie (488)
– Michel Dupuis, St. Constant (489)
– Reine Beaudin, Brossard (490)
Conférence
Ce mois-ci notre conférencière sera madame Marie Gagné, membre de la SHLM. Biologiste de formation, Mme Gagné s’intéresse à la généalogie et plus particulièrement à l’histoire de la famille Gagné. Elle a écrit plusieurs articles dont, entre autres, « Inventaire des biens de Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon », « Un pont réclamé », etc.
Sa conférence portera sur « Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon, une famille pionnière ».

Éditeur :
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Internet : www.laprairie-shlm.com
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
Collaborateurs :
Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.
Rédaction : Johanne McLean; Raymond et Lucette Monette (284); Laurent Houde (277); Marie Gagné (316); Cécile Girard (426); Hélène Charuest (59)
Révision : Jacques Brunette (280)
Infographie : SHLM
Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.
Siège social :
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Tél. : 450-659-1393
Téléc. : 450-659-1393
Courriel : [email protected]
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.