
- Au jour le jour, mai 2004
Ces femmes de La Prairie et ses environs, 4e partie : Eugénie Saint-Germain
Eugénie Saint-Germain fait partie de la lignée de mes enfants, François et Rachel Cardinal. Elle est la fille de Bernard Saint-Germain, interprète au département des Affaires indiennes. Elle épouse, le 31 mai 1831 à Montréal, Joseph-Narcisse Cardinal, notaire à Châteauguay, député de La Prairie, pendu le 21 décembre 1838 comme Patriote (une anecdote pour vous : les parents de Joseph-Narcisse, de Joseph et Marguerite Cardinal sont cousins germains).
Si je choisis de parler d’elle dans le « Au jour le jour » du mois de mai, c’est que le 24 mai prochain aura lieu la deuxième édition de la « Journée internationale des Patriotes ». Cette journée décrétée par le gouvernement provincial souligne, et je cite :
… La lutte des Patriotes 1837-1838 pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l’obtention d’un système de gouvernement démocratique […]. Nous avons choisi d’honorer de cette manière la mémoire des hommes et des femmes qui, depuis l’implantation des institutions parlementaires, en 1791, ont milité pour les droits de la majorité, dont celui du peuple à se gouverner lui-même. http://cgi.cvm.qc.ca/Patriotes

Le 21 décembre 1838, Eugénie Saint-Germain pleure le corps inerte de son mari devant l’échafaud. Ses quatre enfants sont avec elle et elle attend son cinquième.
J’ai relevé pour vous, pour l’occasion, des témoignages de femmes dont fait partie Eugénie Saint-Germain.
Témoignages de femmes pendant la révolte des patriotes de 1837-1838 Collectif Clio, Histoire des femmes au Québec, Le jour éditeur, 1992, p. 158-163.
Eugénie Saint-Germain, épouse de Joseph-Narcisse Cardinal, député de Laprairie condamné à l’échafaud, intercède auprès des autorités pour sauver la vie de leurs proches. Malgré sa lettre à Lady Colborne, épouse du chef militaire qui a combattu les Patriotes, Eugénie Saint-Germain ne sera pas exaucée; le lendemain, elle sera veuve.
« Vous êtes femme et vous êtes mère! Une femme… tombe à vos pieds tremblante d’effroi et le cœur brisé pour vous demander la vie de son époux bien-aimé et du père de ses cinq enfants! L’arrêt de mort est déjà signé!! »
Julie Papineau écrit à son époux, Louis-Joseph Papineau, chef du Parti patriote :
« […] Si l’état de Montréal n’est pas changé […], si on ne peut rien obtenir il faudra inévitablement l’avoir par la violence… » [17 février 1836]
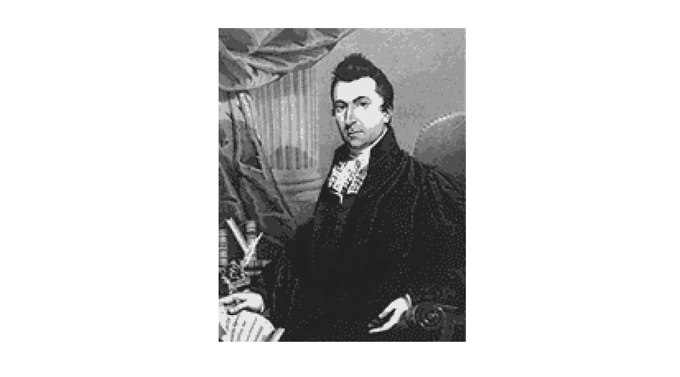
Émilie Boileau-Kimber, de Chambly, est armée et tient des assemblées de Patriotes dans sa demeure. Une autre met elle-même le feu à sa demeure pour démontrer aux Anglais qu’elle n’a pas peur d’eux et pour les empêcher de profiter de ses biens.
D’une manière moins visible, plusieurs femmes collaborent à la rébellion : elles fondent des balles, fabriquent des cartouches, dessinent et tissent les drapeaux tricolores des Patriotes.
Au risque de voir leur propre maison incendiée, des femmes soignent et cachent des Patriotes et des membres de leurs familles poursuivis ou recherchés. La majorité d’entre elles sont seules avec les enfants et les vieillards pour affronter sans armes les troupes britanniques qui pillent et incendient les maisons des Patriotes ainsi que des villages entiers tels Saint-Denis, Saint-Benoît et Saint-Eustache.
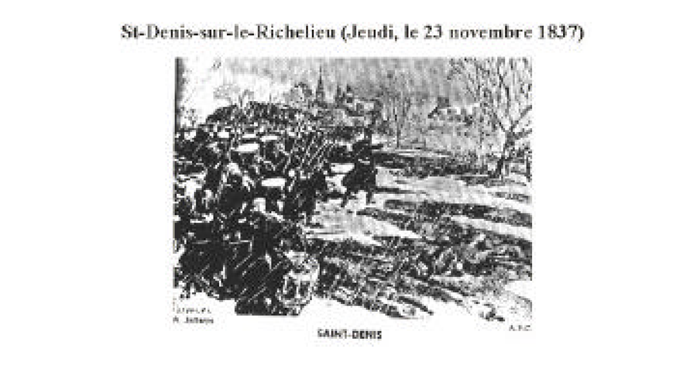
Rosalie Dessaules, sœur de Louis-Joseph Papineau, seigneuresse de Saint-Hyacinthe, dans un texte daté du 13 avril 1839, décrit l’état des campagnes au lendemain des troubles :
« On commence à ressentir vivement le tort qu’a fait ici le pillage. Il ne s’amène pas de viande au marché pour la moitié des besoins du village et le peu qu’il en vient est excessivement cher et de la plus mauvaise qualité et on n’a pas comme les autres années l’avantage de trouver dans la cour ce qu’il en manque au marché. Ils m’ont tué, emporté et détruit bœuf, vache, cochon, mouton, volaille de toutes espèces et je suis encore la moins à plaindre. Combien à qui on a fait la même chose et qui sont dénués de moyens pour voir les premières nécessités de la vie et qui sont chargés de famille ou âgés ou infirmes. »
Henriette Cadieux épouse du notaire Chevalier De Lorimier, mère de trois enfants dont l’aîné n’a que quatre ans et qui n’a pour vivre « que le produit du travail et de la profession de leur père ».

Euphrosine Lamontagne-Perreault! Cette femme « particulièrement touchée par les troubles puisqu’elle y perd deux fils, l’un tué et l’autre en exil, n’en affirme pas moins » :
« … si c’était à refaire et que mes enfants voulussent agir comme ils l’ont fait, je n’essayerais pas à les détourner parce qu’ils n’agissent nullement par ambition mais par amour du pays et par haine contre les injustices qu’ils endurent. »
J’espère que cet article à caractère exclusivement historique vous a plu.
À voir
- « Quand je serai parti…vous vivrez encore », Michel Brault.
- « 15 février 1839 », Pierre Falardeau.
- « http://www.vigile.net//ds-patriotes »
Sources :
1 http://cgi.cvm.qc.ca/Patriotes
2 Collectif Clio, Histoire des femmes au Québec, Le jour éditeur, 1992, p. 158-163.
3 Robert Prévost, Québécoises d’hier et d’aujourd’hui, éd. Alain Stanké.
Toutes les images proviennent de différents sites internet.

- Au jour le jour, avril 2004
Ces femmes de La Prairie et ses environs, 3e partie : Emma Lajeunesse Albani (1847-1930)
Marie-Louise-Emma-Cécile Lajeunesse naît à Chambly le 1er novembre 1847; elle est la fille de Joseph Saint-Louis dit Lajeunesse et de Mélina Mignault.

Cantatrice, Emma Lajeunesse, nom de scène Albani, (Chambly 1847-Londres 1930) a fait une longue et magnifique carrière internationale. Après des études avec les maîtres Duprez à Paris et Lamperti à Milan, elle chante sur les plus grandes scènes du monde entier.
Elle fait ses débuts en 1870 à Messine puis est engagée en 1872 au Covent Garden où elle chante presque chaque saison jusqu'en 1896. En 1883, au sommet de sa gloire, la soprano donne enfin un concert à Montréal, après 20 ans d'absence. À son arrivée, selon les journaux de l'époque, dix mille personnes l'attendent à la gare Windsor et Louis Fréchette, fidèle à ses habitudes, récite une longue pièce en vers écrite en son honneur. Elle a 36 ans.
En plus de faire partie du nombre restreint de Canadiens de l'époque à faire une carrière internationale, Albani aura été exceptionnelle dans son destin de femme. Rares étaient celles qui étaient soutenues dans l'expression de leur talent artistique; ceci est vrai aussi pour les hommes de l'époque. Gravures dans l’Histoire des Canadiens-Français, Benjamin Sulte, www.er.uqam.ca/nobel/r14310
Sa grand- mère, Rachel McCutcheson, était arrivée au Canada à un âge tendre, en provenance de New York. Emma eut sa première éducation dans une école anglophone de Plattsburg, N.Y., puis au couvent du Sacré-Cœur du Sault-au- Récollet.
C'est son père, musicien talentueux, qui lui donna sa première formation musicale. À sept ans, elle fit une première apparition publique au Mechanics' Hall, à Montréal, devant un auditoire de la bonne société de la ville. À 15 ans, elle se vit offrir, par le vicaire-général Conroy (qui sera plus tard évêque d'Albany, N.Y.), un poste d'organiste à Saratoga Springs. Elle œuvra également durant trois ans comme professeur de chant et de piano au couvent du Sacré-Cœur de Kellwood.
Lors du Jubilé de la reine Victoria en 1887, elle reçut un magnifique présent de la souveraine, soit une figurine représentant la victoire en or pur, dessiné par la comtesse Feodora Gleicheu. Une inscription s'y lisait, en pierres précieuses : Victoria.
En 1878, elle épousa Ernest Gye, directeur de théâtre, dont elle a eu un fils qui deviendra diplomate. Elle meurt, après une longue maladie, le 3 avril 1930, à Londres. L’Encyclopédie de L’Agora www.agora.qc.ca/mot.nsf
Prochain article : Eugénie Saint-Germain

- Au jour le jour, mars 2004
Ces femmes de La Prairie et ses environs, 2e partie : Marie Geneviève Sophie Raymond-Masson ( -1883)
Marie Geneviève Sophie Raymond-Masson est la fille de Jean-Baptiste Raymond (marchand) et de Marie-Clotilde Girardin. Elle se marie avec Joseph Masson à l’église de La-Nativité-de-la-très-Sainte-Vierge-Marie de La Prairie le 6 avril 1818.
On ne sait si son histoire fut un conte de fées, mais on peut dire qu’elle a mis la main sur un bon parti. Grâce à son mari, Sophie Raymond est devenue fort probablement notre première millionnaire.
« …C’était une femme supérieure, qui alliait une solide culture à une charité inépuisable. Elle s’employa notamment à développer l’enseignement secondaire… mentionnons notamment Louis Riel, le futur chef de la rébellion du Nord-Ouest, et Joseph-Adolphe Chapleau, qui fut premier ministre et lieutenant-gouverneur du Québec.
Mme Masson mourut en 1883, léguant son manoir à l’institut des Sœurs de la Providence pour la fondation d’un hospice. Plus tard, il devint le juvénat des Pères du Saint-Sacrement. » Robert Prévost, Québécoises d’hier et d’aujourd’hui, éd. Alain Stanké.
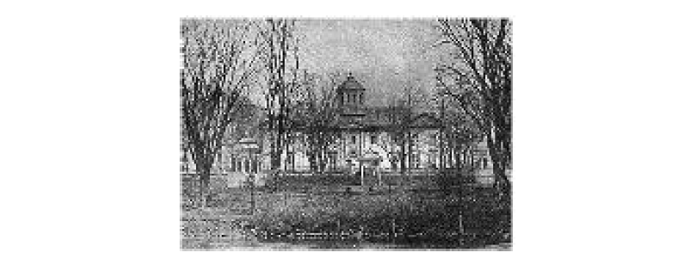
Mais qui est Joseph Masson? http://www.ile-des-moulins.qc.ca/ile.htm (parties du texte)
Un jour, bien décidé, Joseph Masson quitte Saint-Eustache pour Montréal. En 1832, il achète la seigneurie de Terrebonne dans une vente par shérif. Marchand importateur de Montréal, premier millionnaire Canadien français, juge de paix, commissaire, échevin, vice-président du conseil d'administration de la banque de Montréal, cet homme n'a pas froid aux yeux.
Homme très occupé, Joseph Masson engage un agent seigneurial pour administrer ses affaires à Terrebonne. Ce nouvel engagé se nomme Germain Raby. Joseph fait construire un nouveau moulin à farine et apporte à Terrebonne une toute nouvelle technologie provenant des États-Unis : la « roue à réaction » (la turbine!).
La roue à réaction est une merveille technologique qui remplace la roue à aubes… Cela permet aux Masson de mener une rude concurrence aux autres seigneuries.
Au printemps 1847, un bris amène Joseph Masson à descendre sous le moulin pour analyser le problème. Il prend froid et attrape une maladie infectieuse qui l'emporte quelque temps plus tard. Il laisse dans le deuil ses huit enfants et son épouse, Geneviève-Sophie, qui devient la nouvelle seigneuresse de Terrebonne.
Femme de tête, elle poursuit l'œuvre de son mari. Elle fait construire un nouveau manoir que les habitants surnomment « le château Masson »…, le bureau seigneurial d'où Germain Raby peut administrer les affaires de la seigneurie et demeurer avec sa famille ainsi que le moulin neuf qui devient l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du Bas-Canada.
La nouvelle seigneuresse fournit également les pierres et le terrain pour la construction d'une nouvelle église pouvant accueillir tous les habitants. De plus, elle achète un bateau à vapeur, le Terrebonne, pour assurer le transport des marchandises, du bétail et des passagers jusqu'à Montréal. Elle fait aussi construire un chemin pavé aujourd'hui appelé la Montée Masson.
C'est sous le règne de cette grande dame que le régime seigneurial est aboli en 1854… mais Geneviève-Sophie Raymond Masson reste à jamais la dernière seigneuresse de Terrebonne.
Prochain article : Emma Lajeunesse

- Au jour le jour, février 2004
Ces femmes de La Prairie et ses environs. 1re partie : Denise Lemaitre (1636-1691)
Comme promis dans le Au jour le jour de janvier 2004, j’entame une série d’articles qui porteront sur des femmes, qui de La Prairie, qui des environs, ont fait parler d’elles. Si nous commencions par…
Denis Lemaitre, de Paris, rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul est veuf de Catherine Deharme. Il se voit donc contraint de placer à l’hôpital de la pitié, dès son bas âge, leur fille Denise Lemaitre.
Fille du Roi, âgée de 22-23 ans, Denise Lemaitre arrive en Nouvelle-France à bord du Saint-André (1659) sous la protection de Jeanne Mance. Tout d’abord promise à André Heurtebise, (ce dernier meurt à la suite de ses blessures lors d’un combat avec les Iroquois) elle épouse Pierre Perras/Lamontagne, tonnelier, le 26 janvier 1660. Malheureusement, ce dernier décède peu après. Denise Lemaitre se retrouve veuve avec huit enfants vivants (deux sont morts en bas âge).
Une femme ne reste pas seule très longtemps à cette époque; question de survivre, on ne peut se le permettre. Quelques mois plus tard, elle convole avec François Cahel (Caël). Celui-ci meurt trois ans plus tard. Elle ne contractera pas d’autres mariages.
Veuve, même avec les biens acquis de son mariage avec Pierre Perras, et avec tous ses enfants, elle doit améliorer leur sort à tous. C’est alors qu’elle se lance dans le commerce avec les Indiens (fort probablement les Iroquois chrétiens de la côte Sainte-Catherine) échangeant ainsi des marchandises contre des peaux de castors. Nous sommes en 1671 environ. Grâce à ce commerce, Denise Lemaitre Perras augmente considérablement le rendement familial. On retrouve là une femme de caractère.
Sage-femme, titre acquis à l’hôpital de la pitié à Paris, et respectée par ses consœurs de La Prairie, elle marque encore notre histoire… « Est-ce dû à son habileté ou à la meilleure santé de nos premiers ancêtres? Toujours est- il qu’on ne rencontre pas de son temps, dans les registres de Laprairie, de ces décès qui endeuilleront trop souvent nos annales… Confidente des mères dans leurs joies et leurs douleurs, liée à leurs familles… Denise joua donc un rôle de premier plan parmi la population primitive de notre petite ville. Pierre Rafeix, Le Richelieu, le 14 mai 1936, p. 4. »
Je termine en citant L’Abbé Groulx, qui lui-même citait cette parole de Michelet à propos de Jeanne d’Arc, « Souvenons-nous toujours que la patrie, chez nous est née du cœur d’une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu’elle a versé pour nous. ».
Elle est tuée par des Iroquois à la côte Saint- Lambert le 29 octobre 1691 et est inhumée le lendemain; elle a 55 ans.
Sources :
(1) Pierre Rafeix, Le Richelieu, le 14 mai 1936, p. 4
– Fonds Élisée Choquette SHLM
– Robert Prévost, Québécoises d’hier et d’aujourd’hui, éd. Alain Stanké
– Mme Gertrude Dumas de la Société d’histoire Mouillepied
– Archange P. Godbout, O.F.M., Passagers du Saint-André, La Recrue de 1659
Prochain article : Sophie Raymond-Masson

- Au jour le jour, janvier 2004
Gens d’ici
Gens d’ici…
Ce sont mes parents qui m’ont initiée à la généalogie. Ils ont fait ensemble leurs généalogies respectives. J’entrepris de faire la lignée directe de mes enfants. Pour rendre cela intéressant, il ne suffit pas de trouver des noms, il faut de l’histoire, et c’est là que l’aventure commence.
Les premiers de la lignée qui ont foulé le sol de la Nouvelle-France, je les appelle les 1ers grands-parents, je me sens plus proche d’eux de les appeler ainsi.
La généalogie de mes parents c’est aussi la mienne; à celle-ci s’ajoute celle de mes enfants du côté de leurs pères. J’ai quatre enfants, issus de deux unions. Les deux plus vieux portent le nom de Cormier et les deux plus jeunes le nom de Cardinal.
En principe les arbres généalogique se montent à partir du nom de famille paternel, j’ai presque le goût de faire l’inverse (la contradiction c’est un trait de caractère chez ……oups! côté paternel ou côté maternel?). En faisant des recherches sur ces deux familles je me suis aperçue que le côté maternel apportait un potentiel fort intéressant. C’est ce qui m’a amené à écrire cette petite série articles que je vous présente.
Je crois important de souligner l’apport féminin dans l’histoire. C’est pourquoi j’ai extrait du livre de Monsieur Robert Prévost Québécoises d’hier et d’aujourd’hui, par Robert Prévost, éd. Alain Stanké. (qui m’a gentiment été prêté par Madame Dumas que je salue) pour vous l’histoire de femmes qui ont marquées, d’une façon ou d’une autre, La Prairie.
Il vous faudra cependant attendre le prochain numéro, pour l’instant, je tenais tout simplement à me présenter. Peut-être que certains ou certaines d’entre vous font partie de nos familles. Faites le moi savoir.
Mon père : Jean Girard
Ses parents : L.-Joseph Girard m. Anna Juneau
L’ancêtre Girard : Cornius Renelle??? marié Marguerite Semet
L’ancêtre Juneau : Jean-Pierre Jouineau marié Madeleine Duval
Ma mère : Pauline Forgue
Ses parents : Rémi Forgue et M-Thérèse Duclos
L’ancêtre Forgues : J-Pierre Forgue/Monrougeau m. Marie Robinau
L’ancêtre Duclos : Antoine Desclaux marié Marguerite Guay
Mes enfants :
1ère union : Pascal et Geneviève Cormier
Leur père : Luc Cormier
Ses parents : Gilles Cormier et André Longtin
Au début des Cormier : Thomas Cormier marié Magdeleine Girouard
Au début des Longtin : André Longtin marié Jeanne-Angélique Brière
Mes enfants :
2ième union : François et Rachel Cardinal
Leur père: André Cardinal
Ses parents : Florent Cardinal et Estelle Robert
Au début des Cardinal : Simon-Jean Cardinal marié Michèle Garnier
Au début des Robert : André Robert marié Marguerite Dania

- Au jour le jour, octobre 2003
Appel à tous
Je recherche le mariage de Éléonore Sicotte avec Paul Robert, de Saint-Philippe. Les parents de Robert sont Paul Robert m.10-10-1831, St-Philippe à Catherine Circé et les parents d’Éléonore sont Jean-Baptiste Chicote m.07-06-1829 St-Philippe à M-Louise Robert. Ils ne sont pas au registre de Saint-Philippe.
courriel : [email protected]

