Au jour le jour, décembre 2008

Le 30 septembre dernier, la SHLM s’est abonnée à la section « monde » du site www.ancestry.ca. Cet abonnement d’un an donne accès à des banques de données généalogiques du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Irlande, de certains autres pays d’Europe (Allemagne, France, Italie…) et de l’Australie.
Le site offre plus d’une centaine de banques de données d’intérêt général (les recensements de 1790 à 1930 aux États-Unis par exemple) et quelques banques de données liées à des besoins plus précis (une liste de soldats de la guerre civile américaine par exemple).
Je vais vous décrire les trois banques de données qui me sont les plus souvent utiles lorsque je fais des recherches généalogiques concernant une famille canadienne-française catholique.
A) LES ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Lorsque vous ouvrez une session sur le site, vous pouvez bâtir votre arbre généalogique au fur et à mesure en utilisant le site comme s’il s’agissait d’un logiciel de généalogie. Vos données, à moins de cocher la case « arbre privé » lors de sa création, seront par la suite accessibles à tous les abonnés d’Ancestry.
Si vous cherchez une personne en particulier, il s’agit d’ouvrir le moteur de recherche de la section « arbres généalogiques » et vous pouvez alors chercher parmi tous les arbres contenant le nom de votre ancêtre. Vous pouvez aussi consulter le « One World Tree » ou « Arbre mondial » qui contient la synthèse de tous les arbres généalogiques qui sont en ligne depuis 10-15 ans.
J’aimerais faire toutefois une mise en garde : les données que vous allez trouver sur l’arbre d’un membre ou sur « L’Arbre mondial » contiennent souvent des erreurs (je nomme ces erreurs « l’effet copier/coller »). Par exemple, si l’aîné d’une famille se nomme Antoine-Amable et que le benjamin se nomme Antoine, il est possible que le site n’offre qu’une seule personne répondant au nom d’Antoine, comme s’il s’agissait d’une seule et même personne.
J’ai donc adopté la bonne habitude de vérifier avec le PRDH ou avec le Fonds Drouin numérisé toutes les informations recueillies sur l’arbre généalogique d’un autre abonné.
B) LE FONDS DROUIN
L’institut Drouin a mis sur microfilms l’ensemble des registres paroissiaux des églises catholiques du Québec et de l’Ontario entre 1941 et 1967. Ces registres étaient disponibles aux archives nationales. En 2006, Ancestry.com a fait l’acquisition du fonds Drouin et en a fait la numérisation. Chaque page de chaque registre de paroisse est maintenant disponible dans la section « Actes d’état civil et registres d’église du Québec (Collection Drouin) 1621 à 1967 ».
Cette section est une véritable mine d’or pour un chercheur car elle possède son propre moteur de recherche et vous pouvez chercher votre ancêtre selon les critères de votre choix. Par exemple, j’étais à la recherche du baptême de Amable Raby (mon arrière-grand-père). Dans les cases appropriées, j’ai inscrit son prénom, son nom, la paroisse et l’année de sa naissance. Je me suis rendu compte que mon ancêtre était unique car un seul nom m’a été suggéré : Amable Raby né et baptisé à Buckingham le 14 mai 1885. Le site me propose un lien vers une page numérisée et en y accédant j’obtiens le texte complet de l’acte de baptême en question.
Petit truc de chercheur : souvent, à la fin de chacune des années d’un registre, le curé de l’époque a résumé son année en produisant un index alphabétique; classant les baptêmes, les mariages et les sépultures en ordre alphabétique. Allez directement à la dernière image de l’année de votre recherche pour d’abord consulter cet index.
Mise en garde : vous pouvez agrandir l’image des pages obtenues et jouer avec la luminosité mais plusieurs images ont été mal photographiées en 1941 et/ou le prêtre écrivait de manière quasi illisible. Dans plusieurs cas, je n’ai pas été en mesure de déchiffrer ou de lire correctement le texte de l’image. Selon mon expérience, entre 1 et 5 % des images sont illisibles, ce qui donne quand même un ratio de plusieurs belles découvertes pour quelques déceptions.
Il ne faut pas se décourager lorsque l’on cherche une personne avec ce moteur de recherche. L’orthographe du nom obtenu dépend du nom inscrit dans la marge à l’époque par le prêtre officiant. De plus, comme Ancestry est un site anglophone, il y a hélas plusieurs erreurs de retranscription de noms. J’ai souvent retrouvé des Raby classés comme des Roby ou même des Aubry.
C) LES RECENSEMENTS
Avec la permission des gouvernements concernés, Ancestry a mis en ligne toutes les images numérisées des recensements des États-Unis et du Canada. La loi au Canada étant plus stricte (délai d’attente de 90 ans vs 70 ans pour les États-Unis), il y a plus de données pour les chercheurs qui s’intéressent à leurs ancêtres qui ont opté pour l’exil vers les États-Unis. Voici la liste de ce qui est disponible :
Canada : Recensements de 1851, 1891, 1901 et 1911 (1881 est en ligne (site fédéral) pas encore sur Ancestry). Le recensement de 1921 sera publié en 2111.
États-Unis : Recensements de 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1900, 1910, 1920 et 1930 (1890 détruit par un incendie). Le recensement de 1940 sera publié en 2010.
Les recensements vous permettent de savoir où habitaient exactement vos ancêtres. De plus, les recensements sont très utiles pour obtenir une foule de renseignements socio-économiques : vos ancêtres savaient-ils lire et/ou écrire? Quel était leur revenu annuel? Quel genre de maison habitaient-t-ils? Avaient-t-ils des domestiques ou prenaient-ils soin de leurs aînés?
Mise en garde : avec le moteur de recherche de cette section, ne vous attendez pas à trouver votre ancêtre facilement. Un peu comme dans le cas de la banque de données du fonds Drouin, il vous faudra compter beaucoup d’essais et d’erreurs avant de retracer votre ancêtre, surtout s’il vivait aux États-Unis. Mon arrière-grand-père Napoléon Tremblay a vécu à Cohoes NY entre 1872 et 1882. Je l’ai retrouvé dans le recensement de 1880 sous le nom de « Napolian Trumbly ».
La SHLM invite ses nombreux membres à venir faire des recherches (gratuitement) en ligne sur ce site lors des heures régulières d’ouverture et lors des réunions du club de généalogie les lundis soirs entre 19 h et 21 h.

Nous sommes en 1842. Vous habitez les environs de La Prairie et vous cherchez un magasin général où vous pourrez acheter quelques articles. Étant récemment établi dans la région, vous ne savez trop où aller.
Pas de problèmes : il faut vous rendre sur la rue Sainte-Marie. Pourquoi? Simple : on compte pas moins de dix (10) magasins généraux sur cette rue; vous y trouverez sans doute ce que vous cherchez.
Et si tel n’était pas le cas, tournez sur Saint-Joseph La rue Saint-Joseph deviendra plus tard la rue Saint-Georges., au bout de Sainte- Marie, vous y verrez deux autres magasins. En désespoir de cause et si vous n’êtes pas superstitieux, il en existe un treizième devant l’église, à l’autre bout de Sainte-Marie!
Treize magasins généraux à La Prairie? Vous ne me croyez pas? Je vais vous en donner les noms :
Sur la rue Sainte-Marie :
Bourassa, J. B. V.,
Charlton, John, & Co.,
Dupré, J. B. E.,
Dupré, A. E.,
Hébert & Couturier,
Hébert, J. A.,
Lacombe, C.,
Lanctôt, J. B.,
Powell, A. H.,
Sauvageau, A.,
Sur la rue Saint-Joseph (plus tard Saint-Georges) :
Sainte-Marie, Pierre,
Thomson, John, & Co. Voir La monnaie de John Thomson, Au Jour le jour, Octobre 2008, p. 2.
Sur la place du Marché : Probablement celle en face de l’église; elle a existé comme telle jusqu’aux environs de 1840.
Gariépy, D.
Voici le meilleur trajet pour vous y rendre.
Quand vous arrivez par le chemin de Saint-Jean, passez devant notre toute nouvelle église La nouvelle église de la Nativité, construite en 1840 et 1841. que vous ne manquerez sûrement pas d’admirer puis, tournez à votre gauche à la première rue.
Voilà; vous êtes sur la rue Sainte-Marie. Vous ne pouvez pas la manquer!
Sachez bien que je n’ai pas inventé tout ça pour faire mon Ti-Jos connaissant. Je l’ai lu dans le bottin des professionnels et hommes d’affaires de La Prairie, publié par Lovell. BANQ, Lovell’s Directory, 1842, Montréal et sa banlieue, La Prairie, pp. 264-266.
À vrai dire, c’est en anglais avec quelques fautes d’orthographe dans certains noms francophones mais, ça n’empêche pas de les reconnaître.
Le titre exact est « Lovell’s Business and professional directory for Laprairie (1842) » Et nous sommes bien en 1842, n’est-ce pas?
Maintenant que vous savez tout, je vous souhaite un bon magasinage et je demeure à votre disposition pour toute autre information.

Une autre année qui s’achève et dans quelques jours les réjouissances du temps des Fêtes.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler que c’est le temps de renouveler votre carte de membre et pour une deuxième année, nous vous invitons à participer à la campagne de financement de votre Société d’histoire dont l’objectif est de 2 000 $ pour l’année 2009.
Déjà à l’automne notre premier souper bénéfice générait plus de 1200 $ en gains, sans compter nos ventes de livres usagés de juin et de novembre qui ont rapporté au total plus de 5 000 $.
Ce sont ces moyens qui permettent à votre Société de s’autofinancer et d’ainsi réaliser divers projets. Voilà pourquoi je tiens à remercier tous nos bénévoles qui travaillent avec ardeur à la réussite de ces activités.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter au nom du conseil d’administration et en mon nom de très JOYEUSES FÊTES, santé et prospérité.
René Jolicoeur, président.

Desjardins Caisse La Prairie
Les responsables de Desjardins Caisse La Prairie remettaient récemment à la SHLM un chèque de 3 500 $. Cet argent est destiné à l’achat d’un nouveau serveur pour notre réseau informatique interne ainsi qu’à l’impression couleur du bulletin mensuel Au jour le jour. Ce généreux don de la Caisse s’ajoute à une série de dons antérieurs qui ont permis à la SHLM de moderniser son matériel de production et de diffusion. Sur la photo on reconnaît dans l’ordre habituel : M. Denis Sénécal directeur, M. René Jolicoeur président de la SHLM et M. Robert Clermont président du CA de Desjardins Caisse La Prairie.

Aide financière
La SHLM était fort heureuse de recevoir récemment un chèque de 2 500 $ du Tournoi de golf de la mairesse parrainé par la Fondation Guy Dupré. Voilà une agréable façon d’encourager l’œuvre
des bénévoles de notre Société d’histoire. Sur la photo, de gauche à droite : M. Guy Dupré, M. René Jolicoeur et Mme Lucie Roussel.

Vol d’une plaque de bronze
Au début du mois de novembre des individus se sont emparé de la plaque de bronze qui ornait le cairn commémoratif situé à l’angle du chemin de Saint-Jean et du rang de la Bataille Nord. Ce vol s’inscrit dans une longue série de méfaits qui perdurent depuis quelques années au Québec. Des dizaines de statues, de plaques, de croix et autres objets de bronze ont été volés à travers la province. Récemment à Longueuil une statue qui avait coûté 25 000 $ est disparue. Pourra-t-on bientôt mettre fin à cette destruction de notre patrimoine?

Nouveaux membres
La SHLM est heureuse de souhaiter la bienvenue à trois nouveaux membres :
337 Gosselin, Denise
338 Colpron, Pierre
339 Livernois, Roger

Éditeur
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
COLLABORATEURS :
Coordination : Jean-Pierre Yelle
Rédaction : Gaétan Bourdages, René Jolicoeur, Jean Joly et Stéphane Tremblay
Révision : Jean-Pierre Yelle
Infographie : François-Bernard Tremblay, www.bonmelon.com
Impression : SHLM
Siège social
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Téléphone
450-659-1393
Courriel
Site Web
www.laprairie-shlm.com
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.
La Caisse populaire de La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, novembre 2008

Pour connaître ses ancêtres il suffit de dresser son arbre généalogique à partir du mariage de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents. Cette tâche laborieuse et complexe il y a quelques décennies est maintenant grandement facilitée par la disponibilité de nombreuses banques de données tant sur internet que sur CD. La mise sur pied de ces registres informatisés a été rendue possible grâce à l’existence sur le territoire québécois de centaines de milliers d’actes de baptême, de mariage et de décès : les missionnaires et les prêtres notaient tout.
Des sites comme celui du PRDH (Programme de recherche en démographie historique) de l’Université de Montréal, FrancoGène ou encore Ancestry permettent de retracer nos ancêtres jusqu’aux premiers qui se sont installés en Amérique du Nord. Les plus curieux pourront même remonter plus loin en consultant les archives départementales de France ou d’ailleurs selon l’origine de leurs ancêtres.
Sauf de très rares exceptions, il est inhabituel que la recherche généalogique nous permette de remonter au-delà du 16e siècle. Bien sûr si vous comptez parmi vos ancêtres Jean-Baptiste Desrosiers dit Dutremble de Trois-Rivières vous pouvez retracer ses ancêtres de la noblesse française jusqu’à Charlemagne roi des Francs et empereur d’Occident au 8e siècle. Mais dans la très grande majorité des cas vous devrez vous limiter à deux ou trois générations en France. Le nombre de nos ancêtres connus ou prétendus est donc minime par rapport au nombre réel d’ancêtres qui nous ont précédés depuis la nuit des temps.
Il faut également être conscient que la recherche en archives renferme ses pièges et ses limites. Une généalogie peut être incorrecte parce que basée sur de nombreuses erreurs cléricales, un ancêtre a pu être confondu avec un autre ou simplement omis. Que dire des adoptions non mentionnées ou des enfants nés hors mariage? Il est aussi tentant de se fier à des généalogies déjà établies par des amateurs parfois peu rigoureux dans leurs recherches : les erreurs se multiplient et se répètent. Mieux vaut tout vérifier.
Plusieurs trouvent encore de bon ton lors de rencontres familiales de brandir, parfois à tort, leurs origines amérindiennes, irlandaises, germaniques ou autres. Les preuves de ces lignées paternelles ou maternelles sont souvent difficiles à établir de façon certaine. C’est alors que la généalogie génétique vous propose des réponses basées sur une démarche scientifique.
L’ADN est le sigle de l’acide désoxyribonucléique caractéristique de nos chromosomes qui sont le support de toute notre information génétique ou génome. Quelle que soit votre généalogie établie à partir des archives, l’analyse de votre ADN ne peut mentir. Tout en validant les résultats de vos recherches vous apprendrez rapidement d’où venaient vos lointains ancêtres : Europe, Afrique, Asie etc. Peut-être découvrirez-vous que vous n’êtes pas le descendant biologique de l’ancêtre que vos travaux désignaient jusqu’alors.
La procédure de cueillette d’un échantillon est simple : le test est fait à partir de cellules prélevées dans la bouche à l’aide d’un coton-tige que l’on frotte à l’intérieur des joues. Selon l’analyse requise (ADN autosomal ou mitochondrial) et le nombre de marqueurs génétiques il vous en coûtera entre 100 $ et 300 $ pour l’analyse.
« C’est en testant l’ADN autosomal (l’ensemble des chromosomes non sexuels contenu dans le noyau des cellules), que l’on peut connaître notre pourcentage de gène européens, amérindiens ou autre. Ce patrimoine, légué pour moitié par notre père, pour moitié par notre mère, forme le tableau […] des gènes légués par l’ensemble des aïeux de notre arbre généalogique et "rebrassé" à chaque génération. […] » Magazine Québec Science, Été 2008, page 42.
La généalogie génétique propose également un test d’ADN mitochondrial i.e. ce petit bout d’ADN légué intact par la mère à tous ses enfants. Cette analyse permet de reculer jusqu’à une ancêtre maternelle ayant vécu il y a parfois plus de 100 000 ans. Comme « les scientifiques étudiant les grandes migrations humaines ont en effet réussi à déterminer une trentaine de signatures génétiques (ou haplogoupes) à partir de l’ADN mitochondrial. Ces signatures indiquent dans quelle région du monde cette très vieille grand-maman a vécu. » Magazine Québec Science, Été 2008, page 42.
Pour en apprendre davantage vous devrez consulter le site internet du Projet ADN d’Héritage français (ADNHF) qui s’adresse à tous ceux qui pensent avoir des ancêtres français, même lointains (www.ADNHF.org). Ce projet, chapeauté par la société américaine Family Tree DNA, poursuit de nombreux objectifs dont un destiné au Filles du Roi et un autre relié aux soldats du Régiment de Carignan installés en Nouvelle-France.
Un peu comme le sont l’histoire et l’archéologie, loin de s’opposer, la recherche généalogique traditionnelle en archives et la généalogie génétique sont complémentaires et poursuivent une mission commune : nous permettre d’établir avec certitude les origines qui définissent ce que nous sommes et ce que seront nos descendants. Libre à vous d’y ajouter l’histoire familiale avec ses drames, ses traumatismes, ses joies et ses secrets enfouis. Mais attention vous n’êtes peut-être pas celui ou celle que vous avez toujours cru être…

Samedi matin, le 20 septembre, 32 représentants de 22 sociétés d’histoire de la Montérégie se sont réunis à Chambly suite à une invitation de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec.
Le président de la FSHQ, Richard Bégin, le président d’Édition Québec, Michel Pratt, la secrétaire du comité du patrimoine, Louise Chevrier ainsi que la secrétaire administrative de la FSHQ, Lyne Saint-Jacques nous ont reçus sous l’égide de l’équipe de Paul-Henri Hudon, président de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly. Jean L’Heureux et moi-même avons représenté la SHLM lors de cette première rencontre.
Un tour de table a rapidement fait comprendre l’urgence d’une table de concertation. Les attentes de chaque société ainsi que leurs activités habituelles nous ont à tous démontré la pertinence de cette table. Une première demande est la production d’un répertoire des divers conférenciers qui présentent leurs travaux ici et là en Montérégie. Ceci permettra aux autres sociétés de garnir à l’avance leur calendrier des conférences pour les années à venir. De plus, l’échange de nos revues mensuelles, trimestrielles ou annuelles serait bienvenu car il permettrait le partage d’informations.
Le mode de financement a également fait l’objet de discussions animées. Si c’est très difficile pour certains, pour d’autres cela semble d’une facilité déconcertante. Une société mentionnait que les élus de la municipalité leur étaient pratiquement opposés mais qu’à la suite d’une rencontre très directe avec le président de la Société en question, l’avis des échevins avait changé du tout au tout. De rébarbatifs, ils sont devenus coopératifs et même attentionnés. Il y a aussi diverses façons d’aller chercher des fonds, souvent dans des endroits quasi ignorés. Par exemple le fonds d’aide aux activités agricoles possède un volet culturel qui n’est pratiquement jamais sollicité. Même si les sommes ne sont pas toujours présentées aux budgets, elles sont disponibles sur demande. Il n’y a pas que les organismes publics qu’il faut contacter, les compagnies locales peuvent également donner un coup de main lors de certaines activités.
J’ai proposé aux personnes présentes d’organiser des stages de formation pour notre logiciel Archi-Log. Plusieurs ont exprimé leur désir d’y assister.
Cette table de concertation serait surtout un lieu d’entraide et d’information. Comment une société de quelques dizaines de membres réussit-elle à publier une revue trimestrielle? Pourquoi deux sociétés d’histoire ont-elles fusionné certaines de leurs activités afin de survivre tout en demeurant autonomes? C’est par l’entraide et l’information que nous aurons un avenir.
Le temps nous a manqué pour se doter de structures immédiatement. C’est donc lors de la prochaine rencontre au printemps 2009 que nous pourrons mettre sur pied les statuts de la table de concertation.

Avant l’arrivée de la saison froide votre comité de la vente de livres vous propose à nouveau des livres usagés de très belle qualité. Voilà une occasion en or de faire provision de lecture pour l’hiver.
Romans québécois et étrangers, littérature jeunesse, biographies, livres de cuisine etc. vous sont offerts à des prix avantageux selon l’horaire suivant :
Au local de la SHLM du lundi 17 novembre au jeudi 11 décembre (lundi de 19 h à 21 h et mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 17 h).
Acheter un livre usagé c’est aussi poser un geste pour la protection de l’environnement.
Invitez vos parents et amis! Et bonne lecture!

Notre prochaine conférence
Mardi le 21 novembre 2008 à 19 h 30
Louis-Joseph Papineau sous un nouveau jour par Yvan Lamonde.

Son exposé nous fera voir Louis-Joseph Papineau sous un nouveau jour quant à son nationalisme ou à sa vision très contemporaine d’une fédération continentale. À la fois un héros et un oublié de l’histoire du Québec. Bouc émissaire des insuccès des Patriotes et des Québécois, il a laissé peu de traces après 1850. C’est l’édition de sa correspondance qui permet de voir aujourd’hui l’homme différent de celui que la mémoire a construite pour servir ses intérêts divers.
Invitez vos parents et amis; entrée 3 $ pour les non membres.


Membre honorée
À l’occasion de son souper bénéfice du 18 octobre dernier la SHLM était heureuse d’honorer Mme Geneviève Dumouchel à titre de bénévole ayant contribué à l’essor de la Société d’histoire de façon exceptionnelle au cours de l’année 2008.
Une soixantaine de convives participaient à ce repas animé au cours duquel 15 prix furent tirés qui firent autant d’heureux. Merci aux personnes présentes pour leur appui indispensable et un merci particulier à Mme Hélène Létourneau pour son travail de sollicitation auprès des commanditaires.
Nouveaux membres
La SHLM est heureuse de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux membres :
331 Crépeau, Nicole
332 Brault, Venant
333 Bilodeau, Anita
334 Mercier, Luc
335 Chabot, Guy
336 Beaudry, Guy

Éditeur
Société d’histoire de
La Prairie-de-la-Magdeleine
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
COLLABORATEURS :
Coordination : Jean-Pierre Yelle
Rédaction : Gaétan Bourdages et Jean-Marc Garant
Révision : Jean-Pierre Yelle
Infographie : François-Bernard Tremblay, www.bonmelon.com
Impression : SHLM
Siège social
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Téléphone
450-659-1393
Courriel
Site Web
www.laprairie-shlm.com
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.
La Caisse populaire de La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, octobre 2008

Après la monnaie de François Plante, décrite dans le bulletin de novembre 2007, voici maintenant celle de John Thomson. Cet autre marchand de La Prairie, à l’instar de son confrère commerçant, utilise le même stratagème pour pallier à la pénurie de petite monnaie.
Nos lecteurs se souviendront que la crise financière de l’époque avait fait en sorte que les banques avaient suspendu leurs paiements et que les petits épargnants ne pouvaient plus retirer leurs économies. Les deux marchands de La Prairie ont choisi d’émettre des billets payables éventuellement au porteur, une fois la crise réglée, faut-il préciser.
Le billet ci-dessous, ou bon de marchand, vaut 30 sous ou 15 pence. Il a été émis par John Thomson, le 20 décembre 1837 à La Prairie et imprimé par Adolphus Bourne. On y voit au centre une pièce de monnaie coiffée de l’inscription « Quarter dollar ». Mais comment concilier tout cela?
En 1837, la monnaie canadienne n’existe pas et plusieurs devises circulent au Bas-Canada : la livre française, la livre anglaise, le dollar américain et même la piastre d’Espagne qui provient des colonies espagnoles.
La piastre d’Espagne et le dollar américain sont au pair et valent 6 livres françaises de 20 sous, soit 120 sous. Le billet de trente sous vaut donc un quart de piastre, ou un quart de dollar.
De son côté, la livre anglaise de 20 shillings de 12 pence, soit 240 pence, vaut 4 piastres d’Espagne. On compte donc 60 pence dans une piastre et 15 dans un quart de piastre, comme l’indique bien le billet de Thomson.
Voilà trois façons identiques de nommer une même valeur. Sur cet aspect, la monnaie de Plante demeure championne avec ses cinq nomenclatures. Par contre, celle de Thomson affiche une particularité intéressante : la pièce au centre de son billet ressemble étrangement à l’endos d’une piastre d’Espagne, à un détail près. La piastre espagnole qui circule alors au Bas-Canada est en réalité une pièce de 8 réaux, alors que celle affichée en est une de 2 réaux, soit un quart de piastre. Le compte est bon!
C’est Monsieur André Montpetit, président de l’Association de Numismatique et de Philatélie de Boucherville, qui nous a signalé ce bon de marchand apparaissant dans un catalogue de Charlton Standard.
John Thomson possédait un magasin général à La Prairie. Dans les années 1830 et 1840, il effectue plusieurs transactions immobilières sur divers lots du village. En 1837, il détient un terrain donnant sur la rue Saint-Joseph, situé derrière l’emplacement occupé de nos jours par les locaux de la Société d’histoire. Dans le bottin des professionnels et hommes d’affaires de 1842, son commerce a pignon sur la rue Saint-Joseph, devenue aujourd’hui Saint-Georges. Il exploite son entreprise sous la raison sociale de « John Thomson and Company » et est associé à John Dunn. Au recensement de 1852, tous deux habitent le village, se disent marchands, nés en Écosse et de religion baptiste. En 1861, John Thomson, alors âgé de 58 ans, demeure encore au village et se déclare toujours commerçant.
Thomson devient donc le deuxième marchand de La Prairie à émettre des billets payables au porteur, le 20 décembre 1837, après Plante, les 26 août et 1er septembre. Il faut croire que la formule avait du succès !
Sources :
BANQ, Annuaire Lovell, Montréal et sa banlieue, 1842, Business and professional directory.
JOLY, Jean, La monnaie de François Plante, Au jour le jour, vol. XIX, no 9, novembre 2007.
SHLM, ibidem, Le Bulletin, ANPB, vol. 41, no 4, novembre 2007
Musée de la monnaie, http://www.museedelamonnaie.ca/fre
Recensement de 1852, http://automatedgenealogy.com
Recensement de 1861, http://collectionscanada.ca
SHLM, Fonds des Jésuites, chemise 4.01.08

Au début de juillet 2007, je suis devenu membre de la SHLM afin d’entreprendre des recherches généalogiques sur la famille Raby et plus spécifiquement sur mon arrière-grand-père Amable Raby (1885-1966). Amable ou L’Amable (surnom) est le grand-père maternel de ma mère.
Durant mes vacances de juillet et août 2007, (je suis enseignant en histoire au secondaire) j’ai travaillé avec l’aide de M. Jean L’Heureux et de Mme Édith Gagnon sur mon arbre généalogique à raison de trois à quatre après-midi par semaine. À la fin de l’été 2007, lors d’un rassemblement de la famille Raby à Aylmer, je faisais la promesse de publier mes recherches lors de la prochaine rencontre de famille en 2008.
À l’automne de 2007, je suis devenu bénévole en généalogie pour la SHLM dans le cadre des soirées généalogiques animées par M. L’Heureux les lundis soirs. J’ai pu rencontrer, durant ces soirées, plusieurs membres et bénévoles de la SHLM avec qui j’ai pu partager ma passion et les grandes lignes de mon projet sur les Raby de Buckingham.
En mars 2008, suite à l’assemblée générale de la SHLM, je suis devenu secrétaire du C.A., poussant ainsi un peu plus loin ma démarche historique et généalogique au sein de ma communauté. Avec les autres bénévoles et membres du C.A., je fais maintenant des recherches pour les citoyens qui ont des demandes ou des questions concernant l’histoire de La Prairie.
Durant mes vacances de juillet et de août 2008, j’ai passé la plupart de mes temps libres à la SHLM à faire des recherches avec Mme Édith Gagnon, M. Jean L’Heureux , M. Jean-Marc Garant, Mme Geneviève Dumouchel et les quatre guides étudiants embauchés pour l’été. Je conserve d’excellents souvenirs de cet été 2008 au cours duquel j’ai pu enfin terminer mon projet généalogique sur Amable Raby.
J’ignorais à peu près tout de la vie de mon arrière-grand-père (il est mort un an avant ma naissance). En voici un court résumé : né à Buckingham en 1885, fils de Moïse Raby et d’Élisabeth Foubert, Amable, a suivi son cours primaire à l’école des Frères de l’instruction chrétienne de Buckingham. Il a terminé son cours primaire en 1895 et il fait partie de la première cohorte ayant gradué à Buckingham avec les FIC.
En 1911 Amable épousait à Buckingham Émilia Lachance. Émilia était la fille de Pierre Lachance et de Julienne Campeau. Entre 1911 et 1917, Amable a travaillé pour l’Algoma Central Railway. Il était responsable du transport des billes de bois coupées dans le nord de l’Ontario et qui étaient acheminées par train jusqu’à Sault-Sainte-Marie.
De 1917 à 1933, Amable Raby est devenu le contremaître du camp de bûcherons de Pukaskwa sur le lac Supérieur en Ontario. Il partait à la fin de chaque été avec sa famille, prenant le train de Buckingham à Sault-Sainte-Marie et par la suite un bateau jusqu’à Pukaskwa. La famille Raby revenait à Buckingham à la fin du printemps. Émilia ne faisait pas le voyage lorsqu’elle était enceinte. Les 10 enfants d’Amable et d’Émilia ont tous été élevés à Pukaskwa.
Le crash boursier de 1929 fut à l’origine de la grande dépression économique un peu partout en Amérique du Nord. La compagnie de coupe de bois qui employait Amable, l’Abitibi Water and Paper, se vit forcée de fermer la plupart de ses chantiers et Amable se retrouva sans emploi. Il revint à Buckingham et se trouva un nouvel emploi comme policier en 1934.
Dans les années 1940, il devint chef de police de Buckingham jusqu’à sa retraite en 1950. Après une retraite de 16 ans durant laquelle il aimait parler à ses nombreux petits enfants réunis autour de lui le soir près du poêle à bois (il était un conteur de légendes très apprécié), il meurt à l’hôpital de Buckingham en 1966 des suites d’un cancer.


À ne pas manquer. Et oui! Membre de la SHLM depuis plusieurs années et m’intéressant à la généalogie j’ai décidé de créer mon site internet. Il y est question de mes débuts en généalogie et de mon père Jean Girard que certains d’entre vous avez bien connu. Si vous vous appelez Cormier-Cardinal-Longtin-Robert-Pellerin ou Duval vous êtes probablement parents avec mes enfants et mes petits-enfants. Si vous vous appelez Forgue-Duclos (ancêtre André Duclos marié Marie Hondarague) vous êtes probablement parents avec ma mère. Si vous êtes des ancêtres de Jacques Renel/Lebrun/Girard/Floridor là vous êtes 100 % parents avec mon père et par le fait même, moi!
Il était une fois | Les lignées directes et les albums photos | Le mur des célébrités | Nos défunts | À la mémoire de mon fils | Les Armoiries | Extraits de MARTHA | Le coin des artistes | Des patronymes, des patronymes, des patronymes (ce dernier titre vous permet même de participer si vous le désirez)
http://pages.videotron.com/renelle/


La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine publie depuis plus de quinze ans un bulletin mensuel de huit pages destiné aux membres et aux visiteurs. Compte tenu de l’évolution fulgurante dans le domaine des médias depuis une décennie et afin de maintenir son image de marque, la SHLM souhaite à l’avenir offrir à ses membres un bulletin couleur d’une facture plus moderne et plus conforme aux nouveaux « standards » de l’édition. Nous souhaitons également augmenter quelque peu le tirage afin d’offrir notre bulletin au grand public à la bibliothèque municipale. Cela permettrait de mieux nous faire connaître et éventuellement d’attirer de nouveaux membres.
La mise en page du nouveau bulletin sera assurée bénévolement par M. François B. Tremblay, infographiste professionnel. Vous comprendrez que l’impression couleur augmentera notre facture annuelle, c’est pourquoi nous vous proposons de recevoir le bulletin par courrier électronique (voir à ce sujet l’encart dans ce bulletin).
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Longue vie au nouveau « Au jour le jour ».
Gaétan Bourdages, responsable du bulletin

Notre prochaine conférence
Mardi le 21 octobre 2008 à 19 h 30
Le frère Marie-Victorin (Conrad Kirouac 1885-1944) et l’Odyssée de la Flore laurentienne par Lucie Jasmin.
En 1904, le frère Marie-Victorin, en compagnie de son érudit ami, le frère Rolland-Germain, va entreprendre ce voyage extraordinaire au cœur de sa Laurentie bien-aimée. Ceci afin de réaliser l’inventaire des plantes de la nation. Ce périple, devenu légendaire, fut accompli sous les auspices du savoir mais encore sous l’influence d’une certaine tournure d’esprit poétique.
Cette causerie, agrémentée de projections « Power Point », vous permettra de mieux connaître l’homme Marie-Victorin et le grand œuvre auquel il a consacré plus de vingt-cinq années de sa vie.
Invitez vos parents et amis; entrée 3 $ pour les non-membres.


• À la SHLM comme ailleurs c’est l’heure de la rentrée. Les comités s’activent et les projets mijotent. Afin de poursuivre sa mission la Société a besoin de bénévoles qui s’impliquent selon leurs disponibilités et leurs intérêts.
Vous trouverez ci-joint un questionnaire sur nos différents besoins, je vous invite à le compléter et à me le retourner.
• Sur ce même questionnaire, si vous souhaitez recevoir le bulletin Au jour le jour par voie électronique en format PDF à partir du mois de novembre, vous trouverez un coupon à nous retourner, soit par la poste ou par courriel.
• Suite aux travaux archéologiques de l’été dans les rues de l’arrondissement historique nous sommes à préparer une exposition de photos qui sera présentée de novembre à mai. Si vous souhaitez participer à ce projet contactez-moi. Merci de votre précieuse collaboration!

Éditeur
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
COLLABORATEURS :
Coordination : Jean-Pierre Yelle
Rédaction : Gaétan Bourdages, Jean Joly et Stéphane Tremblay
Révision : Jean-Pierre Yelle
Infographie : François-Bernard Tremblay, www.bonmelon.com
Impression : SHLM
Siège social
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Téléphone
450-659-1393
Courriel
Site Web
www.laprairie-shlm.com
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.
Au jour le jour, septembre 2008

De nombreux artefacts amérindiens ont été mis à jour : d’abondantes céramiques Meadowood datant d’au moins 4 500 ans avant aujourd’hui ainsi que des pointes de flèches typiques de l’Archaïque. Il s’agit des plus vieilles pointes de flèche jamais trouvées à La Prairie. On a également découvert un foyer amérindien rue Sainte-Marie, aussi une petite figurine en terre cuite qui aurait orné la base d’une pipe et qui suite à des échanges entre les groupes amérindiens proviendrait de la région des Grands Lacs.

Les sites fouillés abritent aussi des objets d’origine européenne. La rue Saint-Ignace a fourni un intéressant échantillonnage de la vie domestique au 17e siècle alors que sur la rue Sainte-Marie les artefacts de la vie domestique au 18e siècle s’y trouvaient en quantité appréciable.
La découverte de nombreuses bases de pieux ayant servi à ériger la palissade fortifiée est venue remettre en question le tracé déjà connu du fort original. Ces nouvelles données obligent à reformuler les hypothèses émises à ce jour. Il est certain que le périmètre réel du fort et son orientation diffèrent quelque peu du plan fait en 1704.

Inspirés par les résultats des fouilles effectuées il y a quelques années par l’archéologue François Grondin et en s’appuyant sur la plan établi par Charles Manuel en 1840, l’équipe de Brian Ross a également procédé à des sondages devant l’église actuelle afin de repérer de façon précise le périmètre de l’église de pierre construite en 1705. On peut désormais affirmer que, contrairement à ce qu’on avait toujours cru, le clocher de la première église de pierre n’était pas rattaché au bâtiment principal.
Enfin les archéologues ont poussé leurs observations jusque sur l’ancien site de Rose et Laflamme car il est éventuellement question d’y ouvrir l’ancienne rue Saint-Louis.
Bien qu’il ne s’agisse ici que de résultats préliminaires, on peut d’ores et déjà affirmer que la campagne de fouilles de l’été 2008 s’est avérée être des plus fructueuse. Le sous-sol du Vieux La Prairie est toujours aussi riche d’un immense potentiel archéologique.

Grâce à une subvention du gouvernement fédéral la SHLM a su profiter à l’été 2008 de la présence de quatre guides-étudiants.
On reconnaîtra dans l’ordre habituel : Marie-Pier Fullum Lavery, étudiante en droit, Nancy Lemieux, en histoire et civilisation au cégep, Olivier Jacques, chef guide et étudiant en administration à l’université, profil finance, et Samuel Castonguay, étudiant en sciences de la parole au cégep.

Bonjour chers membres.
Nous voilà déjà rendus presqu'à la fin de l'été et déjà que votre conseil s'affaire à préparer la rentrée avec la série de conférences à venir et l'exposition sur « L’ère des cageux » qui se termine fin septembre.
Nos étudiants, sous la supervision de Mme Gagnon, nous ont encore cette année présenté une pièce de théâtre impressionnante dans le cadre de Marcher dans l’ombre du passé.
Afin de faciliter la recherche en généalogie la SHLM sera d’ici la fin septembre abonnée à la banque de données Ancestry. Cet outil de travail informatisé s’ajoutera au PRDH et à La généalogie des Français d’Amérique du Nord de Denis Beauregard.
Nous avons reçu de nombreux courriels de félicitations de la part de citoyens de La Prairie au sujet de la brochure Maisons patrimoniales de La Prairie. Merci à M. Bourdages pour cette très belle initiative et pour son professionnalisme.
Au plaisir de vous rencontrer.
René Jolicoeur, président

Maisons patrimoniales
En juin dernier la SHLM distribuait dans 8 851 résidences de La Prairie une brochure couleur de 20 pages intitulée Maisons patrimoniales de La Prairie. L’objectif de ce document est d’informer la population de La Prairie sur l’existence de magnifiques demeures patrimoniales à l’intérieur du territoire de la ville, en dehors de l’arrondissement historique. Afin de sensibiliser les citoyens à l’importance de conserver et de protéger ces demeures exceptionnelles la SHLM leur propose un parcours leur permettant d’admirer 21 des 73 demeures patrimoniales recensées.
On peut se procurer des exemplaires de cette brochure au local de la SHLM au coût de 5 $ l’unité. Voilà un beau cadeau à offrir à des parents ou à des amis.

Nouveaux membres
En ce début d’une nouvelle saison d’activités la SHLM est heureuse de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux membres :
323 Tremblay, François-Bernard
324 St-Jean, Christine
325 Chapdelaine, Marie-Josée
326 Brosseau, Alain H.
327 Tremblay, Sylvain
328 Desourdy, Marylene
329 Fiske, Lorraine
330 Béliveau Johanne
Des descendantes de Aimé Guérin
Dans le cadre de l’exposition sur L’ère des cageux la SHLM a reçu deux visiteuses exceptionnelles au milieu du mois de juillet. Il s'agit de deux descendantes du cageux Aimé Guérin (la fille et la petite-fille de Laurette Guérin; Laurette Guérin étant une des filles d'Aimé Guérin): Mme Madeleine Monette, fille de Laurette Guérin et Mme Louise Faille, petite-fille de Laurette Guérin. Elles sont donc, respectivement, petite-fille et arrière-petite-fille d'Aimé Guérin. La photo a été prise avec leur permission lors de leur visite de l'exposition des cageux à la SHLM le 18 juillet dernier. Elles posent fièrement devant la photo de leur ancêtre Aimé Guérin, accompagnées de Samuel Castonguay, leur guide de la SHLM pour la journée.

Franc succès pour l’activité de financement « Vente annuelle de livres » de juin dernier
Par Hélène Létourneau, responsable du comité
Il fallait voir la salle d’exposition devenue une agréable librairie très bien organisée. Il y avait des trésors à découvrir tant en histoire que dans les autres catégories de livres. Pendant trois jours, les acheteurs s’en retournaient avec le sourire aux lèvres et les sacs remplis de livres. C’était beau à voir!

La « prévente » réservée à nos membres a été grandement appréciée. 40 % d’entre eux sont venus bouquiner et fraterniser tout en prenant vin et fromage. C’est une soirée à refaire!
Lors de la vente, il y a eu tirage de livres neufs. Voici les gagnants : R. Mailhot, M. McCollough, R. Leblanc, H. Gougeon, J. Desroches et E. St-Laurent.

C’est avec satisfaction que le comité organisateur a remis la somme de 2572,29 $ (profit net) aux membres du C.A. de la SHLM.
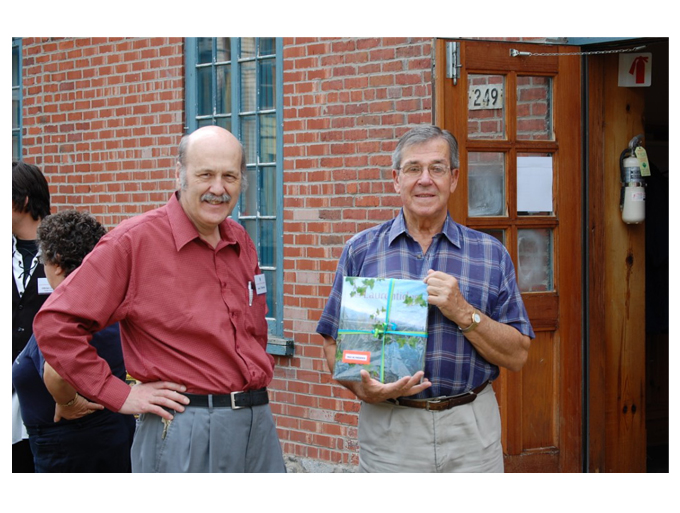
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette activité en étant bénévoles, donateurs, acheteurs… Merci à nos commanditaires : M. Jacques Vallée de IGA La Prairie et à la librairie Renaud-Bray. Nous aurons besoin de votre aide pour la prochaine vente de livres!
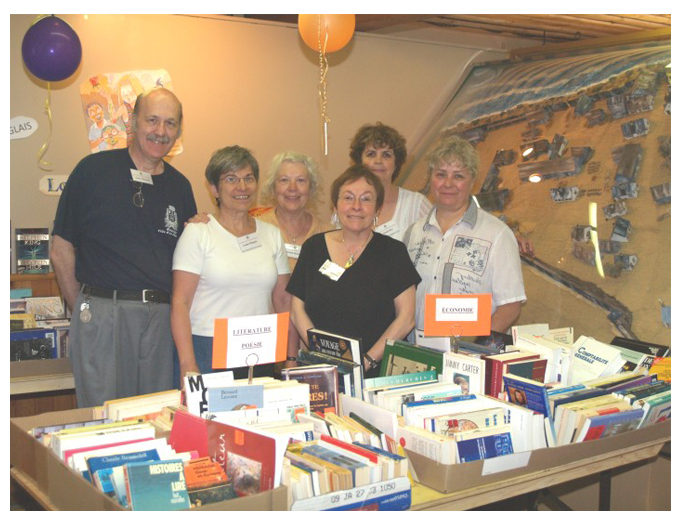

Voici le calendrier des conférences pour la prochaine saison. Toutes nos conférences débutent à 19 h 30 et se donnent à l’étage du Vieux Marché au 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Information : 450-659-1393
1. Le 16 septembre 2008 : L’ère des cageux par Éliane Labastrou de la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève.
Ces navigateurs intrépides qui, au XIXe siècle, sillonnaient fleuve, lacs et rivières sur d’immenses radeaux pour aller livrer de grosses billes de bois équarri au port de Québec. Un récit sur des hommes à l’esprit aventureux.

2. Le 21 octobre 2008 : Le frère Marie-Victorin (Conrad Kirouac 1885-1944) et l’Odyssée de la Flore laurentienne par Lucie Jasmin. En 1904, le frère Marie-Victorin, en compagnie de son érudit ami, le frère Rolland-Germain, va entreprendre ce voyage extraordinaire au cœur de sa Laurentie bien-aimée. Ceci afin de réaliser l’inventaire des plantes de la nation. Ce périple, devenu légendaire, fut accompli sous les auspices du savoir mais encore sous l’influence d’une certaine tournure d’esprit poétique. Cette causerie, agrémentée de projections lumineuses Power Point, vous permettra de mieux connaître l’homme Marie-Victorin et le grand œuvre auquel il a consacré plus de vingt-cinq années de sa vie.

Le 18 novembre 2008 : Louis-Joseph Papineau sous un nouveau jour par Yvan Lamonde. Son exposé nous fera voir Louis-Joseph Papineau sous un nouveau jour quant à son nationalisme ou à sa vision très contemporaine d’une fédération continentale. À la fois un héros et un oublié de l’histoire du Québec. Bouc émissaire des insuccès des Patriotes et des Québécois, il a laissé peu de traces après 1850. C’est l’édition de sa correspondance qui permet de voir aujourd’hui l’homme différent de celui que la mémoire a construite pour servir ses intérêts divers.

4. Le 20 janvier 2009 : Histoire des origines de la population du Québec (1608-1860) par Michel Barbeau. Cette conférence dresse un historique des différentes vagues d'immigration qui ont concouru à la constitution de la population du Québec de 1608 à 1860. La connaissance de ces faits peut permettre de guider les généalogistes dans la recherche de leurs ancêtres.

5. Le 17 février 2009 : Vêtu d’un costume d’époque, Serge Nault nous entretiendra de son ancêtre François NAU. On y apprendra beaucoup sur son habillement, son alimentation (civile et militaire), la monnaie de l’époque (vers 1760) et de son rôle de Capitaine de Milice.

6. Le 21 avril 2009 : Comment on se soignait en Nouvelle-France par Diane Gaucher. Cette conférence vous entretiendra sur la théorie des humeurs et nous fera connaître différentes étapes pratiques utilisées (la saignée, le clystère, le régime rafraîchissant, les simples et la prière) pour traiter certaines maladies comme la gravelle, les flux, les fièvres, les vers et les coliques venteuses.

7. Le 19 mai 2009 : Les deux batailles du 11 août 1691 à La Prairie par Jean Joly et Gaétan Bourdages. Au cours de sa courte vie utile le fort en pieux de La Prairie n’a eu qu’à résister à une seule attaque, celle du matin du11 août 1691. Cette bataille fut le même jour suivie d’une seconde au lieu dit « chemin de la Bataille ». Ces deux affrontements firent de nombreux morts. Nous vous entretiendrons à la fois sur les causes lointaines de ces deux affrontements, les forces en présence, les stratégies et l’armement de l’époque ainsi que les conséquences qui en résultèrent.



Éditeur :
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
COLLABORATEURS :
Coordination : Jean-Pierre Yelle
Rédaction : Gaétan Bourdages, Hélène Létourneau
Révision : Jean-Pierre Yelle
Infographie : SHLM
Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.
Siège social :
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Tél. : 450-659-1393
Courriel : [email protected]
Site Web : www.laprairie-shlm.com
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur





