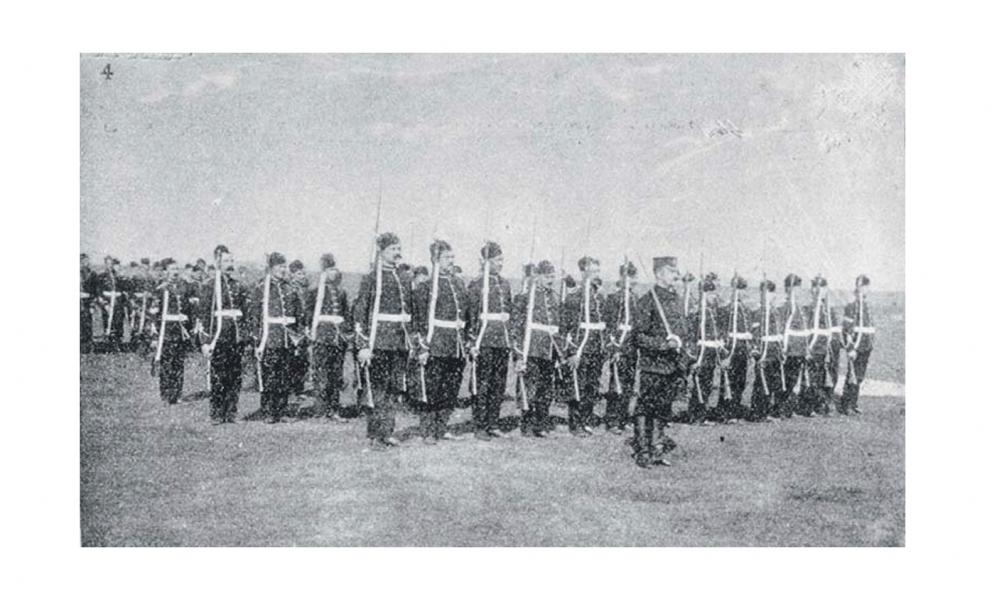
- Au jour le jour, janvier 2012
Un honorable régiment originaire de La Prairie
Le fameux Régiment de Maisonneuve, qui a recueilli de multiples honneurs lors des deux grandes guerres, qui a droit de cité à Montréal et qui est officiellement affilié à la métropole, est originaire de La Prairie. Ce qui suit est un résumé de l’histoire de ce régiment au destin héroïque et qui est né de l’esprit d’un Laprairien.
C’est Julien Brosseau (1837-1912), ancien maire de La Prairie (1876-1885) qui a fondé le 85e Bataillon d’Infanterie en 1880. Ce fils d’aubergiste et capitaine d’un navire à vapeur qui faisait la navette entre La Prairie et Montréal devint commandant du bataillon avec le grade de lieutenant-colonel. À ses débuts, le bataillon comptait 278 hommes réunis en 6 compagnies.
Même avec peu de ressources, le commandant Brosseau réussit à mettre sur pied une troupe bien organisée et efficace. Le Bataillon s’entraînait à La Prairie et reçut l’éloge du ministre de la Défense dès la première année. Le docteur Thomas-Auguste Brisson fut officier et chirurgien en chef du 85e Bataillon. Brosseau en assura le commandement jusqu’en 1892 sans jamais prendre part à une véritable bataille.
Le drapeau officiel du 85e était bleu foncé avec un petit Union Jack dans le coin supérieur droit. Une fleur de lys était placée au centre avec le nombre 85 et encerclée de feuilles d’érable surmontées d’une couronne royale. En bas était inscrite la devise : Bon Cœur et Bon Bras.
En 1888, le 85e déménagea à Montréal, mais demeura affilié à La Prairie où il continua de s’entraîner. En 1900, il élargit ses cadres et devient un régiment. Lors de la Première Guerre mondiale, une grande partie des recrues du Régiment s’est joint aux volontaires du 22e Bataillon (qui deviendra plus tard le Royal 22e Régiment). Au total, au cours de la Première Guerre mondiale, 524 soldats du 85e Régiment servirent en France, 102 furent tués, et 198 furent blessés.
En 1920, le 85e Régiment prit le nom de Régiment de Maisonneuve, en l’honneur de Paul Chomedey Sieur de Maisonneuve.
Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclata, le Régiment fut envoyé à Valcartier pour commencer son entraînement. En 1942, il protégeait une station radar sur les côtes anglaises et certains des hommes furent envoyés en renfort en Afrique du Nord.
Le 5 juillet 1944, le Régiment débarqua en France. Les soldats avancèrent péniblement contre les Allemands qui occupaient la France et entrèrent dans Rouen le 1er septembre 1944. Le 18 septembre, le Régiment entra dans Anvers en Belgique et atteint les Pays-Bas au début d’octobre. Les Canadiens avaient la tâche de libérer l’estuaire de l’Escaut et le port d’Anvers pour permettre l’approvisionnement des troupes qui étaient au front. Le Régiment de Maisonneuve participa à cette bataille épique.
Les Allemands étaient solidement retranchés sur les deux rives et les combats furent terribles. La bataille fut gagnée après cinq semaines de coûteux assauts au cours desquels environ 6 000 Canadiens furent tués ou blessés. Pour montrer à quel point cet objectif était important, il suffit de savoir que les Allemands, dans le but de reprendre Anvers, bombardèrent la ville en y lançant autant de leurs missiles V2 qu’ils en avaient lancés sur l’Angleterre.
Les Hollandais n’oublièrent jamais le sacrifice des Canadiens qui ont libéré leur pays et encore aujourd’hui la famille royale néerlandaise offre chaque année 10 000 bulbes de tulipes au Canada. Celles-ci fleurissent sur la colline du Parlement à Ottawa.
Après avoir libéré les Pays-Bas, le régiment pénétra en Allemagne le 19 février 1945 où en moins de 10 jours, suite à une résistance acharnée de la Wehrmacht, 95 de ses hommes furent tués ou blessés mortellement. Il traversa le Rhin le 30 mars et, le 6 mai, la ville d’Oldenburg se rendit aux hommes du Régiment de Maisonneuve. Quelques mois après l’armistice, les survivants rentrèrent à Montréal en héros.
Plus d’informations disponibles sur les sites suivants :
Régiment de Maisonneuve : http://fr.wikipedia.org
85e Régiment : http://memoireduquebec.com
Julien Brosseau : http://www.biographi.ca
Au total, il semble exister 7 photos du 85e Bataillon. On peut les trouver à l’adresse suivante : http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/illustrations/htm/i768.htm

- Au jour le jour, juin 2008
La Prairie et la guerre de Neuf Ans (1688-1697)
Il faut garder à l’esprit que l’histoire de La Prairie s’inscrit dans le vaste contexte de l’histoire internationale. Il est intéressant de lire l’histoire de notre ville avec l’histoire de la France et de l’Angleterre en arrière-plan. La seule grande période de guerre que La Prairie a connu sur son territoire fut celle qui va de 1689 à 1697. Ce n’est pas dû aux sautes d’humeur des Iroquois ou des habitants d’Albany, loin de là. Pour en comprendre les causes, il faut remonter à Louis XIV. En 1667, le jeune Louis déclare la guerre à l’Espagne parce qu’il considère que certaines terres lui sont dues, à cause de son épouse espagnole (Marie Thérèse d’Autriche fille de Philippe IV roi d’Espagne). Les Néerlandais n’approuvent pas et interviennent. Pour se venger, Louis s’attaque ensuite aux Provinces Unies des Pays-Bas (1672-1678), faisant ainsi l’acquisition de nouvelles terres. En 1685, ce roi très catholique, révoque l’édit de Nantes qui donnait le droit aux Protestants de pratiquer leur religion, de sorte que les protestants français (qu’on appelle Huguenots) fuient le pays en emportant avec eux beaucoup d’argent et de savoir-faire.
Pendant ce temps, l’Angleterre, qui est une nation à majorité protestante et qui a vécu plus d’un conflit religieux interne, voit accéder à son trône un roi catholique, Jacques II (James II) qui fut couronné le 6 février 1685. À cette époque, la France et l’Angleterre sont en paix, mais Jacques II est vu par plusieurs protestants de la Grande-Bretagne comme un tyran et un agent actif à la solde de la politique expansionniste du roi catholique de France Louis XIV. Grolier Encyclopedia 1994, James II, King of England, Scotland, and Ireland. Cela n’augure rien de bon et la tension monte. Le 9 juillet 1686, la Ligue d’Augsbourg se forme pour faire bloc contre la France. Cette ligue est formée par des pouvoirs protestants européens : l’Allemagne, l’Espagne et la Suède. Pendant ce temps, chez nous, le gouverneur Denonville, ordonne de fortifier La Prairie. Quelques années auparavant, le gouverneur La Barre avait dit de notre village qu’il était à la frontière des Anglais et des Iroquois. Cahiers D'histoire des Jésuites, Numéro 4 : Les Origines de La Prairie (1667-1697), Yvon Lacroix, Éditions Bellarmin, Montréal, 1981. p. 68. Durant l’été 1687, il y a une expédition guerrière contre les Agniers (ou Mohawks), la nation iroquoise la plus fidèle aux Anglais.
Retour en Angleterre, Jacques II devient père en juin 1688. C’est alors que face à la perspective d’une succession catholique, l’opposition protestante a invité le gendre et neveu de James II, le protestant danois Guillaume d’Orange, à venir en Angleterre Grolier Encyclopedia 1994, The war of the Grand Alliance. pour prendre le trône. En septembre 1688, alors que le fort est en pleine construction à La Prairie, Louis XIV envoie des troupes dans une région de l’Allemagne, appelée le Palatinat, dans le but de briser la Ligue d’Augsbourg.
Alors que Jacques II décide de fuir en France au début de 1689, on offre le trône à Guillaume d’Orange, mais seulement sous les conditions décrites dans la Déclaration des Droits (ou Bill of Rights). Il vaut la peine ici, de faire une parenthèse pour parler un peu plus longuement de cette déclaration puisque c’est pour les Anglais l’équivalent de la Révolution Française de 1789, et parce qu’à partir de 1760, les habitants de la Nouvelle-France vont vivre sous la gouverne britannique. La Déclaration des Droits britanniques est composée par une convention formée de pairs du Royaume, de membres des Communes et de magistrats de Londres, et est constituée de nouveaux règlements qui donnent plus de pouvoir au peuple et en enlèvent aux monarques. Elle interdit au roi de tenter de dominer le Parlement. Elle déclare que l’élection des membres du Parlement doit être libre, que la liberté de parole et de débats au Parlement ne doit pas être remise en question par le pouvoir royal. Elle déclare notamment que le prétendu pouvoir de suspendre des lois ou d’exécuter des lois, par autorité royale sans le consentement du Parlement est illégal. Grolier Encyclopedia 1994, English Bill of Rights. Il est même interdit au pouvoir royal de lever ou de garder une armée en temps de paix sans le consentement du Parlement. Une section sur la perversion de la justice est particulièrement importante, elle a même servi de modèle un siècle plus tard à la Déclaration des Droits des États-Unis d’Amérique. Elle stipule entre autre qu’un montant de caution excessif ne doit pas être demandé, que des amendes excessives ne doivent pas être imposées, que des punitions cruelles ne doivent pas être infligées. Tout ceci fut créé en réaction à un roi trop autoritaire et par la peur de ne pas pouvoir exercer sa religion librement.
Acceptant ces conditions, Guillaume d’Orange fut couronné roi d’Angleterre sous le nom de Guillaume III (William III) le 11 avril 1689 mettant ainsi fin à la Révolution Anglaise (the Glorious Revolution) sans victime, ni coup de feu. En mai, Guillaume amena le Parlement Anglais à se joindre à une alliance contre la France. Cette alliance était constituée de l’Allemagne, des Pays-Bas, de l’Angleterre, de l’Espagne et de la Savoie. La Guerre de la Ligue d’Augsbourg, ou guerre de Neuf Ans, éclate officiellement le 17 mai. À l’été 1689, le fort de La Prairie est terminé. Comme on le sait, il s’agit d’une palissade constituée de pieux de 20 à 25 cm (8 à 10 po) de diamètre, et faisant environ 5 mètres de haut (16 pieds). Un fort a également été construit pour les habitants de la Côte St-Lambert.
Jacques II, le roi déchu, réfugié en France, s’était constitué une armée de Français et d’Irlandais pour reprendre le trône, mais il fut vaincu par Guillaume d’Orange en essayant d’envahir l’Irlande en 1690.
La Prairie goûte vraiment à cette guerre le 4 septembre 1690, alors que des Iroquois attaquent par surprise les habitants et la garnison du fort qui sont dans les champs occupés à faire les blés. Vingt-et-un hommes (dont 10 soldats), trois femmes et une fille furent tués ou capturés. Les Français éliminèrent 6 iroquois, mais les autres eurent le temps de tuer quelques vaches et de mettre le feu aux maisons et à quelques tas de foin avant de disparaître dans les bois. Le 16 octobre 1690 les Anglais essaient de prendre Québec. Le général Phipps arrive en face de la ville avec une flotte de 30 navires et somme Frontenac de se rendre. C’est ce jour-là qu’il eut ces fameux mots : Je n’ai point de réponse à faire à votre Général que par la bouche de mes canons et à coups de fusils. Les Anglais n’arrivent pas à prendre Québec et s’en retournent.
En 1691, la chapelle de St-Lambert est démontée et remontée dans le fort de St-Lambert afin de la protéger des Iroquois. En août 1691, le major anglais Peter Schuyler commande une troupe de 400 Anglais et Iroquois, et avance vers La Prairie dans le but de prendre le fort. Le sieur de Callières en fut averti d’avance et ordonna à 800 hommes de camper à La Prairie. Le combat s’engagea, mais face au nombre des Français, Schuyler ordonna la retraite. Comme les Français avaient déjà perdu un lieutenant et deux capitaines, Callières décida de ne pas poursuivre l’ennemi. Après cet échec, les Iroquois ne feront plus qu’une guerre de guérilla contre La Prairie, attaquant par petites bandes pour tuer ou capturer des habitants isolés et mettre le feu à des maisons. Plusieurs familles devront temporairement trouver refuge dans le fort. Certains reçoivent même l’ordre d’y déménager leurs maisons afin d’éviter que les Iroquois ne les brûlent.
En Europe, en 1694, après 5 ans de guerre et sans qu’il soit possible de déterminer un vainqueur, le Parlement britannique refuse de supporter la coûteuse politique anti-française de Guillaume III, tant que les ambitions de Louis XIV ne sont pas mieux connues. Sans la Déclaration des Droits Anglais, mentionnée ci haut, cela n’aurait pas été possible : le roi aurait simplement ignoré le Parlement. Pour La Prairie, cela veut dire un apaisement des hostilités avec les Iroquois et une reprise de la colonisation dans la seigneurie. En 1697, Guillaume III signe un traité de paix qui lui est favorable avec la France. Ce traité assure que Louis XIV reconnaît son statut de roi, et qu’il laisse tomber la plupart des terres qu’il a conquises depuis 1679. C’est la fin de la Guerre de la Grande Alliance et cela signifie aussi la fin de la guérilla iroquoise contre La Prairie.
[Le comité de la bataille de la SHLM travaille actuellement à faire l’histoire détaillée de la bataille de 1691 à La Prairie.]
Sources des citations :
1– Grolier Encyclopedia 1994, James II, King of England, Scotland, and Ireland.
2 – Cahiers D'histoire des Jésuites, Numéro 4: Les Origines de La Prairie (1667-1697), Yvon Lacroix, Éditions Bellarmin, Montréal, 1981. p.68.
3 – Grolier Encyclopedia 1994, The war of the Grand Alliance.
4 – Grolier Encyclopedia 1994, English Bill of Rights.
Sources bibliographiques :
– Grolier Encyclopedia1994.
– Cahiers D'histoire des Jésuites, Numéro 4: Les Origines de La Prairie (1667-1697), Yvon Lacroix, Éditions Bellarmin, Montréal, 1981
– La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, étude d’histoire sociale, Louis Lavallée, McGill-Queen’s University Press, Montréal, 1992.
– Histoire Populaire du Québec, Jacques Lacoursière, Septentrion, Québec, 1996.

