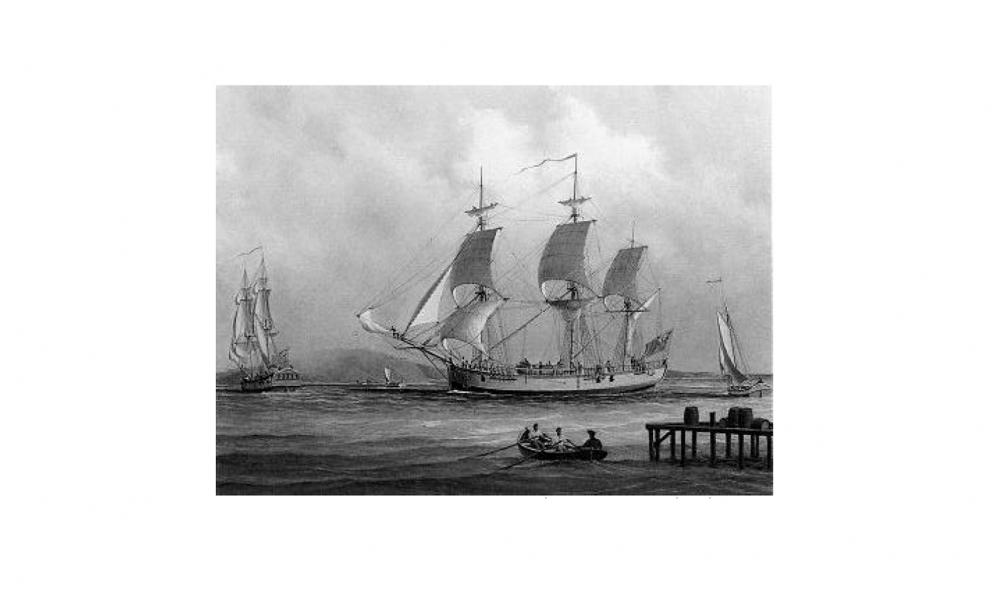
- Au jour le jour, mars 2004
Voyage de Pehr Kalm au Canada (extraits)
LES SOLDATS
Les soldats jouissent de certains avantages appréciables. Tous affirment cependant qu’ils en ont encore de plus grands en France. Les soldats que l’on envoie ici de France doivent ordinairement servir de 40 à 50 ans. Ils reçoivent après leur congé, s’ils le désirent, ainsi que le droit de s’établir ici de cultiver une terre, mais ils ont pu également au moment de leur arrivée dans ce pays, décider par contrat de servir tant d’années et ils ont leur congé, s’ils le veulent, à l’expiration du temps. Les gens nés ici signent ordinairement un contrat pour un service de six, huit ou dix ans, après cela ils ont leur congé et s’établissent à demeure dans le pays. Lorsqu’un soldat reçoit son congé et s’établit sur une terre qui n’a pas été encore défrichée, avec l’intention de la mettre en culture, le roi l’aide à s’installer. Durant les trois ou quatre premières années, il reçoit de la Couronne, pour lui et sa femme, la nourriture, une vache et le matériel agricole de première nécessité; d’autres soldats lui sont également fournis pour l’aider à charpenter son logement, et c’est le roi qui les paie. Cela constitue une aide importante pour ceux qui se mettent à la culture. On leur concède une terre cultivable de trois arpents de large et quarante de longueur, en un endroit où la terre est particulièrement bonne.
Lorsqu’un soldat demande la permission de s’absenter pour un ou plusieurs jours, il la reçoit si les circonstances le permettent et jouit en plus de la totalité de sa solde, mais il doit engager les services de l’un des soldats présents au camp. Celui-ci devra assurer la garde à sa place durant son absence et accomplir ses obligations; il en sera dédommagé par celui qui s’absente.
Les soldats qui sont en garnison reçoivent de leur roi une aide appréciable. On leur accorde deux livres de pain de pur froment chaque jour; ils ont certainement du pain en surabondance; il en va de même pour le saindoux, la viande séchée ou salée; de temps à autre, on abat un bœuf ou quelqu’autre animal et l’on partage la viande fraîche entre eux; ils ont des pois verts en suffisance; tous les officiers possèdent des vaches, données par le roi, dont ils tirent plus de lait qu’ils en ont besoin : comme on l’à dit plus haut, chaque soldat possède son petit jardin potager, où il peut faire pousser tous les légumes utiles en cuisine. En fait de ressources pécuniaires, chaque soldat reçoit cinq sols par jour, mais il lui arrive d’accomplir quelque travail au service du roi; il est toujours payé pour cela et, en pareil cas, il peut toucher 30 sols par jour. Les soldats ont quartier libre dans la mesure où ils n’ont pas à assurer la garde au fort et comme le lac (Champlain) est rempli de poissons, la forêt, de bêtes et d’oiseaux, celui qui veut s’en donner la peine peut assez facilement en tirer sa subsistance. Les gens ici paraissent être en bonne santé, gras et corpulents, vifs et amusants. Lorsqu’un soldat tombe malade, on le conduit à l’infirmerie ou à ce qu’on appelle «hôpital». Il trouve là des lits garnis de draps, de la nourriture, des remèdes et des soins gratuits, le tout fourni par le roi. Tous les deux ans, chaque soldat reçoit une tunique et, chaque année, une veste, une toque, une coiffure, un pantalon, un cache-col, deux paires de chaussettes et de chaussures : il y a du bois de chauffage en quantité suffisante pour l’hiver.
En vue de la mise en culture du pays, on a récemment demandé au roi s’il ne permettrait pas l’envoi annuel de France de 300 hommes afin que les anciens puissent toujours donner leur congé et qu’en même temps ils soient en mesure de se marier et de recevoir également en partage des terres vierges à cultiver et où s’établir. Les soldats qui ont eu congé et se sont établis dans les environs du fort n’ont pas plus de quarante à cinquante ans; ils ont reçu chacun une terre large de trois arpents et longue de quarante; la forêt proche leur fournit le bois de charpente et de chauffage, ainsi que la nourriture du bétail, tandis que la terre concédée est utilisée sous forme de champs ou de prés. Le sol de cette région-ci est d’assez bonne qualité au témoignage des soldats qui ont pris leur retraite; il se compose principalement de terre végétale noire et, en dessous, d’argile.
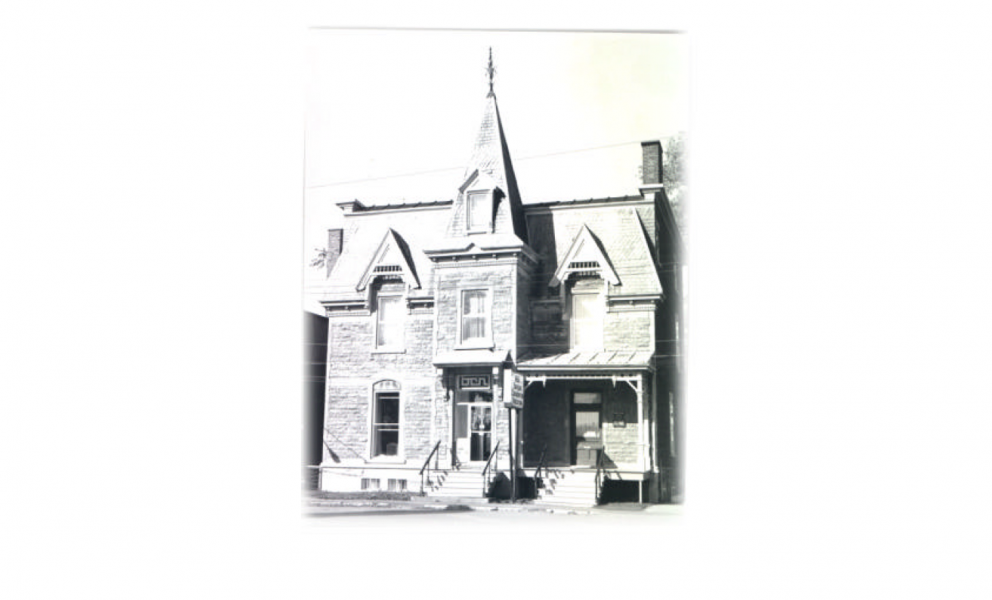
- Au jour le jour, mars 2004
La banque Henry de Laprairie
Je veux succinctement situer la banque Henry de La Prairie dans le temps et donner un bref aperçu du personnage qui l’a créée.
En 1834, il y a eu aux États-Unis un krach où des centaines de banques ont fait faillite. J’ai lu aussi qu’à cette époque, de 1830-1840, il y avait un manque de numéraire (monnaie) un peu partout dans le monde, spécialement en Angleterre et dans ses colonies.
Dans la région de la Rive-Sud de Montréal et probablement ailleurs aussi, vers 1837, il y a de mauvaises récoltes et des inondations laissant les habitants sans argent et sans crédit pour réparer ou acheter de l’outillage agricole ou des semences. Bref, pour pouvoir semer et récolter.
Le 8 juin 1837 paraissait un avis « Vu que les habitants de ce comté et autres circonvoisins se trouvent dans la plus grande détresse et exposés aux sacrifices de leurs propriétés faute d’une institution où ils puissent se procurer des emprunts, le soussigné se rendant aux sollicitations réitérées d’un grand nombre de notables des environs, a résolu d’émettre son papier sous le nom d’Henry’s Bank, pour accommoder les classes agricoles et ouvrières. » La Minerve, le jeudi 8 juin 1837.
Ce sera la première banque du pays à émettre de petites dénominations de trente sous (quarter dollar), d’un écu (half dollar), elle émet aussi des billets de une, deux, cinq et dix piastres. Fait remarquable, ces billets étaient bilingues presque cent ans avant que les billets de la Banque du Canada ne deviennent bilingues en 1937.
Cette banque non clandestine comme tant d’autres, ira très bien jusqu’au 7 décembre 1837, jour où elle suspend ses paiements car son directeur-général (et caissier) « décampa en emportant la caisse » aux États-Unis. La perte se serait chiffrée à $130,000 et obligea M. E. Henry à déclarer faillite.
M. Edme Henry était le fils de M. Edme Henry chirurgien-major français dans le Royal-Roussillon et de Mme Geneviève Fournier, canadienne. Edme fils est né à Longueuil le 15 novembre 1760. Alors notaire, il séjourne aux îles de Saint-Pierre et Miquelon de 1786 à 1793 puis, il se fixe à La Prairie. Il marie à une protestante, Mme Eunice Parker. Il est alors notaire du Général Christie Burton et devint peu après agent de six seigneuries. Il est l’un des Canadiens-français le plus en vue de toute la Rive-Sud de Montréal. Mentionnons qu’il siégea à l’Assemblée législative du Bas-Canada comme député de Huntington de 1810 à 1814. Il aura de vastes intérêts à Chambly, à Repentigny, à Sherrington; des possessions à la Rivière du Sud qui devint Henryville et il recevra l’agence de la Seigneurie de La Prairie où il est décédé le 14 septembre 1841.
Informations et textes colligés par André Montpetit.
P.S. Si quelqu’un possède des informations à ce sujet, j’apprécierais les connaître afin que je puisse poursuivre les recherches entreprises sur cette banque. J’achète et je vends des billets d’Henry’s Bank.

- Au jour le jour, mars 2004
Un pont réclamé (suite)

Les habitants de la côte Sainte-Catherine, de la côte de la Fourche et du fort de La Prairie :
Pierre Aupry
François Barrault
Étienne Bisaillon
Louis Bouchard
Pierre Bourdeau
Pierre Brosseau
Antoine Caillé
Jean-François Demers
Jacques Deniau
Pierre Dumas
René Dupuis
Pierre Gagné
François Gagné
Louis É. Gagné
Joseph Gagné
Pierre Ganier
Pierre Hervé
François Leber
François Lefebvre
Laurent Lefebvre
Jean Lefort
Vincent Lenoir
André Longtin
Michel Longtin
Jacques Pinsonnault
Pierre Pinsonnault
Benoît Plamondon
Pierre Roy
Pierre Senécal
Jacques Thibierge
Les habitants de la côte Saint-Lambert :
André Babeu
Antoine Boyer
Maurice Demers
Jean Gervais
Jacques Moquin
Pierre Moquin
Jean Poupard
Laurent Surprenant
Toussaint Trudeau
Ordonnance de l’intendant Bégon : deux ponts seront construits
Pierre Raimbault retient les idées des deux groupes et fait son rapport à l’intendant Michel Bégon. Ce dernier met un terme au désaccord des habitants de La Prairie. C’est ainsi que le 17 janvier 1723 l’intendant ordonne que deux ponts soient construits : un sur la rivière Saint-Jacques et l’autre sur la rivière La Tortue ». Voici une transcription de l’ordonnance de l’intendant :
« Nous ordonnons que tous Les habitans de la Seigneurie de la prairie de la madelaine tant ceux qui Sont au dessous de la Riviere S.t Jacques y Compris ceux du lieu Mouillepied apresent de la parroisse de longeüil que ceux qui Sont au dessus de lad.e Riviere même ceux qui Sont dans les proffondeurs de la ditte seigneurie contribueront chacun au prorata de létendüe des terres qu’ils possedent dans lad.e Seigneurie a la Construction d’un pont Sur la Riviere de la tortüe et d’un autre Sur Celle Riviere de la tortüe [trois derniers mots rayés] Saint Jacques et a lentretien desd. ponts que celuy Sur la riviere la tortue Sera fait le premier qua Cet effet jl Sera fait par le s. Catalogne lieutenant des troupes et Sous Ingenieur du Roy en ce paÿs un devis et estat Estimatif de Chacun desdits ponts qui Seront par luy remis au Sieur Raimbault qui fera en presence dud.s. Catalogne dans lassemblée desd. habitans qui Sera Convocquée par ledit Sieur Raimbault l’adjudication au Rabais desd ouvrages ceux qui feront la condition la meilleure et fera Ensuitte la repartition de ce que chacun desd. habitans aura a payer pour leur part des prix desd. adjudications et en cas qu’il Survienne quelque Contestation au Sujet de lad. repartition Les partyes Se pourvoyront devant ledi S. Raimbault et aura declaré par provision Executoire en vertu de notre presente ordonn.ce ce qui aura este par luy reglé et arresté ordonnons qu’il Sera fait aussy deux adjudications au rabais et Separées pour Lentretient desdits deux ponts et que l’adjudicataire de Lentretien du pont Sur la riviere St Jacques Sera tenu a la fin de Chaque automne de L’entente pour le mettre a couvert des refoullements et de le retablir tous les printemps aussy tost que les glaces Seront partys et quil Sera fait aussy par le Dit Sieur Raimbault une repartition de ce que chacun des habitans delad Seigneurie Sera tenu de Contribuer pour sa part des dits Entretiens dequelles adjudications et repartitions jl Sera dressé des proces verbaux par ledit Sieur Raimbault pour Iceux avons Envoyer etre ordonne ce qu’il appartiendra mandons & fait a Quebec Le dix Sept Janvier mil Sept cent vingt trois ./. » Ordonnance de l’intendant Michel Bégon, 17 janvier 1723, S.G.C.E.
Le pont de la rivière de la Tortue
Le 25 août 1723, le père Jacques d’Heu, s.j., suite à une ordonnance de l’intendant, réunit à nouveau les habitants de La Prairie, qui lui avaient fait la demande de la construction d’un pont sur la rivière de la Tortue; il leur demande de réitérer leur volonté de contribuer financièrement à la construction du pont qu’ils réclament :
« … quil falloit que chacun declara ces dernier Santimants pour La Contribution dud pon lesquels habitant de pnt a lade assamblée ont tous Repondu Et dit dune Comune voix quil Contentoient que led pons fut fait Le plutost que faire ce poura pour Leur avantage Et quils Sobligent de Contribuer volontiers chacun Separement quatre Deniers par chaque arpt de terre quil pourroit avoir en Superficie… » Barette Guillaume, Assemblée des habitants de La Prairie, 25 août 1723, S.G.C.E.
C’est le 23 février 1724 qu’un marché est conclu entre le père d’Heu, les habitants et Pierre Lefebvre, maître charpentier et résidant de La Prairie pour la construction du pont.


- Au jour le jour, février 2004
À propos du bulletin
Éditeur :
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Internet : www.laprairie-shlm.com
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
Collaborateurs :
Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.
Rédaction : Johanne McLean; Raymond et Lucette Monette (284); Hélène Charuest (59); Marie Gagné (316); Cécile Girard (426)
Révision : Jacques Brunette (280)
Infographie : SHLM
Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.
Siège social :
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Tél. : 450-659-1393
Téléc. : 450-659-1393
Courriel : [email protected]
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, février 2004
Le coin du livre
Dons
Merci aux donateurs dont les noms suivent :
Monsieur Serge Geoffrion
Monsieur Albert Lebeau
Madame Céline Lussier
Monsieur Sylvain Rivard
Acquisitions
- Histoire de la province de Québec, par Robert Rumilly, volume 31 (don anonyme)
- La grande paix de Montréal de 1701, par Gilles Havard (don de Sylvain Rivard)
- Le Québec/Canada et la guerre de sécession américaine, 1861-1865, par Mark Vinet (achat de la SHLM)
- Les édifices parlementaires depuis 1792. Publications Québec
- Le parlement du Québec, deux siècles d’histoire. Publications Québec
- Les monuments funéraires des premiers ministres du Québec
- Lieux de sépultures des premiers ministres du Canada
- Quinze années de réalisations par Robert Rumilly
Les livres de cette section sont un de don de Monsieur Serge Geoffrion.
- Les archives de la paroisse Saint-Joseph-de-Chambly, par Monique Signori (don de Monsieur Albert Lebeau)
- Machine à écrire : Suite à notre demande dans le dernier coin du livre, nous avons reçu une machine à écrire de la part de Madame Céline Lussier. Merci de tout cœur de votre générosité.
Site internet
Voici un site très intéressant sur le dictionnaire biographique du Canada, publié en 14 volumes, en anglais et en français.
Vous aurez accès à des biographies de personnes célèbres qui se sont illustrées au Canada. L’adresse est : www.biographi.ca
Appel à tous
Il nous manque le volume 32, la Dépression, de l’histoire de la province de Québec, par Robert Rumilly.
Merci au donateur éventuel.

- Au jour le jour, février 2004
COMMUNIQUÉ : Prix de la relève
L’Association des auteurs de la Montérégie annonce la tenue du concours littéraire intitulé : Prix de la relève 2004 : Mon premier livre. Soucieuse d’assurer la relève, l’AAM lance ce concours dans le but de découvrir de nouveaux talents en Montérégie. Ce concours s’adresse à toutes les personnes résidant en Montérégie et qui n’ont jamais publié de livre.
En 2004, pour la troisième édition, l’Association des auteurs de la Montérégie a choisi la biographie comme genre littéraire. De plus, pour être éligible, le manuscrit devra obligatoirement faire l’objet d'une biographie d’un personnage de la Montérégie, qu’il soit historique ou contemporain. Le manuscrit, d’un minimum de 125 pages à double interligne, devra comporter une bibliographie exhaustive. Les manuscrits devront parvenir au siège social de l’Association des auteurs de la Montérégie avant le 1er mars 2004. Un jury composé de membres de l’AAM choisira le manuscrit gagnant au cours du mois d’avril et le nom du récipiendaire sera dévoilé lors de l’attribution des Grands Prix littéraires de la Montérégie. L’Association s’engage à faire éditer le manuscrit primé dans l'année qui suit. Si aucun manuscrit ne répond aux critères exigés, l’Association des auteurs de la Montérégie se réserve le droit de ne pas décerner le prix.
Les manuscrits doivent être adressés à l’Association des auteurs de la Montérégie, 440, Chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4H 3L7. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le siège social de l’AAM au (514) 577-4574 ou par courriel à : [email protected]
Source : Marcel Fournier, Association des Auteurs de la Montérégie.

- Au jour le jour, février 2004
Nouvelles de la SHLM
La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :
– Monsieur Michel Barabé, St-Constant (476)
– Monsieur Fernand Lavallée (477)
– Société d’histoire de Verdun (478)
– M. et Mme David Rougier USA (479)
– M. Marcel Lussier Brossard (480)
– MRC du Roussillon (481)
– Journal Le Reflet (482)
– Société d’histoire de la Vallée, St-Sauveur (483)
Conférence
Notre conférencier de février est Monsieur Maurice Vallée, historien de l’art et du cinéma. Il nous entretiendra des frères d’armes du Régiment de Meuron qui fondèrent plusieurs villages de la Rive-Sud.
Qu’était-il, ce Régiment suisse de Meuron? Pourquoi est-il venu en terre canadienne ? Où, quand et qui ont-ils combattu ? Et la réponse à bien d’autres questions.
Suite à la conférence de Mark Vinet, le 21 janvier 2004, nous vous présentons une photo de l’auteur du livre Frontière États-Unis/Canada 18e et 19e siècle et des figurants portant l’habit des soldats de la guerre de Sécession.

Nouvelle tarification pour les étudiants
La SHLM offre dès maintenant une nouvelle tarification pour les étudiants.
Élèves du primaire – $5.00
Élèves du secondaire – $10.00
Étudiants du collégial et universitaire (25 ans et moins) – 15.00$

- Au jour le jour, février 2004
Conférence : le régiment des Meurons
Notre prochaine conférence aura lieu le 18 février au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.
Régiment des Meurons
Régiment suisse dont les soldats fondèrent plusieurs villages de la Rive-Sud : De Saint-Félix de Kingsey à Napierville en passant par L’Acadie.
Le conférencier : Maurice Vallée, historien de l’art et du cinéma

- Au jour le jour, février 2004
Mot du président
Chers amis,
Le colloque du 7 février dernier a été une réussite à tous les points de vue. Cent soixante personnes étaient présentes et ce, malgré les caprices de Dame Nature.
Nos conférenciers du matin, M. Stuart Phillips, amérindien et historien de Kahnawake et M. Ben Giboe, de New York, amérindien du Dakota du Sud dont les ancêtres Gibeault et Robidoux étaient de Saint-Philippe, ont capté l’attention des participants par leurs histoires sur leur tribu respective et les liens qui ont uni nos deux communautés.
Dans l’après-midi, Messieurs Jean-Marc Garant et Sylvain Rivard ont remplacé au pied levé Monsieur Marcel Trudel, historien, retenu par la maladie. Quelle conférence intéressante! M. Garant a parlé de Samuel de Champlain du point de vue des français et Sylvain Rivard, lui-même de descendance amérindienne, a donné la version amérindienne vis-à-vis Champlain, ce dernier étant très estimé des deux nations. Bravo Messieurs Garant et Rivard.

L’atelier de généalogie, quant à lui, a connu un immense succès grâce à notre spécialiste M. Jean-Marc Garant.
Une bonne nouvelle! La SHLM a obtenu des Archives nationales du Québec la permission de numériser les archives manquantes du Fonds des Jésuites. Grâce à ce procédé, le travail se fera beaucoup plus rapidement que lors de la consultation de la première partie de ces archives il y a plusieurs années. Vive la technologie moderne!
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas de renouveler votre cotisation. Nous comptons sur vous.
Bonne Saint-Valentin à tous.
Céline Lussier, vice-présidente

- Au jour le jour, février 2004
Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749 (extrait)
Pehr Kalm (Extraits)
LES BATEAUX
Les bateaux dont on se sert ordinairement ici sont de trois sortes; des bateaux (canots) en écorce de bouleau, faits principalement de cette matière à l’exception de l’armature qui est en bois, puis canots (pirogues) creusés dans un arbre; les embarcations sont fabriquées avec du pin blanc et sont de différentes tailles.
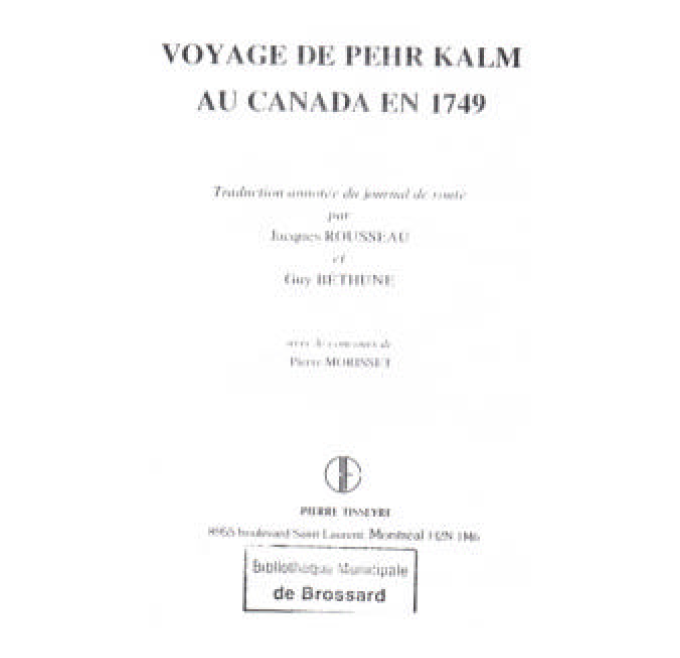
Dans les deux types d’embarcations que nous venons de nommer, on ne rame pas habituellement comme dans nos bateaux, à savoir assis à l’envers et en ramenant la rame vers soi. On utilise ici une rame courte en forme de spatule (aviron au Canada) et on se propulse avec cela comme on fait chez nous lorsqu’on a aperçu un phoque, et que l’on désire le capturer en douceur. Selon cette méthode, on a le visage tourné du côté où l’on se dirige et on ne possède qu’une rame, que l’on tient à deux mains; mais il s’en faut beaucoup que l’on puisse déployer la même force qu’avec notre façon de ramer. Je crois qu’avec la nôtre un homme peut ramer aussi vite que deux hommes avec la leur. La troisième espèce d’embarcations utilisées ici sont toujours de grande taille et on s’en sert lorsqu’on a beaucoup de choses à transporter; leur fond toujours horizontal et plat, est fait de chêne, soit de chêne rouge, soit de préférence de chêne blanc. Leur forme leur assure une plus grande stabilité lorsqu’il heurte des roches ou quelqu’autre chose. Les flancs du bateau, par contre, sont en planches de pin blanc, car le chêne rendrait l’embarcation trop pesante.
(Si vous désirez en savoir plus sur les canots d’écorce et barques sous le régime français, un excellent article a paru sous le titre de Canots d’écorces et Barques écrit par Armand Therrien dans le numéro Été 2003 no.74 de Cap-aux- Diamants.
Voici quelques courts extraits : « Jacques Cartier et ses équipages furent parmi les premiers Européens au pays à apercevoir les canots d’écorce dans la baie de Gaspé en 1534 où des Amérindiens de Stadaconé pratiquaient la pêche à la morue. Quant à Samuel de Champlain, il sera le premier à faire une description de ce canot algonquin. Plusieurs écrits décrivent la construction d'un canot d’écorce.
Les plus intéressants sont de la main du baron Lehontan en 1684. C’est au tour de l’ingénieur de nous apprendre où et comment on construisait ces embarcations. C’est à Trois-Rivières, où l’on fabrique le mieux le mieux les canots d’écorce. »)

