
- Au jour le jour, avril 2004
Correspondance du Dr Thomas Auguste Brisson
En date du 2 mai 1921, Sœur Ste-Sylvie, supérieure du Couvent de Notre-Dame de La Prairie écrit au Maire et aux échevins de la Ville de La Prairie pour exprimer sa vive gratitude pour les dons d’arbres précieux, destinés à accroître le bien-être des élèves et l’attrait de leur séjour au couvent.
Déjà dans le passé, le conseil avait fait preuve d’esprit public et de générosité vis-à-vis d’eux en contribuant à l’érection d’un poulailler modèle et qui est toujours ouvert aux visites et à l’examen, dans l’intention de faciliter au public l’acquisition de connaissances agricoles et ménagères.
La liste d’arbres d’ornement est comme suit : pour le parterre de devant : 1 bouleau blanc, un seringa grandiflora, 1 épine-vinette commune et thunbergie, 1 seringa faux-oranger et 1 bouleau commun.
Au côté nord, 1 seringa doré, 1 orme américain, 1 frêne américain et 1 tilleul. Le tout au prix de $5.50.
Il serait intéressant de vérifier s’il reste des spécimens de ces arbres et arbustes sur le terrain?

- Au jour le jour, avril 2004
Hommage à un fils de La Prairie : Emmanuel Desrosiers
Dans un nouvel arrondissement aux limites de la Ville de La Prairie, une artère est nommée au nom d’Emmanuel Desrosiers.
Cet écrivain est le fils d’Arthur Desrosiers et de Pacifique DeMontigny. Il naît à La Prairie, sur les rives du fleuve Saint-Laurent, le 6 octobre 1897.
Après avoir étudié la pédagogie à l’École Normale Jacques-Cartier à Montréal, il devient instituteur d’une école de rang à la Côte Sainte-Catherine. À cause du maigre salaire qui lui est dévolu, il opte pour le métier de linotypiste à l’imprimerie des Frères de l’Instruction Chrétienne, attenante à leur maison provinciale de La Prairie.
Emmanuel Desrosiers est un conteur-né. Son village natal, la nature belle en toutes saisons, le majestueux fleuve Saint-Laurent, seront ses sources d’inspirations.
Son désir de s’exprimer par l’écriture le conduit à offrir sa collaboration à différentes revues et à quelques magazines.
Certains contes et récits traduisent bien les réactions de ses concitoyens francophones devant la guerre 1914-1918. Pour le Service fédéral de l’information, il écrit une trentaine d’articles dont « 300 ans d’histoire », en 1942, à l’occasion du troisième centenaire de la Ville de Montréal. Au début des années 40, il aborde le roman policier.
En 1931, il publie le roman « LA FIN DE LA TERRE », volume illustré par Jean-Paul Lemieux, peintre québécois, et devenu depuis de renommée internationale. Ce roman d’anticipation scientifique à la Jules Verne intéresse vivement tous ceux qui sont soucieux de ce dont demain pourra être fait. Emmanuel Desrosiers anticipe la fin de la Terre vers l’an 2400. Un deuxième volume, « RIEN QUE DES HOMMES », écrit pour faire suite à « LA FIN DE LA TERRE » est demeuré à l’état manuscrit.
Les textes d’Emmanuel Desrosiers porteront la marque des deux conflits mondiaux majeurs qu’il a connus : les guerres de 1914-1918 et 1939-1945. La grave crise économique de 1929 l’influencera profondément. Tantôt, il décrira la misère qui frappe ses compatriotes, tantôt il publiera contes et récits humoristiques, espérant ainsi susciter une évasion aux misères du temps.
Décédé trop tôt le 28 janvier 1945 à l’âge de 47 ans, ce prolifique auteur mérite l’honneur d’associer son nom à une petite partie de son La Prairie qu’il appréciait tant.
Sa fille, Claire Desrosiers Leroux (169)

- Au jour le jour, avril 2004
Mots et maux d’amour
1ère partie
Aujourd’hui, alors que le téléphone est à la portée de tous, que les moyens de transport sont nombreux et rapides pour se visiter, les amoureux ont moins tendance à s’écrire pour communiquer. Ce qui n’empêche pas qu’il y ait à l’occasion des sentiments particuliers que l’écrit permet d’exprimer avec plus de facilité et avec de plus jolis mots.
La lettre ou la note d’amour qu’on fait parvenir à l’être aimé n’est pas toujours le fait d’une lointaine et douloureuse séparation. Elle peut être préparatoire à une rencontre en touchant des sujets chargés d’émotivité trop difficiles à aborder en face à face. On l’emploie aussi après coup pour dire ce qu’on n’a pas osé alors qu’on était ensemble.
Mes grands-mères paternelle et maternelle avaient conservé des pièces de ce genre de correspondance datant de leur temps de jeune fille, dans les années 1887 et 1894. Un aspect intéressant de ces lettres et mots d’amour est le fait qu’assez souvent on s’y exprimait en vers. À l’époque, plusieurs journaux inséraient entre les articles qu’ils publiaient des pensées et des poèmes d’écrivains d’ici ou d’ailleurs, ce qui était apprécié d’une partie de leurs lecteurs et lectrices. Certains s’en inspiraient quand cela correspondait à leurs sentiments et les utilisaient même dans leurs écrits en les modifiant ou non.
Ma grand-mère paternelle avait conservé dans un petit carnet le texte de messages destinés à son amoureux dont on ne peut dire s’ils lui furent tous expédiés. Au début de la vingtaine, elle allait découvrir bientôt que celui qu’elle aimait était en voie de la laisser pour une autre. Un soir, elle a l’âme romantique et écrit à son amoureux :
Lorsque le doux zéphyr ira te caresser
Sur ses ailes oh Zémir
Renvoie-moi un baiser
Ces vers ont sans doute été inspirés par des lectures. Le zéphyr est ce vent d’ouest tiède, léger et agréable que les Grecs avaient divinisé et qui a par la suite été utilisé comme symbole poétique. Zémir(e) est un personnage d’un opéra-comique italien datant du 18ième siècle. Les vers qui suivent sont plus simples et de sa propre création :
Tu sais combien je t’aime
Toi mon bonheur suprême.
Que tu m’aimes de même
Vient me rendre l’espoir.
Tiens toujours ta promesse
Ha pour moi quelle ivresse
Quand je vais te revoir.
Puis, quand le rêve s’est brisé :
Éloigne-toi, ne sois plus mon idole
Laisse-moi libre et reçois mes vrais adieux.
J’ai trop vécu sous ta vive auréole
Mes sens glacés ne sont plus soucieux…
Quelques années plus tard, grand-mère s’unit à un homme fidèle avec qui elle vécut jusqu’à sa mort. Mais elle conserva son petit carnet et les élans de son cœur qu’elle y avait consignés.

- Au jour le jour, mars 2004
À propos du bulletin
Éditeur :
Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine
Internet : www.laprairie-shlm.com
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
Collaborateurs :
Coordination : Johanne McLean, coord.-secr.
Rédaction : Johanne McLean; Raymond et Lucette Monette (284); Hélène Charuest (59); Marie Gagné (316); Cécile Girard (426); André Montpetit (321)
Révision : Jacques Brunette (280)
Infographie : SHLM
Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.
Siège social :
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Tél. : 450-659-1393
Téléc. : 450-659-1393
Courriel : [email protected]
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, mars 2004
ERRATUM
Dans l’article du mois de février 2004 sur Denise Lemaitre, veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans le troisième paragraphe.
On aurait dû lire « Pierre Perras/Lafontaine, tonnelier, le 30-04-1684. »

- Au jour le jour, mars 2004
Le coin du livre
DONS
Merci aux donateurs dont les noms suivent :
Madame Yolande Boyer
Monsieur Michel Chrétien
Monsieur Fernand Houde
Monsieur Ronald Perras
ACQUISITIONS
- Mercenaires allemands au Québec, 1776-1783, par Jean-Pierre Wilhelmy, deuxième édition chez Septentrion (don de Michel Chrétien)
- Don Cristobal Colon, découvreur espagnol, par Fernand Houde (don de Fernand Houde)
- La Nouvelle-France, collectif (don Ronald Perras)
MACHINE À ÉCRIRE
À la suite de notre appel à tous dans le Au jour le Jour, nous avons reçu une deuxième machine à écrire.
Nous remercions monsieur André Taillon de sa générosité.
APPEL À TOUS
Il nous manque certains volumes afin de compléter notre collection. En voici une liste partielle. Merci à nos donateurs éventuels.
- Inventaire des greffes des notaires du régime français, volume XVIII, par Antoine Roy.
- Cahiers des Dix, numéros 9, 11 à 22, 27, 31, 32, 34
- Montréal, son histoire, son architecture tome 3, par Guy Pinard

- Au jour le jour, mars 2004
Nouvelles de la SHLM
La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :
– André Roy et Gaétane Jodoin, Delson (484)
– Jean-Claude Guenette, La Prairie (485)
– Linda Crevier, Ste-Catherine (486)
– Gilberte Drouin, La Prairie (487)
Conférence
Mme Hélène Côté, archéologue, chargée du projet de fouilles archéologiques dans l’Arrondissement historique de La Prairie à l’été 2001-2002, sera notre prochaine conférencière.
Après 3 saisons estivales passées dans le Vieux-La Prairie, Mme Côté viendra nous parler des résultats de l’intervention archéologique.
Mme Côté est l’auteur d’un ouvrage concernant deux sites qui ont été fouillés dans l’Arrondissement. Elle nous entretiendra des découvertes que son équipe a faites et des objets qu’ils ont trouvés.
À l’été 2002, la SHLM avait fait une exposition de certains des objets découverts. La prochaine conférence permettra donc de découvrir tous les aspects du processus de sélection d’emplacements et les trésors retrouvés.
Colloque 7 février 2004
Dans le bulletin du mois de février nous avons oublié de mentionner le spectacle de clôture. Celui-ci était divisé en deux parties : Premièrement, les Thunder Hawk, danseurs mohawk de Kahnawaké nous ont offert un spectacle de danses et chants traditionnels. Ils ont aussi invité les participants à se joindre à eux pour une danse de l’amitié.
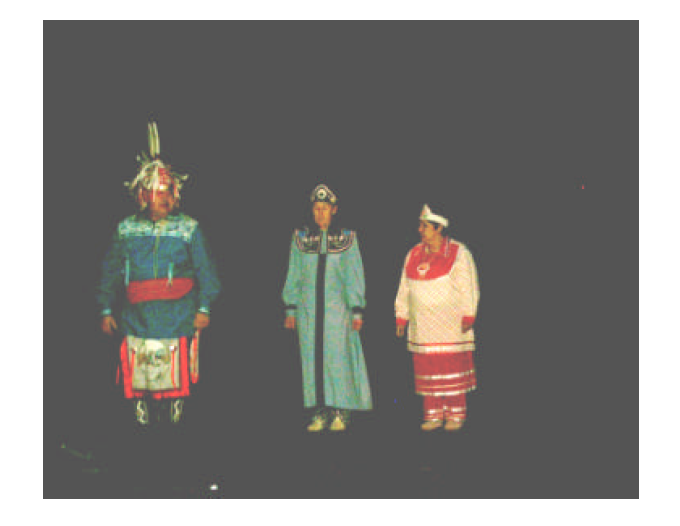
En deuxième partie, des jeunes filles du comité Héritage et Avenir de l’école La Magdeleine ont offert une magnifique performance composée de différentes chansons québécoises telles que « Mon Pays », de Gilles Vigneault, « La rue principale », des Colocs, et bien d’autres. Elles étaient accompagnées à la guitare par une jeune fille du même comité.
Bravo à nos futures stars de la chanson.

En terminant, un gros merci à Mme Pinsonneault, qui est le photographe pour les activités de la SHLM.

- Au jour le jour, mars 2004
Conférence : fouilles archéologiques
Notre prochaine conférence aura lieu le 17 mars au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.
Fouilles archéologiques
La conférencière : Mme Hélène Côté, archéologue, chargée du projet de fouilles archéologiques dans l’Arrondissement historique de La Prairie à l’été 2001-2002

- Au jour le jour, mars 2004
Mot du président
Chers membres
Les mois qui viennent seront des plus occupés. Le conseil exécutif est présentement à restructurer ses locaux ainsi que les nombreux dossiers qui occupent les bénévoles et employés. Suite au départ de Madame Patricia McGee-Fontaine, pour une période indéterminée, le dossier des archives sera assuré par monsieur Jean-Marc Garant, membre et bénévole de la SHLM ayant plus de 30 années d’expérience dans ce domaine.
Présentement la SHLM, en collaboration avec les Archives nationale du Québec, est à informatiser des documents du fonds des Jésuites qui manquaient dans les archives de la Société. Grâce à cette collaboration et avec l’aide de Messieurs Luc-Pierre Laferrière (numérisation des documents), Jean-Marc Garant et Jean L’Heureux (compilation des données à l’informatique), nous espérons obtenir le maximum d’information dans un délai raisonnable.
Un petit rappel pour les soirées de généalogie. N’oubliez pas que la SHLM est ouverte tous les lundis soir de 19h à 21h30. Des bénévoles sont présents afin d’aider les chercheurs.
En terminant, si vous avez des histoires, anecdotes ou idées d’articles, veuillez les faire parvenir à la Société. Nous sommes toujours à l’affût de sujets qui pourraient intéresser nos membres et autres Sociétés qui reçoivent notre mensuel « Au jour le jour ».
Bon début de printemps à tous
René Jolicoeur, président

- Au jour le jour, mars 2004
Ces femmes de La Prairie et ses environs, 2e partie : Marie Geneviève Sophie Raymond-Masson ( -1883)
Marie Geneviève Sophie Raymond-Masson est la fille de Jean-Baptiste Raymond (marchand) et de Marie-Clotilde Girardin. Elle se marie avec Joseph Masson à l’église de La-Nativité-de-la-très-Sainte-Vierge-Marie de La Prairie le 6 avril 1818.
On ne sait si son histoire fut un conte de fées, mais on peut dire qu’elle a mis la main sur un bon parti. Grâce à son mari, Sophie Raymond est devenue fort probablement notre première millionnaire.
« …C’était une femme supérieure, qui alliait une solide culture à une charité inépuisable. Elle s’employa notamment à développer l’enseignement secondaire… mentionnons notamment Louis Riel, le futur chef de la rébellion du Nord-Ouest, et Joseph-Adolphe Chapleau, qui fut premier ministre et lieutenant-gouverneur du Québec.
Mme Masson mourut en 1883, léguant son manoir à l’institut des Sœurs de la Providence pour la fondation d’un hospice. Plus tard, il devint le juvénat des Pères du Saint-Sacrement. » Robert Prévost, Québécoises d’hier et d’aujourd’hui, éd. Alain Stanké.
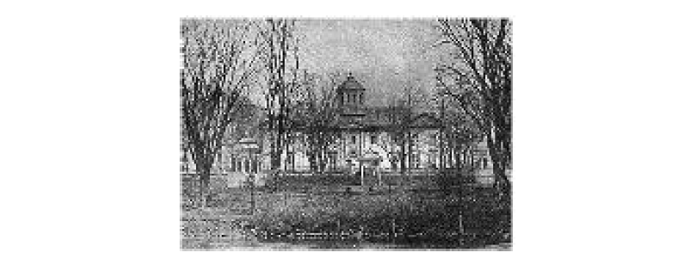
Mais qui est Joseph Masson? http://www.ile-des-moulins.qc.ca/ile.htm (parties du texte)
Un jour, bien décidé, Joseph Masson quitte Saint-Eustache pour Montréal. En 1832, il achète la seigneurie de Terrebonne dans une vente par shérif. Marchand importateur de Montréal, premier millionnaire Canadien français, juge de paix, commissaire, échevin, vice-président du conseil d'administration de la banque de Montréal, cet homme n'a pas froid aux yeux.
Homme très occupé, Joseph Masson engage un agent seigneurial pour administrer ses affaires à Terrebonne. Ce nouvel engagé se nomme Germain Raby. Joseph fait construire un nouveau moulin à farine et apporte à Terrebonne une toute nouvelle technologie provenant des États-Unis : la « roue à réaction » (la turbine!).
La roue à réaction est une merveille technologique qui remplace la roue à aubes… Cela permet aux Masson de mener une rude concurrence aux autres seigneuries.
Au printemps 1847, un bris amène Joseph Masson à descendre sous le moulin pour analyser le problème. Il prend froid et attrape une maladie infectieuse qui l'emporte quelque temps plus tard. Il laisse dans le deuil ses huit enfants et son épouse, Geneviève-Sophie, qui devient la nouvelle seigneuresse de Terrebonne.
Femme de tête, elle poursuit l'œuvre de son mari. Elle fait construire un nouveau manoir que les habitants surnomment « le château Masson »…, le bureau seigneurial d'où Germain Raby peut administrer les affaires de la seigneurie et demeurer avec sa famille ainsi que le moulin neuf qui devient l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du Bas-Canada.
La nouvelle seigneuresse fournit également les pierres et le terrain pour la construction d'une nouvelle église pouvant accueillir tous les habitants. De plus, elle achète un bateau à vapeur, le Terrebonne, pour assurer le transport des marchandises, du bétail et des passagers jusqu'à Montréal. Elle fait aussi construire un chemin pavé aujourd'hui appelé la Montée Masson.
C'est sous le règne de cette grande dame que le régime seigneurial est aboli en 1854… mais Geneviève-Sophie Raymond Masson reste à jamais la dernière seigneuresse de Terrebonne.
Prochain article : Emma Lajeunesse

