
- Au jour le jour, octobre 2016
Conférence | Chambly 1665-2015 – 350 ans d’histoire
En élevant un premier fort, le 25 août 1665, les troupes du capitaine Jacques de Chambly marquaient la naissance de la seigneurie de Chambly. Cette conférence présente l’histoire de Chambly sous le régime de la Nouvelle-France, sous l’invasion américaine et sous la guerre de 1812 (complexe militaire britannique). Elle traite également de son industrialisation du 19e siècle jusqu’à l’aube du 21e siècle.
Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, septembre 2016
Décès de Madame Lise Dumesnil
Le 21 août dernier est décédée, à l’âge de 73 ans, Madame Lise Dumesnil, belle-mère de Monsieur Réal Houde, membre et collaborateur de la SHLM. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants, ses petits-enfants, ses sœurs et son frère ainsi qu’autres parents et amis. Demeurant à Saint-Bruno-de-Montarville, elle était très impliquée dans sa communauté, notamment avec le Cercle des Fermières, Reflets de femme et la Société d’histoire de Montarville. Nous offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu’à ses amis.

- Au jour le jour, septembre 2016
Fin de la saison estivale à la SHLM
L’automne est à nos portes et l’été qui s’achève aura laissé de très beaux souvenirs à tous ceux et celles qui sont venus voir l’exposition « Ce que votre cœur n’ose dire » (en collaboration avec la Maison LePailleur), notre pièce de théâtre de rue dédiée à la bataille de 1691, faire notre rallye GPS ou notre visite guidée avec nos guides étudiants.
Nous sommes aussi très fiers du succès de la journée de commémoration des 325 ans de la bataille de La Prairie organisée le 7 août dernier en collaboration avec le Musée d’archéologie de Roussillon. Ce jour-là, plus de 100 personnes ont assisté à la conférence relative au projet « 1691 » en début d’après-midi au Musée d’archéologie de Roussillon. Un grand merci à Monsieur Richard Merlini, député provincial de La Prairie, à Caisse populaire La Prairie, à la municipalité de La Prairie (Monsieur Donat Serres, maire) et au Ministère de la Culture et des Communications pour leur aide financière dans ce projet de commémoration.
Pour permettre à ceux qui n’ont pu assister à cet événement de se mettre à jour avec les particularités du projet « 1691 », nous consacrons notre bulletin de la rentrée à cette commémoration en publiant un résumé des trois conférences données le 7 août dernier par Messieurs Bourdages, Joly et Hottin. Bonne lecture et bonne rentrée.

- Au jour le jour, septembre 2016
La bataille de 1691, un nouveau chapitre à venir

Lors de ce grand déploiement que fut, au 17e siècle, l’invasion graduelle de l’Amérique du Nord par la France, l’Angleterre et la Hollande, chacune de ces puissances voulant accaparer les plus grands territoires possible, les occasions d’affrontement ne firent jamais défaut.
La mode du chapeau de castor était alors en vogue en Europe et, en conséquence, la richesse générée par la traite des fourrures en Amérique était au centre de conflits incessants. Le succès du commerce des pelleteries était d’ailleurs soumis aux aléas des alliances avec les différentes tribus amérindiennes, dont les Iroquois représentaient, et de loin, l’élément le plus influent et le plus puissant.
Pendant que les Français, peu nombreux sur un territoire immense, hésitaient entre la colonie de peuplement et la colonie-comptoir, plus au sud, les treize colonies anglaises se peuplaient et développaient avec habileté commerces, industries et maisons d’enseignement. À la fin du 17e siècle, la Nouvelle-France, en comparaison de la Nouvelle-Angleterre, souffrait d’un retard évident. Un quart de siècle après son ouverture, La Prairie n’était encore qu’une seigneurie peu peuplée comptant à peine 110 conces-sionnaires dans les quatre côtes de Saint-Jacques, Saint-Claude, La Tortue et Saint-Lambert. D’ailleurs, plusieurs jeunes hommes préfèrent la lucrative traite des fourrures, parfois en contrebande vers Albany, à la culture de nouvelles terres.
Le premier fort de La Prairie digne de ce nom fut conçu et dessiné par Villeneuve entre 1686 et 1689, puis érigé par Gédéon de Catalogne entre l’automne 1687 et le printemps 1689. La palissade enserrait les bâtiments d’alors ce qui explique la forme particulière de son périmètre. Au moment de l’attaque du 11 août 1691, la seule d’ailleurs qu’ait jamais subie le fort, l’enceinte protège à peine plus de vingt-cinq concessionnaires. D’ailleurs, sans la présence en garnison de quelques soldats des compagnies franches de la Marine, il aurait été facile à quelque attaquant de prendre le fort sans difficulté. Bref, le fort de La Prairie est loin d’être une place forte.

et du soldat. ISBN : 2-920718-49-5. Reproduit avec la permission du
Ministère de Travaux oublics et Services gouvernementaux Canada, 2009.
Pourquoi attaquer La Prairie ?
En cette fin de 17e siècle, la Nouvelle-Hollande est intégrée à l’État de New York et les Hollandais, dont en particulier la famille Schuyler, y tiennent une large part dans les affaires politiques, militaires et commerciales. Malgré le peu de moyens, La Prairie, qui n’est qu’un petit poste de traite des fourrures, joue le rôle de poste avancé pour la protection de Montréal, qui est alors la plaque tournante du commerce canadien des fourrures et qui constitue un important centre militaire du système défensif de la Nouvelle-France.
Outre leurs motifs commerciaux, les Schuyler veulent venger les raids de l’hiver 1689-1690, dont le saccage de Schenectady par les Français en janvier 1690. De plus, comme c’est toujours le cas lorsque les métropoles s’affrontent, la guerre de la ligue d’Augsbourg (1689-1697) se transporte en Amérique. L’alliance entre l’Angleterre, les Pays-Bas (Guillaume d’Orange) et l’Espagne a pour objectif de freiner les ambitions territoriales de Louis XIV. Aussi, il est impérieux de donner une leçon à la colonie française d’Amérique du Nord.
C’est ainsi que, dans le but avoué de venger l’attaque sur Schenectady, John Schuyler, frère cadet de Peter, à la tête d’une troupe composée de vingt-neuf coloniaux et cent vingt Amérindiens, mène une attaque sur La Prairie à l’été 1690. Au cours de ce raid, on brûle les récoltes, on tue du bétail, on scalpe six personnes dont quatre femmes, et dix-neuf colons français sont faits prisonniers. L’alarme fut donnée au fort de Chambly et à Montréal, et les Amérindiens se refusèrent à attaquer le fort de La Prairie, ce qui mit un terme à la menace.
À l’été suivant, Peter Schuyler, fort des renseignements stratégiques transmis par son frère John, décide de porter une nouvelle attaque sur La Prairie. Un contingent de 266 hommes, dont une majorité d’Amérindiens, se présente à l’aube du 11 août 1691 devant le fort. Informé à l’avance d’une attaque imminente, Hector de Callières, le gouverneur de Montréal, avait déjà fait traverser son armée vers La Prairie. Il disposait également de l’appui des miliciens et d’alliés amérindiens. Par précaution, de Callières avait aussi, la veille de l’attaque, envoyé un détachement au fort de Chambly.
Le premier affrontement est une catastrophe pour les Français et leurs alliés. Les pertes sont importantes. Malgré ses succès, Schuyler n’utilise pas ses grenades incendiaires pour mettre le feu à la palissade et décide de retraiter vers les bois. Entre temps, les hommes de Valrennes, stationnés à Chambly, se sont mis en marche pour porter secours à La Prairie. C’est ainsi qu’un second affrontement aura lieu. Les pertes sont élevées de part et d’autre, et Schuyler et ses hommes finissent par percer les rangs français et atteindre leurs canots sur le Richelieu.
Malgré les travaux de M. Jean Joly, qui situe cette seconde bataille à l’ancienne intersection du chemin de Saint-Jean et du chemin menant vers Chambly, des incertitudes demeurent quant à cette hypothèse, et ce, malgré la découverte de quelques balles de fusil à silex à cet endroit il y a quelques années. Convenons que, malgré le sérieux de cette conjecture, il est possible que l’affrontement ait eu lieu à un autre endroit.
De fait, seuls des travaux archéologiques pourront confirmer ou infirmer cette hypothèse. Une journée de prospection archéologique aura donc lieu sur le site le samedi 17 septembre prochain. Ce prochain épisode de la Bataille de 1691 permettra de faire avancer le dossier et d’ouvrir de nouvelles avenues pour de futures recherches.

- Au jour le jour, septembre 2016
Les fêtes du 200e
En 2016, ce n’était pas la première fois que La Prairie commémorait la bataille du 11 août 1691. En effet, du 12 au 14 septembre 1891, La Prairie était en fête pour célébrer le 200e anniversaire de la bataille.
Le programme des fêtes
On avait organisé la tenue d’un camp militaire, un concert de chant, une conférence sur l’histoire, une grand-messe commémorative et la bénédiction de la croix érigée à l’intersection du chemin de Saint-Jean et de celui de la Bataille.
Le camp militaire (12 et 13 septembre)
Le maire Brisson avait obtenu la tenue d’un camp après plusieurs tentatives faites auprès de Sir Adolphe Caron, alors ministre de la Milice et de la Défense du Canada. Le camp militaire était dirigé par Ivor Caradoc Herbert, ancien Grenadier Guard britannique récemment nommé commandant de la milice canadienne. C’était un soldat d’expérience, catholique, et il parlait français.
Les activités de la Société littéraire (13 septembre)
Au programme des fêtes, le maire Brisson avait aussi placé une conférence de son ami historien Benjamin Sulte qu’il avait invité à la Société littéraire le 13 septembre en soirée. Dans sa lettre d’invitation, il lui avait même offert de l’héberger chez lui ; il signa T.A. Brisson, chirurgien au 85e [Bataillon]. Aussi, au programme de la même journée, il y avait un concert de chant donné dans les locaux de la Société littéraire par une cantatrice réputée que le maire avait spécialement invitée.
Le service funèbre commémoratif (14 septembre)
Le lundi 14, en avant-midi, avait lieu un service funèbre à la mémoire des victimes du combat de 1691. On assista à une grand-messe diacre sous-diacre, célébrée par le curé de La Prairie en présence, dans le chœur, d’une douzaine de prêtres, de curés des paroisses avoisinantes, d’anciens curés, de vicaires, de sulpiciens et de jésuites.
Dans l’église de La Prairie, parmi le très grand nombre de fidèles, se trouvaient les Frères de l’Instruction chrétienne et leurs élèves, les élèves du collège Sacré-Cœur rattaché au noviciat, les sœurs de la Congrégation et leurs élèves ainsi que les Sœurs de la Providence avec leurs orphelines.
La bénédiction de la croix de 35 pieds (14 septembre)
Le temps était magnifique et la foule immense. On était venu de plusieurs paroisses avoisinantes. Les musiciens de l’École militaire de Saint-Jean ajoutaient de l’éclat à la fête, grâce à une permission du commandant Herbert.
La couronne
Dans une lettre à Joseph-Octave Dion de Chambly, le maire Brisson suggérait aux gens de cette paroisse, désireux de contribuer aux dépenses concernant l’inauguration de la croix, de payer en tout ou en partie la riche couronne en fleurs métalliques qui serait attachée à cette croix. Il écrivit à ce sujet :
Elle coûtera au plus une quinzaine de piastres. Elle est belle pour vingt. Les deux localités intéressées auraient ainsi leur rôle à jouer en cette circonstance comme elles l’ont eu autrefois. Quoiqu’il arrive, cette couronne est exposée dans la vitrine de Mr Trudel, marchand libraire à Montréal, où tout le monde pourra la voir jusqu’à vendredi… Qu’en pensez-vous ? Qu’en pensent les autres amis de Chambly ?
Monsieur Dion avait sûrement approuvé l’idée puisque le curé Bourgeault écrira plus tard que la belle couronne de fleurs en fer émaillé provenait d’un don de la paroisse de Chambly.
La cérémonie
La cérémonie débuta par un discours de circonstance prononcé par le curé Lesage de Chambly, au pied de la croix. Puis, Joseph Morin, curé de Saint-Jacques-le-Mineur, procéda à la bénédiction. La foule fut ensuite invitée à prendre place dans des estrades aménagées juste en face de la croix. Une série de discours patriotiques débuta.
Les orateurs
S’élancèrent alors dans l’ordre : Joseph-Octave Dion, président du Cercle Saint-Louis de Chambly et l’un des principaux organisateurs des fêtes ; Louis-Conrad Pelletier, avocat et député fédéral du comté ; Thomas-Auguste Brisson, médecin installé à La Prairie depuis 1878 et maire de cette municipalité depuis 1885 ; Florent Bourgeault, curé de la paroisse depuis 1877, célébrant de la grand-messe diacre sous-diacre de l’avant-midi et coordonnateur de la cérémonie de bénédiction de l’après-midi.
Les orateurs parlèrent en catholiques convaincus et en patriotes sincères et, selon le curé Bourgeault, ils évitèrent habilement l’écueil de la politique…
Ainsi, le 14 septembre 1891 à La Prairie, se terminèrent les grandes fêtes du 200e anniversaire de la bataille du 11 août 1691.
Source :
Jean Joly, La croix de chemin à la mémoire du combat
du 11 août 1691 au rang de la Bataille, 2e édition, 2016.

- Au jour le jour, septembre 2016
Un projet de recherche archéologique sur la bataille de La Prairie
La bataille de La Prairie de 1691 a fait l’objet de plusieurs recherches historiques au cours des dernières années. L’analyse des textes anciens a permis de faire avancer les connaissances sur les évènements entourant cet affrontement. Il reste cependant plusieurs éléments à éclaircir, notamment le lieu exact de l’embuscade tendue par les troupes françaises et amérindiennes, menées par Valrennes, à celles de Schuyler. C’est dans ce but que le Musée d’archéologie de Roussillon, en partenariat avec la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, a entrepris de mener une journée de prospection archéologique à l’automne dans le secteur du rang de la Bataille.
L’objectif de l’intervention est de tester une des hypothèses proposées par les historiens de la région. Une équipe composée d’archéologues professionnels et de bénévoles triés sur le volet aura pour mandat d’inspecter des terrains agricoles, à la recherche d’indices de l’affrontement de 1691. Balles de mousquets, pierres à fusil en silex, lames de haches et de couteaux, boutons militaires et autres artefacts découverts en surface seront prélevés puis localisés à l’aide de GPS. Après cette journée sur le terrain, les objets et les données géographiques seront analysés en laboratoire par les archéologues. Les résultats seront consignés dans un rapport, puis rendus accessibles au public par le Musée d’archéologie de Roussillon. Consultez le site Web du Musée pour suivre l’avancement des travaux !
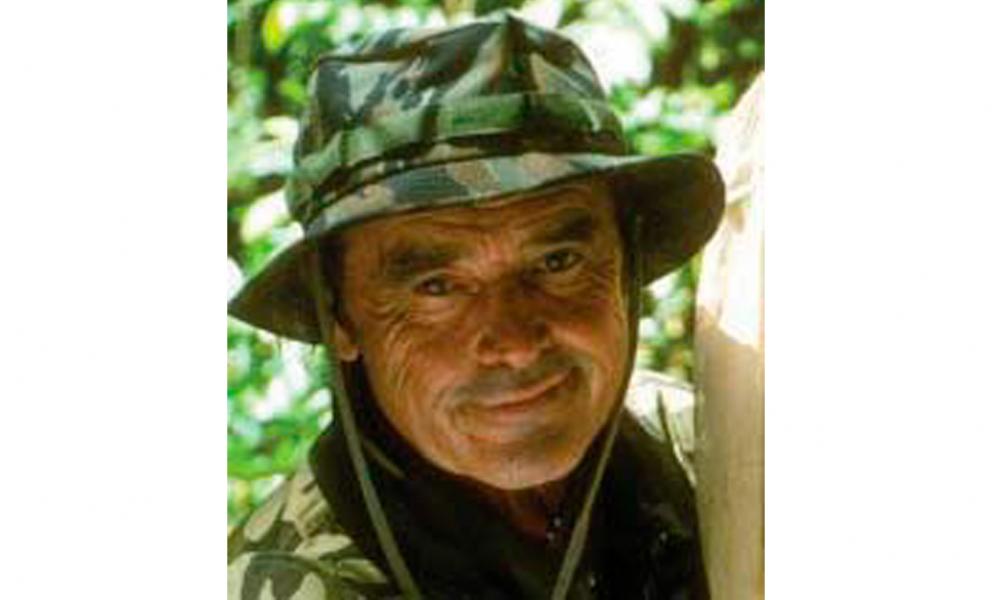
- Au jour le jour, septembre 2016
Conférence | George Brossard
Conférencier: Monsieur George Brossard
Monsieur Brossard, entomologiste et globe-trotter célèbre, est un retraité qui ne connaît pas le repos. Grâce à sa conférence dynamique portant sur des sujets variés, il vous expliquera comment planifier votre retraite et comment l’occuper avec diverses activités de nature historique. Cette conférence où règne les anecdotes de voyages et les expériences de vie sera empreinte de notions d’anthropologie, d’histoire et de généalogie.
Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.
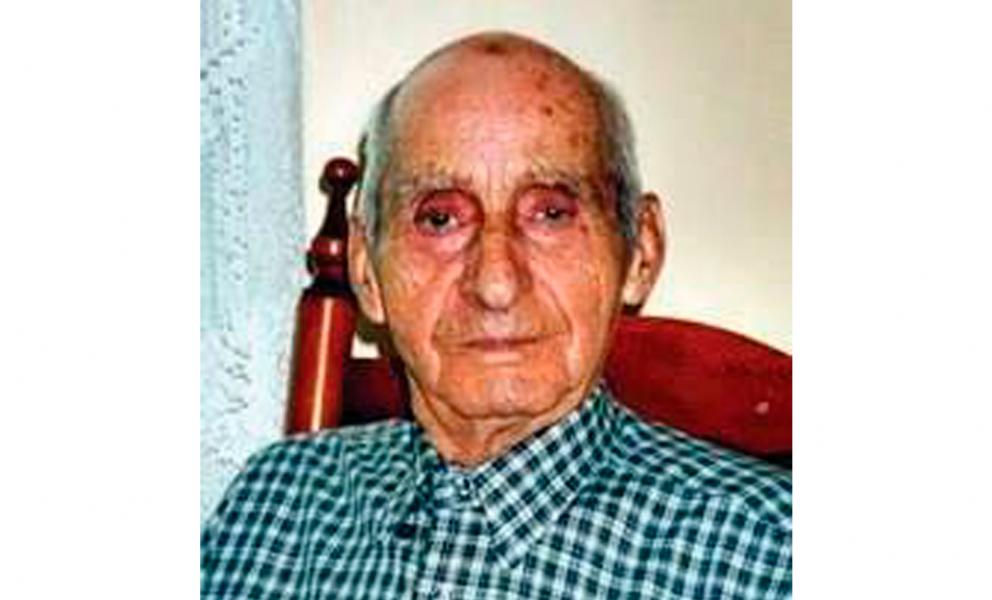
- Au jour le jour, septembre 2016
Décès de Monsieur Philippe Lemieux
Le 3 juillet dernier est décédé, à l’âge de 92 ans, Monsieur Philippe Lemieux. Il laisse dans le deuil son épouse, Madame Yvette Moquin, ses trois filles, son frère et sa sœur ainsi qu’autres parents et amis. Demeurant à Candiac, Monsieur Lemieux était un membre de longue date de la SHLM et il visitait souvent notre local pour y faire des recherches sur les vieilles familles de la seigneurie de La Prairie avec Madame Solange Lamarche et Monsieur Jean L’Heureux. Nous offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu’à ses amis.
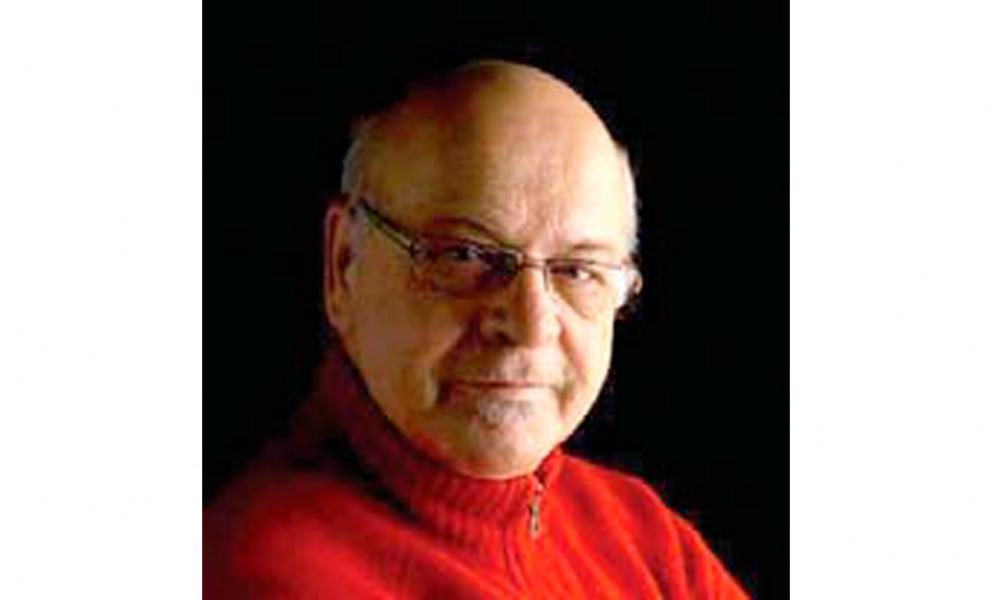
- Au jour le jour, septembre 2016
Décès de Monsieur Robert Champoux
Le 12 août dernier est décédé, à l’âge de 68 ans, Monsieur Robert Champoux. Il laisse dans le deuil son épouse, Madame Gisèle Arnaud, ses deux enfants, ses petits-enfants ainsi qu’autres parents et amis. Demeurant à Sainte-Catherine, Monsieur Champoux était retraité de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries (école La Magdeleine) et a été président de la SHLM en 1990-91. Nous offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu’à ses amis.

- Au jour le jour, juin 2016
La Prairie : l’opération militaire de l’été 1691 (Partie 3)
Le rapport de Livingston confirmait entre autres que, « Nous avons interroger Symon Groot, qui a été remis à un de nos indiens par un Agnier catholique,… il confirme leur manque de provisions ; les forces dans la région de Mont Reall (sic) étaient moins de 300 soldats et qu’il y a environ 50 hommes (miliciens inclus) à La Prairie, où nos gens veulent attaquer… aussi il n’y a qu’une garnison de 20 soldats au village palissadé des Agniers au Sault-Saint-Louis. »Sachant qu’il y avait souvent des agents ou « spyes » parmi eux, le commandant de cette demi-compagnie avait ordre de mettre le Sault–Saint-Louis en quarantaine pendant que La Prairie était sous commandement militaire. Charles de Monseignat, le secrétaire de Frontenac, confirme que deux jours avant l’attaque « on détachait continuellement des partis pour aller à la découverte ; un des fils du sieur Hertel (Zacharie-François Hertel, sieur de la Frenière, 26 ans, interprète, lieutenant des guides) accompagné de trois Algonquins et d’un Sauvage de la Montagne, découvrit un canot dans la rivière de Richelieu, au dessus du portage de Chambly (St-Jean) sur lequel il tira ; ce canot était d’Agniers (Mohawks) qui venaient aussi à la découverte. » NB : À remarquer qu’il n’y a aucun Agnier du Sault en patrouille avec le sieur Hertel. .
M. Henry Slaughter, le gouverneur de la Province of New Yorke, était également présent à Albany, et il était maintenant convaincu, plus que jamais, que le moment était propice pour passer à l’action. Et, très rassuré par les propos du jeune Symon Groot, Slaughter ordonna à Pieter Schuyler et son armée de se mettre en marche, tambours battants, trois jours plus tard.À la pleine lune suivante (9 août, 1691), Schuyler et son armée devaient faire jonction dans les environs de La Prairie avec une troupe de 500 Iroquois des Grands Lacs et ensemble ils devaient mettre La Prairie à feu et à sang, et par la suite attaquer « Mont Reall … where they had their designe ». Mais, pour son plus grand malheur, Callières l’attendait au fort La Prairie non pas avec quelques soldats, mais plutôt avec la moitié de l’armée de la Marine que M. le comte de Frontenac avait discrètement fait parvenir, dans les jours suivants, à La Prairie et au fort Chambly.
L’envahisseur newyorkais fut donc étonné et désemparé (shock & awe) comme l’avait si bien planifié Callières, le gouverneur militaire de Montréal. Dès lors, le major Schuyler et son armée, en tombant dans ce piège, sont mis « entre deux afin qu’ils ne nous eschapassent pas, ce qui réussit assez bien pour la gloire des armes de sa Majesté, ayant resté plus de 100 des ennemys sur la place avec leur drapeau et quelques prisonniers que nous prismes… » !Louis-Hector de Callières, Gouverneur militaire de Montréal. — Lettre au ministre, 1691 et 20 septembre 1692. (À noter que Callières, avant d’être nommé gouverneur de Montréal, avait eu 20 ans de service militaire, ayant combattu pour son roi sur tous les champs de bataille européens. Louis-Hector était doué d’une vive intelligence, avec un bon sens de discipline et de commandement, en plus, il était un habile négociateur, ce qui lui sera très utile dans ses rapports avec les Indiens. Et en conséquence, Callières sera reconnu comme un des principaux architectes de la Grande Paix de Montréal en 1701).
En conclusion, cette grande bataille épique qui eut lieu dans la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine fut gagnée non seulement sur le terrain par l’héroïque bataillon du commandant de Valrennes, mais en grande partie grâce à la qualité du renseignement et du réseau d’espionnage de cet homme de guerre exceptionnel qu’était Callières, le gouverneur militaire de Montréal.

