
- Au jour le jour, mars 2002
Appel aux membres
Le bulletin est votre bulletin. On y présente les nouvelles de la SHLM pour vous tenir informés, et des textes que nous croyons devoir vous intéresser. Laissez-nous savoir (par téléphone, courriel ou télécopie) quels types d’articles vous désirez. N´hésitez pas à nous indiquer quels sont vos sujets préférés.

- Au jour le jour, mars 2002
Notre dernière conférence : les trésors enfouis de La Prairie
La dernière conférence présentée par l’archéologue Hélène Côté nous a révélé une fois de plus la richesse de notre patrimoine archéologique. Mme Côté a fait le bilan des deux dernières campagnes de fouilles (2000-2001) qu’elle dirigeait à La Prairie.
Le premier secteur des recherches se situait dans la cour arrière de l’ancien Bar Tourist, près de la rue Saint-Ignace. De nombreuses structures d’habitations y ont été mises au jour. Toutefois, les plus intéressantes sont celles qui se retrouvent dans la couche datant du début de l’occupation française au 17e siècle.
Il s’agit d’habitations semi-souterraines en bois. Enfouies dans la terre jusqu’à une profondeur de 1 mètre 50 (4 pieds 6 pouces), elles étaient surmontées d’un toit en pente. Ce dernier était probablement recouvert de chaume et descendait jusqu’au niveau du sol. Les murs étaient faits de planches posées à la verticale. Un pieu retenait chacun des coins de l’habitation.
La plupart des éléments composant cette structure ont été découverts l’été dernier dans la structure la plus à l’est. Cette technique de construction remonte au Moyen Âge et c’est, jusqu’à maintenant, le seul exemple que nous ayons au Québec.
Ces habitations étaient temporaires et pouvaient aussi servir à l’entreposage. Il est fort possible que les premiers Laprairiens s’en soient servis en attendant de pouvoir se loger dans des maisons plus permanentes. Elles ont peut-être été utilisées ensuite par des employés ou des domestiques.
Les artefacts trouvés dans la structure à l’ouest mise au jour à l’été 2000 suggèrent une utilisation à des fins commerciales (commerce des fourrures?). De plus, on y a trouvé de nombreux os de poulet provenant de carcasses entières. Aurions-nous la présence du premier poulailler à La Prairie?
La structure à l’est avait plutôt une fonction domestique. Elle présente une importante couche d’incendie qui marque la fin de son utilisation. Comme nous sommes sur les terrains ayant appartenu au pionnier François Rouannais au 17e siècle, il est fort probable que ce soient des maisons lui ayant appartenu. De même celle se trouvant à l’ouest se trouve sur un lot ayant été vendu aux Bisaillon par Rouannais. Nous savons que les frères Bisaillon étaient des coureurs des bois. Ce qui confirmerait l’utilisation commerciale du bâtiment.
Lors de fouilles de l’été dernier, les recherches ont été entreprises sous le trottoir de la rue Saint-Ignace. On a constaté que le tracé et la largeur de la rue ont peu changé depuis le 18e siècle. Cet endroit correspond à la devanture des maisons qui se trouvaient directement sur la rue. De nombreux fragments de céramique y ont été mis au jour, car à cette époque les gens jetaient leurs rebuts directement à la rue. Le service de collecte des ordures n’existait pas encore… Comme les fragments étaient assez gros, donc non piétinés, les archéologues en ont conclu que les piétons évitaient de marcher près des maisons afin de ne pas recevoir des détritus sur la tête. Sage précaution.
La deuxième aire de fouilles en 2001 se trouvait sur les terrains de la résidence La Belle Époque au coin du chemin de Saint-Jean et de la rue Émilie-Gamelin. Encore une fois, les résultats ont été des plus encourageants. Les fondations du manoir des Jésuites et de la résidence des Sœurs de la Providence ont été excavées, l’une étant adossée à l’autre. Enfin, des pieux du bastion nord-est de la palissade ont été découverts. Nous avons maintenant la localisation exacte des quatre coins des fortifications. Ce qui nous permettra d’apporter plus de précisions au plan de superposition que la SHLM avait déjà effectué.
Comme cette dernière intervention était exploratoire et qu’elle a été très positive, il est presque certain que l’équipe de l’Université Laval y reviendra. D’ailleurs, Mme Côté nous a confirmé le retour du chantier-école de l’Université Laval à La Prairie pour une troisième année consécutive. C’est donc un rendez-vous que je vous propose pour le mois d’août 2002.

- Au jour le jour, mars 2002
Projet étudiants d’été
Nous avons fait, encore cette année, une demande dans le cadre de Placement-Carrière-Été ainsi que Jeunesse Canada au Travail pour embaucher des étudiants durant la saison estivale. Ces emplois saisonniers permettent à la Société d’offrir des heures d’ouverture plus longues et sur plus de jours, ainsi que des visites guidées aux touristes et autres visiteurs. Cela permet également de libérer notre secrétaire et des bénévoles de certaines de ces tâches et d’avancer ainsi des travaux jugés essentiels pour la SHLM.

- Au jour le jour, mars 2002
Généalogie : avis de recherche
Lors de recherches généalogiques, il est courant de frapper un mur, de bloquer sur un personnage dont on ne peut retracer la descendance ou l’ascendance.
Plusieurs membres s’adonnant à la généalogie, il est possible que quelqu’un ait rencontré le même problème et trouvé la réponse.
Cette section est ouverte afin d’initier un réseau d’entraide entre les membres et autres lecteurs du bulletin.
Pour y participer, il suffit de nous faire parvenir un court résumé de votre questionnement en n’oubliant pas les éléments essentiels à bien identifier l’objet de votre recherche.
Nous publierons l’objet de votre recherche dans cette chronique, ainsi que la réponse obtenue le cas échéant.
Les questions et réponses seront numérotées successivement afin de les identifier adéquatement : Questions = Q 1, 2, 3… Réponses = R 1, 2, 3…
Q.5 CANNOP/AINRELOR
Je suis à la recherche des parents de Marie CANNOP qui a épousé Pierre PARADIS, fils de Pierre et Thérèse ASSELIN, le 25 octobre 1808 à Saint-Nicolas-de-Lévis. Ses parents seraient probablement Antoine CANNOP marié à Marie -Madeleine AINRELOR/AMELOR.
Q.6 CANNOP/AINRELOR
Les parents d’Antoine CANNOP pourraient-ils être Irlandais, émigrés ou non?
André G. ROBIDOUX (230)

- Au jour le jour, mars 2002
C’est la vie… de la SHLM
Avis important
Nos récentes annonces de livres mis en vente ont suscité beaucoup de réponses.
Nous avons deux catégories de livres à vendre :
– ceux provenant de la bibliothèque (livres usagés),
– ceux dont la SHLM est éditeur ou dépositaire (livres neufs).
Les livres vendus ou offerts par la bibliothèque sont parfois usagés mais en bon état, habituellement des doubles. Nous les vendons à prix moindre que celui du marché. À moins d’indication contraire, nous ne disposons que d’un seul exemplaire en vente. Règle générale, ces exemplaires proviennent de dons d’institutions ou d’individus.
Vu notre manque d’espace au local, la majorité de ces livres sont conservés en entrepôt; il n’est donc pas possible de les consulter ou de vous les procurer en vous rendant au local sans avis préalable.
Nous recommandons que vous laissiez vos coordonnées et l’objet de votre intérêt à notre secrétaire ou sur le répondeur. Dès que le volume devient disponible au local, on vous en communique l’information.
Les livres neufs sont toujours disponibles au secrétariat.
Changement de dénomination
C’est maintenant officiel : depuis le 21 janvier dernier, notre société porte maintenant le nom de Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine.
Cette nouvelle dénomination est maintenant conforme aux règles de la langue française.
Nouveaux membres
La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :
Mme Marielle DESLIPPE-DUQUETTE, Chambly, (405)
Mme Lucille LONGTIN, La Prairie, (406)
Nouvelle exposition
Nous sommes à préparer une nouvelle exposition sur les résultats des recherches archéologiques réalisées depuis 30 ans dans le Vieux-La Prairie. Nous y suivrons l’évolution sur 4 périodes marquées de notre territoire :
- La Prairie préhistorique
- Les pionniers
- Les fortifications
- La Prairie au 19e siècle
L’ouverture de l’exposition devrait se faire vers la mi-mai.
Rappel
Le local de la SHLM est maintenant ouvert le 2e lundi soir du mois pour les recherches généalogiques individuelles.
Brunch
Le brunch annuel de la SHLM se tiendra le 9 juin 2002 au restaurant le Vieux-Fort. N’oubliez pas de mettre cette date à votre agenda. Nous vous aviserons ultérieurement de l’heure et des autres détails de cette activité.

- Au jour le jour, mars 2002
Dons
Nous avons reçu de M. Serge GEOFFRION, député du Parti québécois, divers documents et photographies.
- La Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly nous a gracieusement remis un ensemble de diapositives et livrets d’information sur La Prairie et Candiac.
- La donation monétaire de la Fondation de la SHLM est appliquée à l’achat d’un système informatique assez puissant et polyvalent pour devenir un serveur efficace de notre réseau interne.
Merci à nos généreux donateurs.

- Au jour le jour, mars 2002
Notre prochaine conférence
Les chansonnières, 1960-1976
par Cécile TREMBLAY-MATTE, auteure de La chanson écrite au féminin
Venez revivre ces années de poésie que nous ont fait connaître les Pauline Julien, Clémence, Louise Forrestier, Jacqueline Lemay et bien d’autres porte-drapeaux de la chanson québécoise.

- Au jour le jour, mars 2002
Message du président
Le 26 janvier dernier, dans le journal Le Reflet, paraissait un article concernant la réfection et la modification de l’autoroute 15, entre autres parties face à l’arrondissement historique du Vieux-La Prairie. Le ministère des Transports du Québec rejette, pour l’instant, l’idée de refaire l’autoroute 15 en tranchée, projet présenté à la Ville il y a quelques années afin de redonner à l’arrondissement historique et à l’ensemble de la population l’accès visuel et physique au fleuve le plus près possible de ce qu’ils étaient avant les travaux de construction de la route.
Parmi les mandats de la Société d’histoire de La Prairie, la préservation du patrimoine est un des plus importants. À titre d’organisme à mission de protection du Vieux-La Prairie, nous sommes interpellés par tout changement visant l’autoroute 15. Le conseil d’administration de la SHLM a donc écrit une lettre à la Ville de La Prairie, avec copie aux diverses instances impliquées, pour appuyer sa démarche et celle des citoyens requérant une révision en profondeur du projet. Cette lettre a été envoyée aux ministères concernés ainsi qu’à Ville de La Prairie.
Depuis 1975, le Vieux-La Prairie est classé Arrondissement historique par le ministère de la Culture. La Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine est d’avis que cette reconnaissance requiert des autorités, et particulièrement du ministère des Transports, de prendre en compte une planification compatible avec un arrondissement à caractère ancien reconnu et classé.
La Société d’histoire est consciente de la nécessité du rajeunissement et de modifications à apporter à ce tronçon de route. Cependant, les changements ne devraient pas être faits au détriment de la quiétude des habitants du secteur historique et surtout pas en détériorant à jamais ce qui reste du paysage, témoin du passé. Bien au contraire, l’occasion est belle de réparer certaines des erreurs commises antérieurement.
Jean L’HEUREUX, président
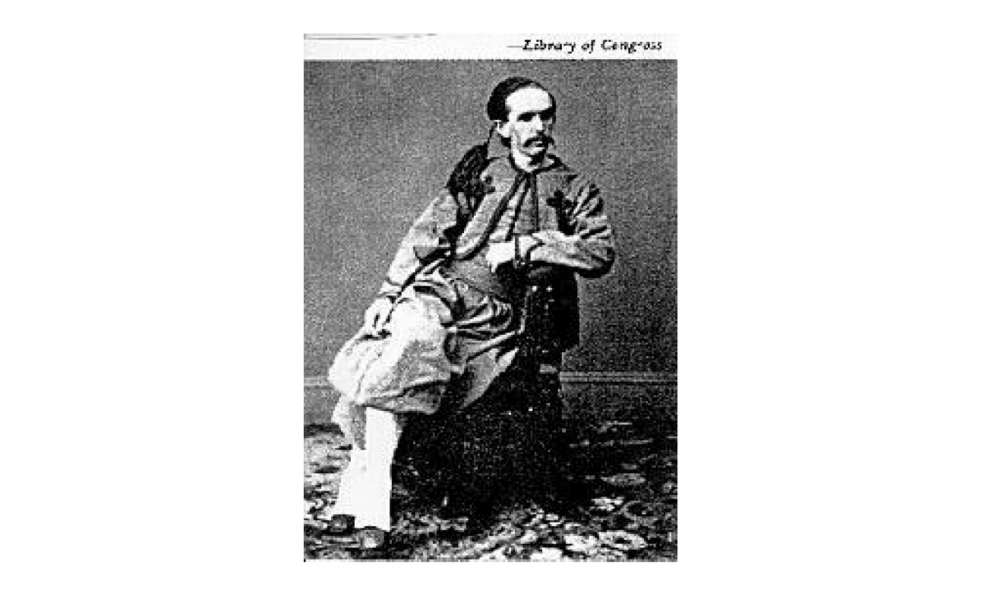
- Au jour le jour, mars 2002
Un fugitif américain soupçonné du meurtre de Lincoln trouve asile au presbytère de La Prairie
T. M. Harris, dans son rapport « Histoire d'une grande conspiration », relate les événements qui ont conduit à l'arrestation de John Surratt, présumé complice dans l'affaire de l'assassinat à Washington, d'Abraham Lincoln.
Le climat agité aux É.-U. dans les années 1850-60 provoque une guerre civile (sécession). Dans le Sud, les propriétaires terriens requièrent la main-d’œuvre des esclaves pour la culture intensive du coton et autres denrées. Les Américains du Nord sont antiesclavagistes. La guerre s'étendra de 1861 à 1865 et les forces du Sud subiront la défaite.
Lincoln, élu président de l'union en 1859, est réélu en 1864. Il est assassiné le 15 avril 1865. Se sachant traqué, John Surratt, présent lors de la tentative d'enlèvement du président, s'enfuit vers le Québec.
Dans ce court historique nous verrons quand et pourquoi Surratt, un catholique, trouve refuge, entre autres, au presbytère de La Prairie. Utilisant maints stratagèmes, Surratt quitte Baltimore, traverse le lac Champlain, prend le train à Burlington et arrive finalement à Montréal. L'odyssée fut des plus dangereuses et le fugitif angoissé craignait d'être reconnu et arrêté.
Un Américain du sud vivant à Montréal, le cache pendant quelques jours. PorterField, son hôte, connaît assez bien quelques prêtres catholiques. C'est vers eux qu'il cherche une solution pour abriter Surratt en lieu sûr.
La coutume millénaire dans les pays chrétiens veut que les églises et résidences des moines et prêtres soient des lieux inviolables. Quiconque, fusse-t-il le pire criminel, se prévalait du droit d'asile y trouvait un lieu strictement sécuritaire. Surratt est hébergé chez le curé Boucher, à Saint-Liboire situé non loin de Montréal.
Après 3 mois, on décide de la transférer au presbytère de La Prairie. Le vicaire Pierre Larcille La Pierre voit à son bien-être et sa sécurité pendant 2 mois. La Pierre a œuvré à 9 endroits différents au cours de son ministère.
Lorsqu'il prend charge de Surratt, il est au fait des lourds soupçons qui pèsent sur son hôte. Il connaît également le rôle joué par ce dernier dans le complot d'enlèvement du président. Lors du procès tenu aux É.- U., il acceptera d'agir à titre de témoin volontaire; le curé Boucher de St-Liboire fera de même.
Sachant que Surratt risque d'être trahi, ses amis décident de l'expatrier outremer. Sur le navire anglais le Peruvian il se libérera de son angoisse en racontant par le menu détail tous les événements auxquels il a été mêlé. Son confident, le chirurgien Mac-Millen, découvre finalement l'identité de son interlocuteur. Surratt, dont le nom d'emprunt était McCarty avoue alors : « Je sais que je serai pendu si je retourne aux É.-U. »
Surratt reste peu de temps à Liverpool et fuit rapidement vers l'Italie. Il était bien loin de se douter que c'est là que sa bonne étoile le quitterait. Sous le nom de Watson, Surratt se joint aux Zouaves pontificaux, à 40 milles de Rome. Il y rencontre une vieille connaissance de Washington, Henry Benjamin Sainte-Marie. Ce dernier, né au Québec, à immigré aux É-U dans sa jeunesse.
Notre fugitif, comptant sur la compréhension de son ami, lui raconte les événements de l'enlèvement de Lincoln et les aventures de sa fuite. En devenant soldat du Pape, il anticipe la sécurité qu'il cherche désespérément.
Par contre, Sainte-Marie décide d'obéir à son devoir de citoyen américain et avise le consul des É.-U. à Rome de la présence de Surratt. Informé à son tour, le Pape est d'avis que le présumé complice doit être livré à la justice. Incarcéré, Surratt réussit à s'échapper.
Son objectif est de se diriger vers Naples pour naviguer de là vers Alexandrie en Égypte. Dès son arrivée au port il est appréhendé, enchaîné et remis aux officiers d’un navire américain en partance pour les États-Unis.
Devant la commission militaire qui enquête sur l'histoire de la conspiration et de l'assassinat de Lincoln, il est prouvé, selon les témoignages, que Surratt était complice de l'enlèvement. Cependant, certains témoins sont formels, l’accusé a été vu ailleurs le soir du 3 avril 1865, jour du meurtre. Grâce à cet alibi, il est acquitté.
Sa mère Mary Surratt, n'eut pas sa chance.
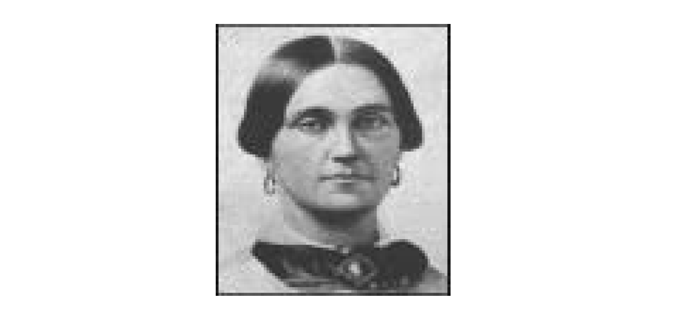
Il fut prouvé que, dans sa pension de famille, le groupe qui tramait le crime y tenait régulièrement ses rencontres. Condamné pour son silence, elle fut pendue le 7 juillet l865.
H.-B. Sainte-Marie avait touché 20 000 $ sur les 25 000 $ de la prime promise en récompense à qui livrerait Surratt. À l'occasion de son décès en 1874, le journal Le National mentionne explicitement son rôle dans l'arrestation de John Surratt.
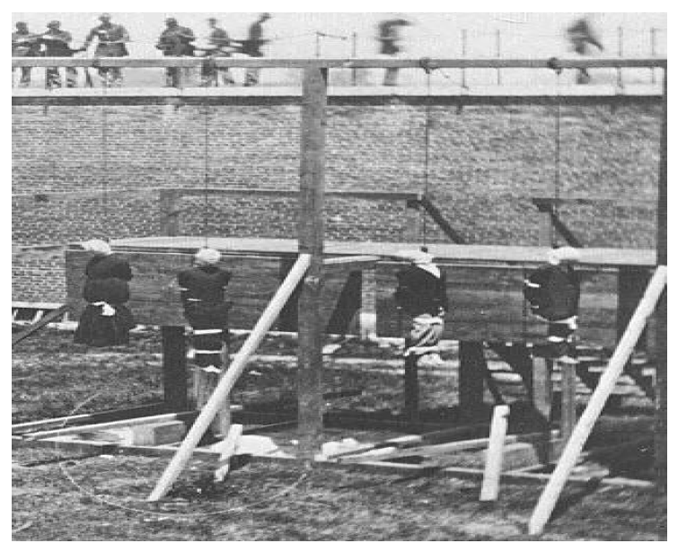
Recherche : Claude Desrochers (79), Johanne McLean
Sources : Harris T. M., A history of the Great Conspiracy, 1890 Military Commission Archevêché de Montréal.

- Au jour le jour, mars 2002
La Vie… de nos ancêtres
Suite au numéro précédent, nous poursuivons notre exploration du monde que nos ancêtres ont choisi de quitter pour créer un pays neuf avec le plus mince des bagages.
Nous essayons de saisir l’avantage que ce déplacement pratiquement sans retour représentait pour eux. Nous en sommes toujours à voir cet aspect important de la vie de nos ancêtres en France par un premier biais qui est celui de l’habitation du paysan à cette époque.
La maison du paysan de France (suite)
« Bien entendu, la maisonnette toute de pierre ne pouvait entraîner de tels inconvénients. [Perméabilité au froid, à la pluie, risques importants d’incendie, etc.] Ainsi ces bories de l’actuel Vaucluse, entièrement de pierre ou taillées dans le roc, habitées encore voici moins d’un siècle, et où, par surcroît, chaque compartiment avait reçu une sorte de spécialisation : cuisine, souillarde, chambre et salle, soue, bergerie, fenil, grenier… ce qui n’était en rien le propre des petites chaumières communes, accompagnées de rustiques et branlantes bâtisses mi-étables mi-hangars, qui n’abritaient pas grand-chose.
Relativement préservées également du grand danger de brûlement, les maisons qualifiées de troglodytiques qui accompagnent encore les coteaux du Cher, de la Vienne, de la Loire tourangelle et angevine, et quelques autres lieux. Logées dans une grotte, avec une façade de belle pierre, la cheminée dépassant dans la prairie ou le bosquet du plateau faisant fonction de toiture, prolongées souvent par de profondes caves, ces demeures, sombres sans doute mais pas plus que les autres (de toute manière la chandelle coûtait cher), restaient fraîches l’été, tièdes l’hiver, à peu près ininflammables, et n’empiétaient en rien sur le sol agricole ou pastoral, ni surtout sur la pente viticole. Et puis, on pouvait toujours creuser un ou deux trous à côté pour y loger les futailles, l’âne, les moutons, la vache.
Devant la plupart de ces maisons, une sorte de cour parfois close, avec le fumier, modeste, et qui laisse malencontreusement s’écouler son précieux suc, le purin parfois vers le puits; peu de volailles picorant (elles ont trop tendance à rechercher le blé si précieux à l’homme); quelques bâtiments sommairement construits et souvent croulants pour les outils, le bétail et d’hypothétiques provisions, fagots ou paille plus communément; des morceaux de bois et de potain (pots de terre cassés) gisant un peu partout, et que l’inventaire après décès n’oublie jamais d’évaluer; pas toujours de puits (ceux-ci sont souvent communaux, comme la fontaine et le four ou bien seigneuriaux); le four, assez souvent, soit au bout de la maison, soit dans un petit bâtiment très proche; parfois une mare, dangereuse et sale, puisqu’on y laisse rouir le chanvre, ce qui ajoute des parfums inexprimables à tous ceux de la crasse et des déjections. Presque toujours, l’indispensable jardin, domaine de la femme lorsque l’homme l’a retourné, avec ses carrés de choux, de raves et de fèves, plus quelques arbres fruitiers souvent à demi sauvages l’art de greffer ne semblant pas universel.
Entre ces différents lieux et quelques autres, les paysans du XVIIe siècle comme longtemps leurs descendants se déplaçaient presque incessamment : aller quérir de l’eau, du bois, de l’herbe, sortir, rentrer ou curer (rarement) la vache; aller à son champ, ou au four banal (une fois la semaine ou le mois), au lavoir (plus rarement encore, la sueur et la crasse étant tenues pour réchauffantes et presque saines), au bois (et au braconnage), en journée chez le gros fermier, vers les grands travaux collectifs de moisson et de vendange, plus le marché de la ville voisine, au moins une fois par quinzaine (sauf veau, agneau, poulets, œufs à vendre). Itinéraires presque rituels, marqués par des arbres familiers, de vieux murs, des ronciers, une borne, une croix, (se signer en passant devant), le pigeonnier seigneurial, le presbytère, l’église et son enclos…
Itinéraires accoutumés et fréquents travaux au-dehors amènent à se demander qui restait à la maison, et quand. Les vieux? nous verrons bientôt qu’ils disparaissaient très vite; les enfants? petits, la mère les emmenait; plus grands, le père les utilisait déjà. La maison est surtout l’endroit où l’on soupe où l’on dîne vers midi, plus rarement et celui où l’on dort, en tas pour se réchauffer; où l’on veille rarement trop chère, la lumière d’une chandelle ou d’un caleil; où l’on fornique l’hiver (l’été, il y a la nature); où l’on naît; où l’on meurt.
Bien sûr, les plus vastes et plus solides demeures des paysans aisés et des gros fermiers (avec valets et servantes) présentaient ces spectacles maintes fois décrits et parfois peints ou gravés : de longues tablées de convives, le maître président (sic), et les femmes aux marmites, près du foyer; quelques veillées de travail (et, à l’occasion, de bavardage), chacun profitant de l’espace, du feu commun et de la lumière commune. Coutumes non générales, propres aux solides maisons des belles exploitations, qui seront présentées à leur place. »
Tiré de La vie quotidienne des paysans français au XVIIe s. par Pierre GOUBERT, Editions Hachette

