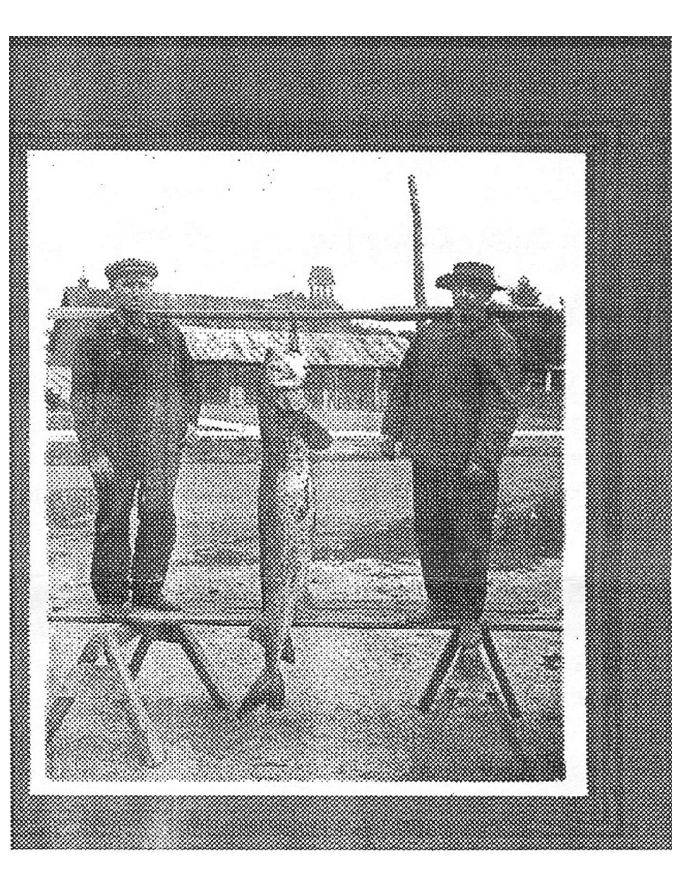- Au jour le jour, novembre 2002
À propos du bulletin
Éditeur :
Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine
Internet : www.laprairie-shlm.com
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
Collaborateurs :
Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.
Rédaction : Gilbert Beaulieu; Odette Lemerise (408); Jean L’Heureux (179); Johanne McLean
Révision : Gilbert Beaulieu (361); Céline Lussier (177)
Infographie : Révisatech
Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.
Siège social :
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Tél. : 450-659-1393
Téléc. : 450-659-1393
Courriel : [email protected]
Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, novembre 2002
Échos… de la bibliothèque
Dons
Merci à nos donateurs qui nous permettent d'enrichir notre bibliothèque au fil des années.
Succession Claudette Houde
Mme Patricia McGee-Fontaine
MM. Jean-René Côté et Raymond Monette
Mme Louise Dupré
Nouvelles acquisitions
- Bringing your family history to life through social history, de Katherine Scott-Sturdevant (don de Gayle Hathorne, de New-York)
- Outagami. Comment trouver ses origines amérindiennes, de Réjean Chauvette (don de Sylvain Rivard)
- Édits, ordonnances royales, déclarations et arrêts du Conseil d'État du Roi 1627-1756 (don de Claudette Houde)
- Ordonnance des intendants et arrêts portant règlements du conseil supérieur de Québec, 1540-1758 (don de Claudette Houde)
- Introduction à la paléographie, méthode 2 de Marcel Lafortune (don de Raymond Monette)
- Histoire de la paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu, de Jean-Baptiste Allaire (don de Gaétan Trudeau)
- Ustensiles en Nouvelle-France, de Robert-Lionel Séguin (don de Gaétan Trudeau)
- Répertoire des baptêmes de l'Assomption (don de Patricia McGee-Fontaine)
- Château fort de Longueuil, 1698-1810, de Louis Lemoine (don de Patricia McGee-Fontaine)
- Terrier du Saint-Laurent en 1674, de Marcel Trudel (don de Patricia McGee-Fontaine)
- Régiment de Carignan 1665-1668 de Robert Gareau (Don de Patricia McGee-Fontaine)
- Origine de Montréal, Brault Jean-Rémi (don de Jean-René Côté)
Avis de recherche
- Histoire de la Province de Québec de Robert Rumilly. Nous avons toute la collection sauf les numéros 31 et 32.
À vendre
Encyclopedia of Canada, en 6 volumes de Steward Wallace – 60 $
Histoire des Canadiens-Français de Benjamin Sulte, en 8 volumes – 100 $

- Au jour le jour, novembre 2002
Avis de recherche
Je planifie un texte sur la « vache canadienne » qui fut longtemps la maîtresse de nos pâturages.
Pour compléter cet article, je trouverais idéal d'y inclure une photographie d'une vache ou d'un troupeau prise sur notre territoire, plutôt qu'une photo des États-Unis.
Le prêt d'une telle photo serait très apprécié, le temps de la numériser pour reproduction dans notre bulletin.

- Au jour le jour, novembre 2002
C’est la vie… de la SHLM
Nouveaux membres
La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :
Mme Lucienne Faber, La Prairie (432)
M. Alain Huneault, La Prairie (433)
Décembre : conférence
Les conférences font relâche en décembre. Elles reprendront le 21 janvier 2003. Le sujet reste à déterminer. Ne manquez pas notre prochain numéro pour les informations.
Cours de généalogie
En septembre nous faisions un sondage concernant d'éventuels cours de généalogie. Nous avons été agréablement surpris de l'intérêt qu'a suscité un tel cours.
En effet, 24 personnes se sont inscrites. Vu le nombre, nous avons créé deux groupes soit le mardi matin de 9 h à 11 h et le mercredi soir de 19 h à 21 h. Le cours se donne sur une période de 8 semaines. À ce stade-ci, nous pouvons dire que les participants sont très heureux. Quelques-uns n'ont jamais fait de généalogie, d'autres oui. Il est à noter que le cours s'adresse tant aux débutants qu'à ceux s'y connaissant un peu.
Si vous êtes intéressé, nous renouvellerons l'expérience probablement en mars. Alors, n'oubliez pas de lire votre bulletin.
Plan d’action SHLM
L’automne est toujours la période où le conseil d'administration prépare son plan d'action pour l’année qui vient. Les membres sont toujours à l’affût des besoins de ses membres et aussi de la communauté.
Afin de respecter son mandat de diffuser l'histoire locale et régionale, la SHLM doit avancer certains dossiers commencés il y a longtemps et aussi en débuter d'autres. Bien sûr il y a les incontournables tels que l'embauche de guides touristiques durant la période estivale, la mise sur pied d'une exposition annuelle, la classification des différents fonds d'archives, etc.
Cependant, chaque année nous tentons de lancer de nouveaux projets qui font progresser la Société.
Nous espérons trouver des fonds afin d'embaucher un(e) archiviste. Depuis près de 3 ans, les subventions se font de plus en plus rares et la SHLM doit injecter 25 % des coûts. L'embauche de cette personne devient de plus en plus pressante car les archives s’accumulent et doivent être répertoriées et archivées selon les RDDA (règles de description des archives), pour uniformiser et faciliter la consultation.
En deuxième lieu, nous devons engager une personne pour une nouvelle exposition.
D'autres secteurs d'activités restent à compléter tels que la géographie des terres de la Seigneurie, l'achat de répertoires et la mise à jour du site Internet.
Voici les grandes lignes des dossiers à continuer à court terme. Naturellement, les projets pourront être réalisés selon le financement trouvé. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ces dossiers.
Rappel
Notre année financière achève. C'est le temps de renouveler votre cotisation avant de vous lancer dans les grandes dépenses des Fêtes.
Faites-en votre premier cadeau, pour vous-même et pour un ami ou parent.

- Au jour le jour, novembre 2002
Conférence : la vie à travers 7 générations de femmes
IMPORTANT
Notre prochaine conférence aura lieu le 19 novembre prochain au 247, rue Sainte-Marie (étage). La salle sera pourvue d'un microphone.
La conférencière :
Mme Lucille Houle, membre
Le sujet : La vie à travers 7 générations de femmes

- Au jour le jour, novembre 2002
Mot du président
Voici venu le temps de l'année où l'on commence les préparatifs pour les fêtes de Noël. Parmi les nombreuses tâches à accomplir il y a bien sûr l'achat des cadeaux pour le plaisir des petits et grands.
La SHLM se prépare aussi pour le renouvellement de ses cartes de membres et bien sûr la campagne de recrutement de nouveaux membres.
Pourquoi, en cette période de l'année, ne pas vous faire un cadeau et aussi le faire partager avec votre famille et vos amis qui, comme nous, se passionnent pour l'histoire, la généalogie, la cartographie et bien d'autres sujets de la culture.
Renouvelez votre carte et par le fait même, parlez-en autour vous. Le fait d'être membre vous donne accès à toutes nos archives, à la compétence de bénévoles dans toutes les sphères d'activités offertes par la Société d'histoire, et bien plus encore.
Cette année nous avons souligné le 30e anniversaire de notre Société d'histoire. Cela n'aurait pu être possible sans votre soutien au cours de ces nombreuses années pendant lesquelles la SHLM a fait face à bien des défis, mais ô combien gratifiants et enrichissants qui ont eu un impact dans notre localité.
Que ce soit pour la mise sur pied de logiciels, l'embauche de guides touristiques ou bien le travail d'archives, les membres ont leur part de succès dans cette réussite.
Les sommes cumulées par le renouvellement ou bien par le recrutement nous ont permis de continuer ce travail qui n'est jamais fini.
Jean L’Heureux

- Au jour le jour, novembre 2002
La tire Ste-Catherine
Une tradition québécoise vieille de 350 ans se perpétue à l’arrivée du mois de novembre et plus particulièrement autour du 25 : celle de la tire Sainte-Catherine.
Le Bulletin de recherches historique (vol. 6, 1900) écrit :
« La fête de sainte Catherine est toujours un événement dans la province du Québec. Ce jour-là, les familles se réunissent, et l’un des agréments de la soirée est d’étirer la tire. D’où vient ce mot canadien de tire? On dit que ce bonbon fut ainsi nommé par la bienheureuse Marguerite Bourgeoys, première supérieure des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame.
La bonne religieuse aurait inventé le bonbon du pays, pour attirer à elle les petits sauvages qu’elle voulait instruire, et comme les jeunes indiens s’y laissaient prendre comme des oiseaux à la glu, sœur Bourgeoys aurait baptisé le sucre ainsi préparé et qui attirait si bien, du nom de tire. »
Le texte n’est pas signé et la source qui appuierait l’opinion n’est pas indiquée.
L’auteur avait sans doute de bonnes intentions, mais il s’est laissé emporter par ses sentiments.
Pourtant, il tenait la réponse à son interrogation dans sa deuxième phrase : « … et l’un des agréments de la soirée est d’étirer la tire… »
Ce bonbon est essentiellement fait de mélasse bouillie avec un peu de beurre et de farine. Le résultat est une pâte collante très foncée qui durcit à l’air et se cristallise en refroidissant.
Pour obtenir le bonbon que l’on ne connaît plus aujourd’hui que sous une forme industrielle, il fallait étirer longuement et à plusieurs reprises, à la main, cette pâte lourde et noire.
Le processus débutait par un brassage à la cuiller, comme pour le sucre à la crème, alors que le produit était encore chaud, une opération relativement fatigante lorsque le volume était important. Cela exigeait de partager l’effort et produisait un début de blondissement.
Par la suite, rapidement pour ne pas que le futur bonbon durcisse, la famille entière était mise à l’ouvrage. Chacun s’enduisait les mains de beurre, saisissait une boule de pâte et l’étirait à bout de bras, repliant plusieurs fois sur lui-même le filet obtenu.
L’appareil blondissait et s’amollissait au fur et à mesure de l’étirement. Satisfaction atteinte, on roulait la pâte en boudins qu’on coupait ensuite en bouchées. Quel plaisir c’était alors de se sucrer le bec!
Il est fort probable que Marguerite Bourgeoys n’ait pas eu un instant pour trouver un nom à son bonbon, mais la tradition de l’opération s’est perpétuée dans la simplicité de l’action et du vocable.

- Au jour le jour, novembre 2002
Histoire du boulevard Des Prairies
Connu autrefois à Laprairie sous l'appellation de Pointe-à-Jacob et de chemin Brosseau, ce rang qui est devenu le boulevard des Prairies (A) (maintenant à Brossard) a connu un essor particulier au milieu du XIXe siècle, grâce à sa gare. Partant du rang de Saint-Lambert (aujourd'hui, Marie-Victorin) (B) qui longeait le fleuve, il traversait la côte Saint-Lambert, la côte des Prairies et la côte Ange Gardien, pour se terminer au rang Saint-Michel (chemin Lapinière) (C).
Dans un premier volet, il sera question de ses débuts et dans un second, de son développement durant le XIXe siècle.
( ) : voir carte annexée
Ses débuts
Le boulevard des Prairies a commencé à prendre forme au début du XVIIIe siècle. En 1673, la presque totalité des terres de la rive droite de la rivière Saint-Jacques (D) (concession sud-ouest de la côte Des Prairies) étaient déjà concédées mais peu développées à cause de la guerre iroquoise. Lorsque les terres du deuxième rang de la côte Des Prairies furent concédées (concession Nord-Est), principalement en 1717, le besoin d'un chemin devint crucial.
Dans les contrats de concession, l'obligation d'ouvrir un chemin et creuser un fossé revenait aux censitaires LES ORIGINES DE LA PRAIRIE, 1667-1697, Yvon Lacroix, éd. Bellarmin, pp. 97-101, pp. 117-121.. Les habitants ont donc ouvert un premier chemin plutôt grossier et étroit, pas toujours praticable. Dans les années qui suivirent, la partie du chemin parallèle à la rivière, se développa. Il fallut attendre que les terres de la côte Ange Gardien soient concédées (à partir de 1736) pour le prolonger graduellement, et cette partie divergea de la rivière pour s'enfoncer directement dans les terres. Durant toutes ces aimées, il servit aux déplacements des familles des cultivateurs : on retrouvait les Brosseau, Brossard, Dumontet, Moquin, Ste-Marie, Bisaillon, Bourassa, Lefebvre, Sénécal et autres.
Réalisant l'importance d'avoir un meilleur lien routier entre les villages, seigneuries et concessions, le Conseil souverain de la Nouvelle-France nomma dès 1697 une autorité responsable d'établir un réseau des chemins : le grand-voyer, aidé dans sa tâche, par le sous-grand-voyer.
Suite à une inspection, le sous-grand-voyer Paul Jourdin ordonna, le 14 septembre 1754, la réfection de la partie du chemin Des Prairies traversant la côte des Prairies. Des plans furent tirés par le Sieur Paul Labrosse : le chemin fut élargi et de meilleure qualité Fonds Élisée. Choquet, 3.151, procès-verbaux 1.5.1782, 1.1.1784 et 21.6.1780 (Lalanne)..
En 1780, ce sera la partie traversant la côte Ange Gardien qui sera refaite en continuité avec la partie précédente Fonds Élisée. Choquet, 3.151, procès-verbaux 1.5.1782, 1.1.1784 et 21.6.1780 (Lalanne).. Pendant toutes ces années, les décisions concernant l'entretien du chemin et l'arbitrage lors de litiges étaient confiées à un comité de citoyens, souvent d'anciens miliciens et des cultivateurs implantés depuis longtemps. Ces décisions étaient généralement notariées et approuvées par le grand-voyer de l'époque, François-Marie Picoté de Bellestre. Les coûts reliés à l'entretien des chemins et des cours d'eau étaient répartis entre les cultivateurs de la côte.
Mais dès 1841, la formation graduelle des municipalités (1846 pour Laprairie) fera disparaître la charge de grand-voyer. En 1855, l'adoption de l'acte des Municipalités et Chemins du Bas-Canada transférait la construction et l'entretien des routes aux autorités municipales; ce qui déchargea enfin les habitants d'une lourde responsabilité pour les années futures.
Son développement jusqu’au XXième siècle
École (H)
En 1834, la construction de l'école de rang n° 5 fut le premier bâtiment public à voir le jour sur ce rang. Sa construction fut votée le 27 juin 1834 Fonds Élisée Choquet, fiche 4.18 procès-verbaux, 27 juin 1834 et 15 juillet 1834. et l'instituteur était engagé le mois suivant. Donc, construite dans un délai d'un mois, le bâtiment était sûrement de bois. Justin-Louis Héroux y sera le premier instituteur. « Il doit enseigner du mieux que sera possible aux enfants de la côte des Prairies, […] lecture, l'écriture, l'arithmétique, catéchisme; […] Qu'il est bon instituteur en pareil cas… On lui fournit l'école, au moins 20 écoliers; pour chaque écolier, il recevra 20 sous par mois et une corde de bois franc. Poêle de fonte, tables et bancs pour écoliers sont fournis. Gratis pour enfants pauvres, jusqu'à 10. Fonds Élisée Choquet, fiche 4.18 procès-verbaux, 27 juin 1834 et 15 juillet 1834. » . Cette école, reconstruite ultérieurement, existe toujours au même endroit. C'est aujourd'hui une propriété privée.
Gare Brosseau (G)
En 1860, l'ouverture du pont Victoria amena plusieurs changements, dont la déviation de la voie ferrée (F) à travers les terres des côtes Des Prairies et Ange Gardien afin d'établir le lien ferroviaire Montréal-Saint-Jean. Le village de Laprairie étant contourné par le train, la construction d'une nouvelle gare fut nécessaire. La gare Brosseau propriété de la compagnie Le Grand Tronc fut donc érigée à la jonction du chemin Des Prairies (le chemin Brosseau à cette époque) et de la montée Brosseau (E) qui reliait le chemin Des Prairies et le chemin Lapinière (aujourd'hui, autour de la rue Ontario à Brossard). Une maison attenante à la gare servait d'habitation à la famille du chef de section Recensement 1878..
Cette gare joua un rôle essentiel pour le transport des marchandises et des personnes dans la région, du moins jusqu'à l'ajout de la nouvelle voie ferrée à destination des É.-U. et de la gare de Laprairie vers 1880. Entre autres, les cultivateurs du coin y expédiaient le foin, l'avoine et leurs produits laitiers pour la ville LA PETITE HISTOIRE DE BROSSARD, par Cécile Brosseau-Cloutier, mémoires personnels.. La gare Brosseau était encore opérationnelle en 1902 et l'a probablement été quelques années encore Fonds Élisée Choquet, fiche 4.44, procès-verbal, 1 oct. 1902..
Commerçants et professionnels
Dans les années qui suivirent l'implantation de la gare, des petits commerçants et professionnels s'établirent discrètement sur le chemin Des Prairies qui avait toujours été habité principalement par des cultivateurs. Ainsi, sur la liste électorale de 1889, nous retrouvons un épicier, deux commerçants, un médecin vétérinaire, un dentiste et un forgeron LISTE DES ÉLECTEURS – 1889 pour la municipalité de Laprairie.. Au début des années 1900 (estimation), le magasin général Dumontet (I), situé près de la voie ferrée était réputé pour sa grande variété de marchandises et ce magasin offrait les services postaux LA PETITE HISTOIRE DE BROSSARD, par Cécile Brosseau-Cloutier, mémoires personnels.. Malgré tout ce vent de progrès, les habitants du chemin étaient toujours rattachés à l'église de La Nativité (M) et tous les dimanches vers 8 h 45, chaque famille préparait sa charrette (ou son traîneau ) et ses chevaux pour se rendre à la grand-messe du village.
En temps d'inondation, « les paroissiens prenaient le chemin de fer qui conduit à Laprairie, s'assoyaient une quinzaine de personnes sur une traverse de chemin de fer, tirée par un HAND CAR, machine à pompage, qui pompait l'eau. Rendues aux rues, ces personnes prenaient des chaloupes pour se rendre à l'église. LA PETITE HISTOIRE DE BROSSARD, par Cécile Brosseau-Cloutier, mémoires personnels. »
En 2002, le boulevard Des Prairies a gardé, dans sa partie située entre la voie ferrée et l'autoroute 10, son côté bucolique d'autrefois. Vous pouvez toujours y admirer l'école de rang, le magasin Dumontet, et les maisons historiques Brossard (J) – près de la voie ferrée –, Sénécal (K) et Deschamps (L) – près de l'autoroute 30 – qui sont des propriétés privées. Une belle occasion de faire un retour dans le passé!


- Au jour le jour, novembre 2002
Quel est le vrai nom des Hurons?
« Le nom de Huron qui a prévalu dans l'histoire n'est pas le nom indigène de ce peuple. Il leur a été donné par les premiers Français, "à cause de leurs cheveux droits comme des soies de sanglier, sur le milieu de la tête, ce qu'on appelle en français une hure" » (Bressant, p. 71).
Les historiens leur ont donné différents noms. Champlain, qui les avait appelés d'abord Ochatéguins, adopta ensuite le nom d'Attigouantans, nom de la tribu de ce peuple au milieu de laquelle il aborda lorsqu'il visita son pays. Leur vrai nom sauvage, d'après le Père Jérôme Lalemant, est Onendat. C'est ainsi que les appelle aussi le Frère Sagard. Les écrivains anglais et américains en ont fait Wyandots ou Yandots.
Citation de Mgr Lindsay (Notre-Dame-de-Lorette en la Nouvelle-France, p. 308) dans Bulletins de recherches historiques

- Au jour le jour, novembre 2002
Histoire de pêche
Dans son édition du cahier souvenir publié en 2000 par Le Reflet, on rapporte en page 79 la capture en 1930 dans le fleuve d'un magnifique esturgeon de 54 lbs (22,5 kg).
Un résidant de La Prairie, M. Marcel Bleau, a sorti de ses archives familiales une photo d'une pièce de poids supérieur.
C'est le 22 septembre 1927 que son grand-père, M. Médéric Bleau, et M. Hector Lamarre, tous deux de La Prairie, ont effectué leur prise de 108 lbs (44,9 kg). Incapables de hisser le poisson dans leur embarcation, ils ont dû se résoudre à le traîner jusqu'au rivage.