
- Au jour le jour, novembre 2003
Conférence: Mathias, une histoire vraie
Notre prochaine conférence aura lieu le 19 novembre au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.
Mathias, une histoire vraie
Le conférencier :
Jean-Marc Phaneuf
Auteur et illustrateur

- Au jour le jour, novembre 2003
Mot du président
Chers membres
Voici la période de l’année où il vous faut songer à renouveler votre carte de membre. La SHLM est toujours soucieuse de vous offrir des services de qualité et un journal mensuel avec des sujets plus intéressants les uns que les autres.
Une de nos activités, le cours de généalogie, a débuté le 26 octobre, en soirée. Nous vous offrons aussi la possibilité de venir faire des recherches en généalogie tous les lundis soir de 19h à 21h30. Une réunion avec les bénévoles qui seront sur place a eu lieu le 19 octobre et tous sont prêts à répondre aux questions et à diriger les chercheurs afin de découvrir la richesse de nos archives.
Autre sujet qui vaut la peine d’être souligné : il s’agit de la participation de la SHLM au Congrès de la Société de Généalogie Canadienne Française en octobre. Plusieurs de nos membres y étaient présents. M. Jean L’Heureux et Mme Johanne McLean y ont participé en tant que représentants de la SHLM (voir détails en page 2)
En terminant n’oubliez pas, ce mois-ci, que nous aurons exceptionnellement 2 conférences. Le 11 novembre une conférence sur l’Armistice dont nous soulignons le 85e anniversaire cette année et le 19 novembre aura lieu notre conférence mensuelle.

- Au jour le jour, novembre 2003
Maladie mystérieuse à La Prairie
«Il n’y a aucune maladie mystérieuse à La Prairie, ni épidémie d’aucune sorte. »
«Je n’ai constaté aucun cas de cette terrible maladie.»
Ainsi s’exclama le Dr Joseph Longtin suite à la parution d’un article dans le journal La Presse en ce début du 20è siècle, le 16 février 1909.
Bien qu’il avait eu quelques cas de fièvre typhoïde, le docteur réfutait l’hypothèse qu’une maladie inconnue ravageait La Prairie. Il apparaissait que l’idée même était un canular.
Il faut dire qu’à cette époque, le village de La Prairie fut victime d’une épidémie qui tua 10% de sa population qui comptait 1200 âmes. Les docteurs Longtin et Brossard firent appel à un membre distingué de la profession médicale de Montréal, qui n’a pu résoudre la question.
La maladie ressemblait à la fièvre typhoïde, la grippe et à la fièvre intermittente. Cependant, il ne s’agissait d’aucune de ces maladies.
Les conditions hygiéniques de La Prairie furent mises en doute ainsi que le système défectueux de drainage. Il faut savoir que La Prairie eut son lot de maladies qui tua un nombre assez élevé de résidents : épidémie de diphtérie, de variole, de scarlatine ou d’oreillons. Les animaux aussi furent atteints de maladies.
En juin 1885, une espèces de dysenterie épidémique se déclara chez les bêtes à cornes, dans la commune de La Prairie. Les propriétaires, effrayés, s’empressèrent de retirer le bétail de cet endroit dangereux.
Souvent les maladies étaient attribuées à la mauvaise qualité des herbes et aussi aux malpropretés de toute nature qu’on y déposait chaque jour. Il est même dit qu’à cette époque la Commune de La Prairie, par ses terrains bas et humides à proximité du fleuve, était l’une des exploitations agricoles des plus défectueuses.
Donc, quelque 20 ans plus tard, les conditions d’hygiène étant encore mises en doute, le village était aux prises avec une autre maladie épidémique. Les symptômes étaient la langue noire et les dents noires, fièvre, saignements de nez, douleurs dans différentes parties du corps, transpiration, hallucinations, etc.…
Sur les 100 cas qui furent répertoriés, 20 personnes furent diagnostiquées souffrant de la typhoïde. On ignorait donc le mal dont souffraient les 80 autres.
Parmi ceux qui étaient décédés de cette mystérieuse maladie l’on retrouve messieurs Lefebvre (16 ans) fils d’Édouard et M. J. Lapierre ainsi que Aline Moussette (10 ans). Marie-Louise Brisson, fille du maître postier, souffrit aussi de la maladie.
Bien que les médecins mirent en garde les citoyens du risque d’infection et de l’urgence d’isoler les malades et de désinfecter les lieux, certains quartiers ne les prirent pas aux sérieux. Certains croyaient que des tranches d’oignon sur la cuisinière ferait baisser la fièvre et utilisaient cette pratique plutôt inusitée.
Il était impératif, bien que difficile, d’obtenir des conditions hygiéniques satisfaisantes. Les médecins s’entendaient sur ce fait. Une des solutions était le drainage dans toutes les parties du village car La Prairie était notoirement connu pour ces épidémies. La petite vérole, huit ans plus tôt, emporta dans le village et ses alentours plus de 100 personnes. En somme, à peu près à tous les deux ans, La Prairie était ravagé par une maladie.
Une chose est sûre, tous les médecins furent unanimes, ils n’avaient jamais rien vu de tel auparavant. La seule note positive était que la maladie était confinée dans le village. Les trois médecins du village : Dr S. A. Longtin, Dr J. M. Longtin et Dr J. B. J. Brossard travaillaient d’arrache pieds et eurent de la difficulté à faire face à cette maladie mystérieuse.
Source : Archives de la SHLM, Fonds Élisée Choquet

- Au jour le jour, novembre 2003
Jeux d’enfants dans les années 1930
A cette époque, les petites municipalités ou villages comme La Prairie n’avaient pas de service des loisirs, ni de parcs avec équipements et moniteurs spécialement réservés aux enfants. Cela n’empêchait pas ces derniers de trouver de multiples moyens de s’amuser. Ils le faisaient souvent avec presque rien. Voici deux de ces jeux.
LA TICANNE
Jouer à la cachette kick-a-can (on prononçait kékanne ou ticanne) ne requérait qu’une vieille boîte de conserve vide. Le jeu trouvait bien sa place après le souper, surtout en août et septembre alors qu’on aimait l’étirer jusqu’au déclin du jour et l’arrivée d’une demi-obscurité.
On plaçait la boîte au milieu de la rue où il ne passait plus alors de véhicules et, pendant que son gardien comptait jusqu’à vingt ou trente, les autres allaient se cacher. La tâche du gardien consistait à les repérer et les identifier. Il le faisait en criant le nom de celui qu’il avait vu tout en touchant la boîte de son pied.
Pour ceux qui étaient cachés l’objectif était de venir frapper la boîte d’un coup de pied avant d’avoir été repérés ou avant que le gardien ne parvienne à le faire s’il les avait dénichés. Dans ce cas, le jeu recommençait avec le même gardien. Le rôle de gardien n’était évidemment pas le plus prisé. Quand il réussissait à repérer et éliminer tous les joueurs, le premier qu’il avait éliminé le remplaçait.
Le gardien avait cependant le choix de placer la boîte à l’endroit du milieu de la rue qui lui convenait d’où il avait une bonne vue d’ensemble des alentours. Pour se cacher, on avait intérêt à choisir un lieu d’où on pouvait se déplacer pour se rapprocher par étapes du but sans trop risquer d’être vu par le gardien qu’on voulait déjouer. Tout élément bien placé permettant de se dissimuler à sa vue méritait d’être utilisé.
Bien entendu, le cheminement vers la boîte à frapper entraînait souvent des incursions sur les propriétés du voisinage. De façon générale, les parents du groupe des joueurs s’en accommodaient assez bien si en passant on ne créait pas de dégâts. Cependant l’endroit où le but était placé pouvait nécessiter des déplacements plutôt complexes ou osés pour parvenir à l’atteindre à l’insu du gardien. Il fallait parfois se faufiler à plat ventre au travers de plates-bandes fleuries de voisins qui n’avaient pas d’enfants. Difficile de leur faire accepter que la chose était pratiquement inévitable en certaines circonstances. Certains d’entre eux veillaient au grain et surveillaient le jeu ouvertement ou à la dérobée. Malheur alors à celui qui s’aventurait en terrain défendu. Un holà retentissant lui enjoignant de déguerpir lui garantissait de facto l’élimination par le gardien alerté. Mais quand, la tombée du jour aidant, le couvert végétal suffisait à cacher la présence de l’intrépide, la transgression réussie de l’interdit
qui permettait de percuter la ticanne procurait à ce dernier un sentiment enfantin de grand triomphe.
LES BILLES
On jouait aux billes à l’Académie Saint-Joseph surtout au printemps, quand le dégel rendait la cour trop boueuse. On utilisait pour ce faire des billes de terre cuite qu’on appelait marbres. Sur le plancher de bois de la salle de récréation du rez-de-chaussée, le jeu consistait à faire rouler un à un ses marbres pour essayer de toucher une bille de verre, une allée, dont la grosseur, la beauté du coloris et, par conséquent, la valeur apparente ou réelle, pouvaient varier. On appelait des boulés les plus grosses billes de verre qui étaient très convoitées.
Celui qui possédait une bille de verre s’assoyait sur le plancher, les jambes écartées, et plaçait la bille de verre devant lui, entre ses jambes. Ceux qui voulaient la gagner se plaçaient à une distance d’une vingtaine de pieds et, un à la fois, lançaient leurs marbres vers la bille de verre. Celui qui parvenait ainsi à toucher la bille convoitée en devenait immédiatement le propriétaire. Pour qui mettait sa belle bille en jeu, l’astuce était de la placer à un endroit du plancher où les irrégularités de celui-ci rendaient plus difficile de l’attraper. Cela lui permettait de s’enrichir de beaucoup de marbres.
Il était évidemment de règle de faire rouler les billes dans le sens des planches, mais les plus astucieux savaient repérer les petites bosses, les fentes, les trous, les pentes latérales des planches susceptibles de faire dévier les marbres de leur trajectoire. Les écoliers plus âgés possédaient une meilleure connaissance du terrain, comme il se doit, et les plus jeunes payaient naturellement pour apprendre. A ce jeu, plus d’un qui ne savait pas se retirer à temps du jeu se faisait dépocher (perdait tous ses marbres).
Quand, à la fin d’un cours, le temps de la récréation arrivait, c’était la course pour s’installer le premier avec sa bille et, selon sa connaissance du plancher, au meilleur endroit. Après s’être fait dépocher quelques fois en tentant de toucher une bille trop bien protégée par les accidents du terrain, on devenait plus prudent. On refusait alors de jouer à moins que la bille ne soit déplacée à un endroit qu’on inspectait et qu’on jugeait acceptable. On ne posait cependant pas ces conditions si l’objet convoité était un gros boulé de grande valeur; car chacun voulait avoir le droit, s’il venait à en posséder un, de ne pas risquer de le perdre pour quelques marbres.
On transportait ses marbres dans une bourse de tissu de confection domestique. On les achetait chez le marchand à raison de 5 à 10 pour 1 cent. Les billes de verre pouvaient se vendre plusieurs cents chacune. Le plaisir était sans contredit de posséder une pochette bien remplie de marbres quand on était plus jeune et de posséder des allées de plus en plus belles et des boulés à mesure que l’âge permettait d’apprécier la vraie valeur des choses.
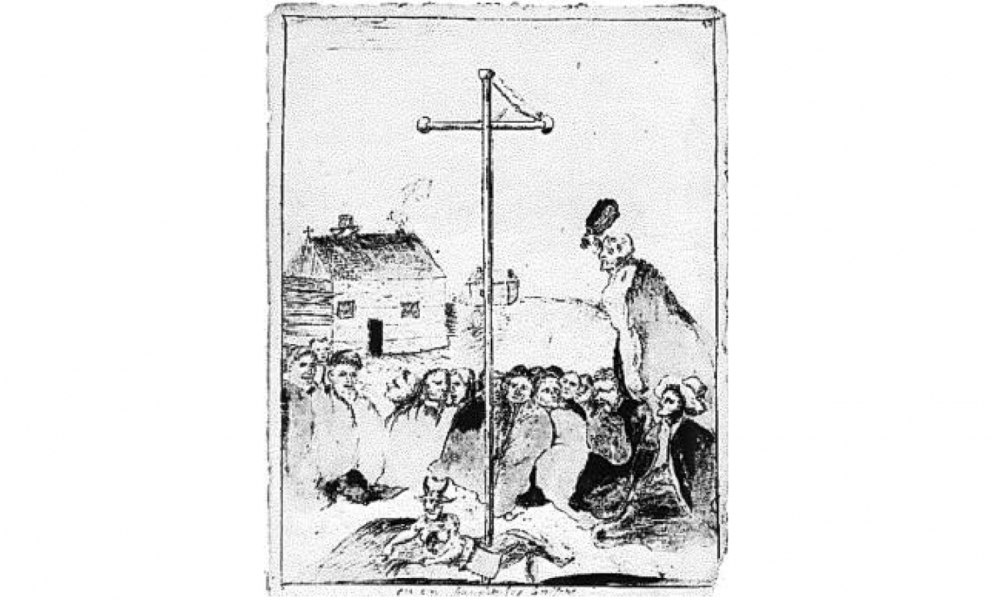
- Au jour le jour, novembre 2003
L’excommunication et ses effets
L’on peut trouver plusieurs définitions de l’excommunication dont voici quelques exemples :
– « Séparation d’avec le corps du Christ »
– « Expulsion formelle de l’église »
– « Séparation de la communion des fidèles »
– « Sentence de mort spirituelle par laquelle un pécheur membre de l’église est condamné à mourir spirituellement en dehors de l’Église pour ne pas contaminer les membres vivants de l’Église »
Le premier effet est une exclusion complète de la communion des fidèles. Les effets secondaires s’ensuivent tels que la perte du droit d’assister aux offices religieux, de recevoir les sacrements, de bénéficier des prières publiques, des suffrages et des indulgences de l’église, etc. La lecture des lettres de Mgr Briand indique qu’un grand nombre de peines et de sanctions étaient portées contre les fidèles comme les suivantes, certaines équivalant ni plus ni moins à l’excommunication, d’autres (les deux dernières mentionnées) étant même rétroactives :
– Refus de la sépulture chrétienne.
– Refus des sacrements.
– Ne les considère plus comme étant de son troupeau.
– Le déclare hors de l’Église, défendant à tous de le regarder comme catholique.
– Retranchés de l’église – pas de ministère à leur égard.
– Leur enlèvera leur curé.
– Interdiction et de l’église et du cimetière.
– Interdit sur la paroisse et celles voisines.
– Indulgence plénière à tous, excepté aux "indociles".
– Refus de l’absolution.
– Les considère comme hérétiques.
– Les considère comme schismatiques et hors de l’Église.
– Sera chassé de l’église.
– Sentence d’interdit contre…
– Seront privés de tout secours religieux.
– Indignes de recevoir les sacrements et d’être enterrés en terre sainte.
– Toutes les confessions qu’ils ont faites depuis 4 ans sont nulles et leurs communions considérées comme sacrilège. !!
– Vous séparez le garçon et la fille, parents du troisième au quatrième degré, que vous avez mariés sans dispenses!!

- Au jour le jour, novembre 2003
Une saga des Demers de La Prairie
Télesphore-Jacques, homme d’affaires du Montana
Nous terminerons cette saga d’une lignée des Demers de La Prairie avec un personnage incroyable dont le nom a retenti avec force dans le nord-ouest du Montana, à la fin du dix-neuvième siècle. À cette époque, nous le savons tous, plusieurs canadiens-français ont émigré vers les États-Unis, surtout dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Cependant plusieurs autres, un peu plus audacieux, poussés peut-être par les rêves de la ruée vers l’or, sont allés explorer les terres vierges de l’Ouest.
C’est le cas de Télesphore-Jacques Demers, fils de Louis-Ludovic Demers et d’Émilie Robert, né le 11 mai 1834, à La Prairie. Il était aussi le neveu de Médard Demers dont il a été question dans le numéro précédent de « Au jour le jour ».
Âgé d’une vingtaine d’années à peine, Télesphore-Jacques prend la direction de l’Ouest avec, pour tout viatique, ses espoirs et son courage. Il ira tout d’abord jusqu’à San Francisco, puis vers le nord et il s’installera à Fort Colville, au nord-est de l’état de Washington. C’est là, à l’âge de vingt-trois ans, qu’il épousera Clara Rivet, fille d’Antoine Rivet et de Mary Xixitelixken de la tribu Pend d’Oreille. Née en Oregon, Clara avait 14 ans et, toute sa vie, elle sera considérée comme une « Américaine de souche », ce qui expliquera certaines attitudes à son égard.
L’annonce de découvertes importantes d’or au Montana pousse alors la jeune famille à aller s’établir à Frenchtown Valley, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Missoula. Dès 1868, une liste de contribuables indique que T.J., comme on le nommait là-bas, possède trois terrains et deux terres, l’une de 30 acres et l’autre de 150 acres dans la vallée. En 1870, un recensement révèle que le couple a quatre enfants âgés de 4 à 11 ans. Le couple en aura trois autres et on sait qu’en 1869, son frère Amable viendra le rejoindre pour travailler à son magasin !
Tout nous pousse à croire que T.J. fut un homme d’affaires incroyable à un point tel qu’en 1889, la moitié de Frenchtown lui appartenait. Ses affaires comprenaient alors la traite des fourrures, le transport, les mines, l’élevage des vaches, des hôtels et des magasins. Cet entrepreneur, qui a été pour beaucoup dans le développement commercial de l’ouest du Montana, s’est aussi intéressé aux affaires publiques en tant que Commissaire du Comté.
Un fait inouï vient confirmer le succès de Télesphore-Jacques Demers : les journaux de la région révèlent, en 1878, que T.J. met en vente toutes ses propriétés. Peut-être veut-il se retirer des affaires et retourner vers sa région natale puisqu’il a gardé des liens avec Montréal et qu’il envoie certains de ses enfants faire des études à Québec. Mais, ô surprise, personne n’est assez riche pour l’acheter ! T.J. est donc condamné à prospérer et à continuer d’accumuler possessions et richesses.
En 1879, Clara meurt mais, probablement à cause de ses origines, son décès passe presque inaperçu et on ne sait même pas où elle a été inhumée.
À 44 ans, T.J. se remarie avec Léonie Garnot, une professeure de musique venue de Québec, âgée de 19 ans, soit presque du même âge que Délima, la fille aînée de T.J. Nouvelle preuve de sa richesse, le couple se permet une lune de miel de trois mois au Québec.
Durant les années 1880, T.J. cherche un site pour ouvrir un nouveau magasin général qui assurera le transit de ses marchandises vers le sud de la ColombieBritannique où les mines étaient en pleine expansion. Il l’établit sur les rives de la Flathead River et, peu à peu, s’y développe une agglomération qui prend le nom de Demersville. Le petit village, qui espérait le passage de la voie du Great Northern Railway, grossit très rapidement : Après un an seulement, il y avait 75 saloons licenciés dont l’ordre était assuré par… deux policiers !
Toutefois, le décès de T.J. mit fin au beau rêve car, sans l’influence de l’important homme d’affaires, le chemin de fer passa plus loin et Demersville périclita à l’avantage d’une nouvelle ville-champignon, Kalispell, qui accueillit graduellement les habitants de Demersville. T.J. s’éteignait le 18 mai 1889, laissant derrière lui une œuvre commerciale remarquable pour un homme de 55 ans seulement. Après la mort de son époux, Léonie vécut à Missoula et à Butte où elle décéda en 1947, laissant dans cette région du Montana plusieurs descendants de Télesphore-Jacques Demers.
Je dois avouer, ayant fait de nombreuses recherches sur les descendants des familles Demers, que cette lignée de Demers de La Prairie m’a paru la plus pittoresque et la plus digne d’intérêt.
Référence : inspiré d’un travail conjoint de Serge Demers et de Jacques Brunette, L’Arbre du Mai, juin 2001, de l’Association des familles Demers inc.
Générations de la saga
- Dumay, Étienne et Françoise Morin (Québec, 28-01-1648)
- Dumay-Demers, Joseph et Marguerite Guitaut dit Jolicoeur
(Laprairie, 25-10-1682)
- Dumay-Demers, Jacques et Marie-Barbe Brosseau
(Laprairie, 30-01-1719)
- Dumay-Demers, Jacques et M.-Madeleine Chevalier
(Mackinac-Détroit, 21-07-1744)
- Demers, Louis et Marguerite Pinsonneault (La
Prairie, 05-02-1776
- Demers, Jacques
Premier mariage : Catherine Brosseau (La
Prairie, 25-10-1801)
Deuxième mariage : Marie-Joseph Cayé-
Biscornet (La Prairie, 20-11-1809)
- Demers, Louis-Ludovic (premier lit) et
Émilie Robert (La Prairie, 05-05-1828)
- Demers, Télesphore-Jacques et Clara
Rivet (Fort Colville, 16-06-1857)
- Demers, Médard (deuxième lit) et Flavie Bourassa (La Prairie, 09-02-1847)
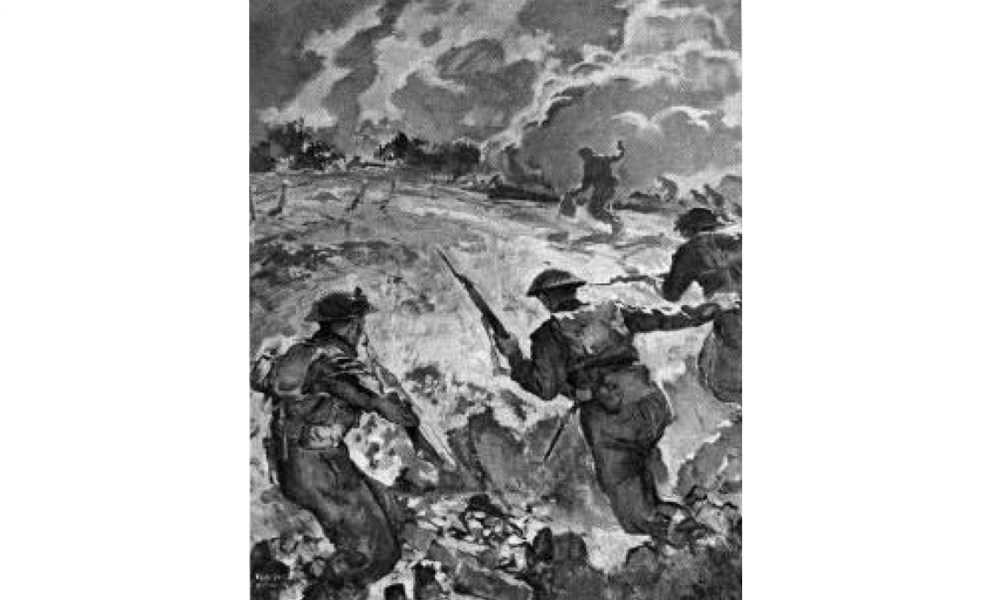
- Au jour le jour, octobre 2003
Conférence spéciale
Le 11 novembre prochain nous soulignerons le 85e anniversaire de la signature de l’Armistice qui mettait un terme à la première guerre mondiale (1914-1918). Afin de souligner cet événement et clôturer notre exposition dont la thématique cet été était «La vie militaire à La Prairie au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, nous aurons une conférence spéciale.
Monsieur Pierre Dufault, commentateur et journaliste sportif pendant plus de 33 ans et grand amant de l’histoire, notamment celle du 20e siècle, sera notre conférencier.
Il nous parlera de ce grand conflit que fut la première guerre mondiale où plusieurs résidents de La Prairie et du reste du Canada furent blessés et/ou trouvèrent la mort.
La conférence sera donnée au 247, rue Sainte-Marie (Théâtre du Vieux-Marché), à 20h.
N’oubliez pas d’encercler cette date à votre calendrier.

- Au jour le jour, octobre 2003
Nouvelles de la SHLM
La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :
· Mme Louise Demers, Saint-Lambert (466)
Avis aux généalogistes et chercheurs
Lundi le 20 octobre à 19h, il y aura une soirée portes-ouvertes à la Société d’histoire de La Prairie-de- la-Magdeleine et le Club de généalogie, 249, rue Sainte-Marie, La Prairie. À cette occasion, nous invitons les chercheurs en généalogie et en histoire à venir nous rencontrer afin de découvrir les nouveautés et acquisitions de la SHLM.
De plus, la SHLM ouvrira en soirée tous les lundis de 19h à 21h30 afin de permettre à tous ceux qui ne sont pas disponibles le jour de profiter de nos archives et volumes et ainsi de s’adonner à leur hobby.
Les coûts seront de 5$ pour les non- membres et gratuit pour les membres. Des bénévoles assureront la bonne marche de cette activité.
N’oubliez pas d’inscrire cette soirée à votre agenda
Pour plus d’informations : (450) 659-1393
Erratum
Veuillez prendre note que deux erreurs se sont glissées dans notre bulletin précédent à la page 2, sur les conférences.
1. Le titre de la conférence du 21 avril doit se lire comme suit : Inventaire des biens de la communauté de Pierre Ganier et Catherine Daubigeon.
2. Le titre de la conférence du 19 mai doit se lire comme suit : Les Acadiens de la Rive- Sud de Montréal.
Nous nous excusons auprès des conférencières

- Au jour le jour, octobre 2003
Conférence: Déclaration de l’arrondissement historique de La Prairie
Notre prochaine conférence aura lieu le 15 octobre au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.
Déclaration de l’arrondissement Historique de La Prairie
Le conférencier :
M. Denis Hardy
Ancien ministre des Affaires culturelles au moment de la déclaration de l’arrondissement historique.

- Au jour le jour, octobre 2003
Mot du président
Bonjour chers amis
Quel beau brunch encore cette année, « Galarneau » était des nôtres et l’atmosphère joviale. Madame Hélène Charuest notre fêtée, était resplendissante. Un coup de chapeau sensationnel à notre vice-président, Jean L’Heureux pour ses douze années en tant que président. Bravo ! Un gros merci à Céline Lussier et Johanne McLean pour l’organisation sans faille.
Nous avons reçu monsieur Gilles Proulx comme conférencier au mois de septembre. Quel orateur et historien extraordinaire. Près de 70 personnes ont participé à cette conférence.
Grâce à Jean L’Heureux, nous avons reçu un magnifique don : un ordinateur portable, gracieuseté de la Caisse populaire Desjardins de La Prairie. Soyez assurés que ce don sera très profitable à la SHLM pour l’informatisation de notre base de données BMS (Baptêmes, mariages, sépultures).
En terminant, nous désirons souligner le don de 3,000.00$ que nous avons reçu de la Fondation Guy Dupré. Cet argent nous permettra d’améliorer nos équipements ainsi que l’impression de nouveaux dépliants. Un gros merci !

