
- Au jour le jour, février 2006
Conférence reportée
Veuillez prendre note
La conférence de janvier qui avait pour thème « La palissade fortifiée du village de La Prairie en Nouvelle-France (1667-1779) » (par madame Josiane Jacob) a dû être remplacée par celle de monsieur Michel Barbeau (voir en page 2).
Toutefois, cette conférence sera reprise en juin.
La date exacte reste à déterminer.
Comme une conférence en juin est en soi une exception, nous comptons vous la rappeler dans le numéro de mai.
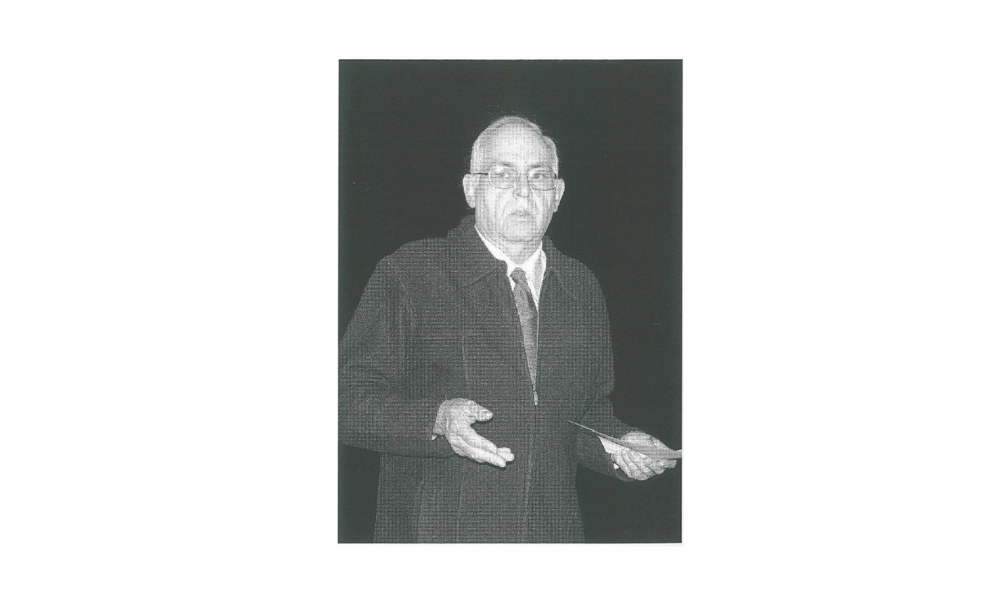
- Au jour le jour, février 2006
Conférence de janvier
Le soir du 18 janvier dernier, la température, peu clémente au départ, s'est ensuite envenimée par une chute de verglas qui a rendu les trottoirs très glissants et les routes très dangereuses. Pourtant, un bon nombre de personnes s'étaient déplacées pour venir entendre monsieur Michel Barbeau nous parler des Huguenots.
Le conférencier nous a d'abord instruits sur les origines historiques de cette faction du protestantisme que l'on nomme aussi calvinisme. Monsieur Barbeau nous a ensuite expliqué les terribles guerres de religion qui en ont découlé dont un des points culminants a été la célèbre Saint-Barthélémy. Il nous a aussi expliqué l'expansion de cette nouvelle religion et son influence malgré les tentatives du clergé et des gouvernements qui y étaient hostiles pour l'éradiquer.
Enfin, et c'était là le point important, l'orateur en est arrivé à l'influence du mouvement huguenot en Amérique et, particulièrement, en Nouvelle-France. Il a particulièrement insisté sur le phénomène de l'abjuration et sur l'influence de grands personnages de notre histoire dont les origines étaient huguenotes, comme Frontenac ou Montcalm.
Toutefois, bien que le présentateur soit allé au-delà du temps normalement imparti pour ces conférences, il est dommage qu'il n'ait pu développer plus longuement certains aspects de son sujet. Par exemple, les motifs religieux à l'origine du schisme ont été à peine effleurés. D'autre part, il aurait été intéressant d'en savoir un peu plus sur les conséquences à long terme de cette présence huguenote sur la mentalité des canadiens-français.
Car certains d'entre vous se souviendront peut-être que, dans plusieurs de nos contes folkloriques, on associe le diable au calvinisme et que, même au milieu du vingtième siècle, un catholique ne devait pas entrer dans un temple protestant. Vous vous rappelez peut-être aussi qu'on lançait encore, dans les années '50, à ceux qu'on n'avait pas vus à la messe du dimanche : « Coudonc, es-tu allé à la mitaine? » (mitaine : déformation québécoise du Meeting [hall] ou temple protestant)

- Au jour le jour, février 2006
Nouvelles de la SHLM
La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.
– Marrié Ninon et Gilbert Buzaré (199)
– Martin, Jean-François et Francine Lavoie (200)

- Au jour le jour, février 2006
Conférence : les Frères de l’instruction chrétienne à La Prairie
Prochaine conférence
Les Frères de l'instruction chrétienne à La Prairie
Par : Frère Gaston Roy
Le mardi, 21 février 2006, à 19h30

- Au jour le jour, février 2006
Mot du président
Dans un numéro précédent, je vous faisais part du désir de la SHLM de se donner une plus grande ouverture sur le milieu et le milieu, pour nous, c'est d'abord et avant tout l'ensemble de nos membres. Aussi, je reviens à la charge en vous rappelant que l'un de nos moyens de contact privilégiés avec vous, c'est le bulletin « Au jour le jour ». Cependant il serait bon que ce contact fonctionne un peu plus dans les deux sens.
En effet, « Au jour le jour », c'est votre journal et c'est à tous les membres qu'il revient de s'y exprimer. Vous pouvez le faire de plusieurs façons : nous proposer des articles, nous signaler des évènements, participer à la chronique littéraire, nous donner vos commentaires sur les conférences, soumettre vos interrogations sur certaines personnalités ou certains faits de l'histoire de La Prairie ou même nous suggérer des sujets que vous aimeriez voir développer.
Plusieurs de nos membres se sont déjà prévalus de ce droit. N'attendez pas plus longtemps pour les imiter.
René Jolicoeur, président
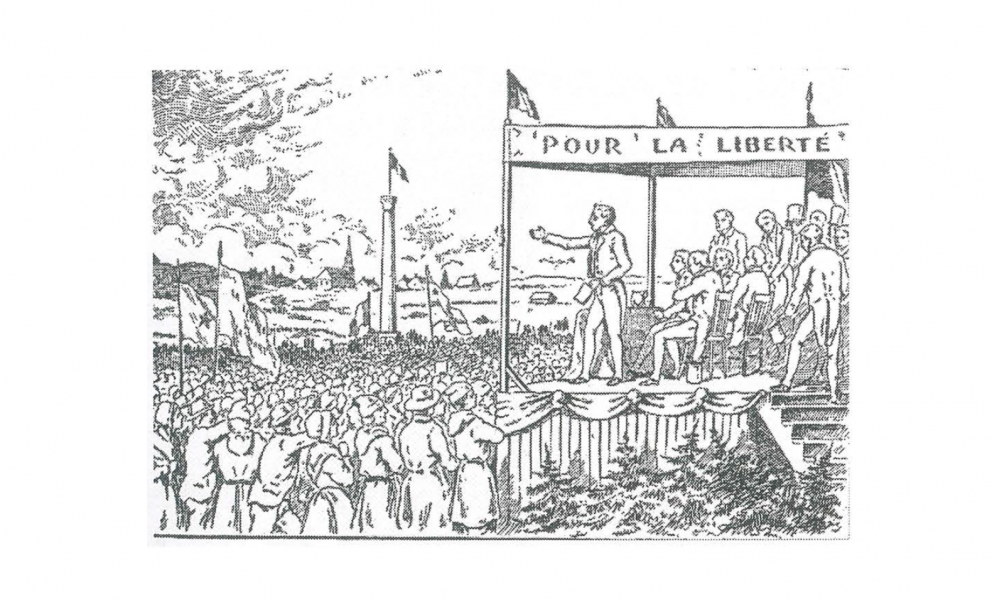
- Au jour le jour, février 2006
Avant et après les élections
Comme on le constate, la politique et les politiciens sont constants et égaux à eux-mêmes. De même, en politique, parfois c'est gai, moins gai, plus gai ou pas gai du tout, sans jeu de mots. Enfin, dans la rivalité anglais-français, pour une fois, on a gagné.
Raymond Monette
Avant et après les élections
Les hommes politiques ou, si l'on préfère, les politiciens, ne changent pas, qu'ils soient des siècles passés ou des temps présents, ils flattent le peuple pour se faire élire et une fois élus, ils agissent à leur guise. Nous avons justement sous les yeux les manifestes de la plupart des candidats du district de Québec qui, à nos premières élections politiques en 1792, briguèrent les suffrages populaires. Parmi les anglais, George Allsopp, William Grant, John Young, Adam Lymbumer, William Lindsay, Robert Lester, David Lynd, Matthew MacNider, James Dunlop, etc., etc., prirent la peine de faire traduire leurs manifestes en français et de les publier dans la Gazette de Québec. Tous promettaient de traiter les deux éléments de la population avec une égale justice afin, comme le disait l'un d'eux, de faire jouir tout le monde des bienfaits de la nouvelle constitution. Les Canadiens français crurent à ces belles promesses et votèrent pour des candidats qui ne comprenaient pas même leur langue. Une fois élus, les députés devaient se choisir un orateur ou président. Au moins quatre-vingt-dix pour cent des électeurs étaient de langue française. Il était bien raisonnable d'élire un orateur de leur sang et de leur langue. M. J.-A. Panet fut proposé, et les députés de langue anglaise votèrent unanimement contre lui afin d'élire un Anglais à la présidence. Voilà comment on récompensait les voteurs canadiens-français de leur générosité. Ceux-ci, heureusement, votèrent tous pour le même candidat, et, comme on le sait, c'est l'honorable Jean-Antoine Panet qui fut élu. M. Panet resta orateur de la Chambre d'Assemblée jusqu'à 1814. C'est une des belles figures de notre histoire politique.
P.-G. Roy, Les petites choses de notre histoire, 7e série.
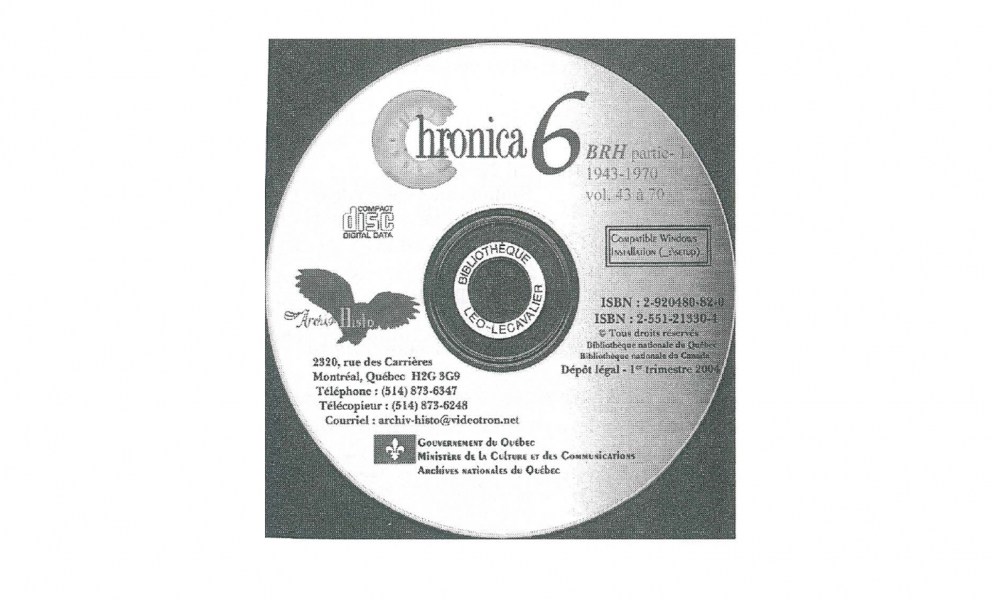
- Au jour le jour, février 2006
Chronica 6
La collection Chronica regroupe une série de précieux documents historiques numérisés qui se veut un outil fort utile aux chercheurs en histoire et en généalogie.
Notre Société dispose déjà des Chronicas 1, 2, 4 et 6 à son centre de documentation.
J’ai exploré pour vous le dernier CD-ROM de la collection, le Chronica 6, publié par les Editions Archiv-Histo.
Ce dernier est consacré à la fameuse série du Bulletin de Recherches Historiques dont les 27 521 pages furent numérisées en trois parties. Le Chronica 6 constitue la première partie et comprend les volumes 43 à 70 du Bulletin, soit ceux des années 1943 à 1968. Les deux autres parties suivront.
Comme dans le cas de chacun des CDROM de la collection, l’usager dispose du même logiciel de recherche, Folio Bound Views, qui permet de retracer et de voir à l’écran tous les passages qui renferment le mot cherché, parmi l’ensemble des 28 volumes.
Une fonction d’aide permet à l’utilisateur novice de se familiariser avec cet outil de recherche. Ainsi, en tapant « Laprairie », on obtient 73 occurrences apparaissant dans le texte en surlignés jaunes. Vu que tous les mots sont indexés, l’usager peut aussi connaître les diverses autres graphies existantes. Dans notre exemple, on voit effectivement que les mots « laprarie » et « laprari » figurent dans le texte, chacun une fois. Le premier, dans un article sur Jean-Baptiste Raymond, député de Huntingdon et le second, dans un inventaire des biens d’un marchand en 1772.
Si l’usager cherche un événement qui s’est produit à Laprairie, il réduira les occurrences, en écrivant chaque fois sa requête entre des guillemets, à 34 avec « à Laprairie » et à 4 avec « à La prairie ».
Si c’est le Fort de Laprairie qui l’intéresse, il trouvera, en utilisant la même technique, 4 occurrences avec cette orthographe et une en plaçant un espace entre La et prairie. En tapant « forts de laprairie », au pluriel, deux autres articles seront aussi repérés.
Le chercheur peut donc raffiner sa recherche à sa guise, sans oublier toutefois les diverses possibilités. Les plus expérimentés aimeront se servir des opérateurs disponibles tels que ET, OU, SAUF, décrits à la section Aide.
Si un auteur vous intéresse, tapez son nom pour le trouver : « E Z Massicotte » donne 152 occurrences. Pour le Bulletin d’une année en particulier, il suffit d’en taper l’année.
Une fonction d’impression permet de faire imprimer un article au complet ou seulement un passage; n’oubliez donc pas de rapporter le fruit de vos recherches! Et, plus besoin de monter dans l’escabeau pour atteindre un exemplaire du Bulletin de Recherche!

- Au jour le jour, février 2006
Le premier canadien
Voici une courte chronique publiée par Pierre-Georges Roy et faisant état du premier mariage en Nouvelle-France, du premier mariage célébré en Nouvelle-Angleterre, du baptême du premier Québécois mâle et de celui de la première Québécoise.
Le premier canadien
Il est évident qu'il s'agit ici du premier enfant né de parents français. Il ne peut être question des Sauvages puisque ceux-ci se contentaient du grand livre de la nature et ne tenaient pas de registres d'état civil.
Le premier registre de baptêmes, mariages et sépultures de Québec fut ouvert en 1621. Le 26 août 1621, Guillaume Couillard épousait Guillemette Hébert, fille de Louis Hébert, le premier colon de Québec. C'est là, incontestablement, le premier mariage enregistré à Québec et dans toute la Nouvelle-France.
Deux mois et demi auparavant, remarque M. l'abbé Ferland, savoir le 12 mai 1621, avait lieu le premier mariage célébré dans la Nouvelle-Angleterre, celui d'Edward Winslow et de Susannah White.
Le 24 octobre 1621, le Père Denis, Récollet, baptisait, à Québec, Eustache Martin, fils d'Abraham Martin dit l'Écossais et de Marie Langlois. L'acte de baptême de cet enfant ouvre le « Catalogue des baptisés à Québec depuis environ 1621 jusqu'à 1640 ». Le texte dit : « Le 24 octobre 1621, le Père Denis, Récollet, faisant fonction de curé à Québec, baptisa Eustache, fils d'Abraham Martin dit l'Écossais et de Marguerite Langlois. M. Eustache Boullay fut parrain, et Guillemette Hébert, épouse de Guillaume Couillard, fut marraine. » Eustache Martin, il n'y a aucun doute sur ce point, fut le premier fils de Français né à Québec. Nous pouvons donc le considérer comme le premier Québécois. À part la mention de son baptême par le Père Denis, nous n'avons aucune précision quelconque sur Eustache Martin. Nous avons le droit de présumer qu'il mourut en bas âge. Le deuxième baptême enregistré à Québec fut celui de Marguerite Martin, sœur d'Eustache Martin. Elle fut baptisée le 4 janvier 1624 : « Le 4 janvier 1624, le P. Paul, Récollet, baptisa, à Québec, Marguerite, fille d'Abraham Martin et de Marguerite Langlois. Thierry Desdames fut parrain, et Marguerite LeSage, marraine. » Marguerite Martin devint, le 22 mai 1638, l'épouse d'Étienne Racine. Si le premier québécois ne laissa pas de postérité, il n'en fut pas de même de la première québécoise, car les descendants de Marguerite Martin, mariée à Étienne Racine, se comptent aujourd'hui par milliers.
Texte tiré de Toutes petites choses du Régime français, par Pierre-Georges Roy, 1ère série, 1944.
Texte présenté par monsieur Raymond Monette.

- Au jour le jour, décembre 2005
Messages importants
Suggestion de cadeau
Vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui a déjà tout et que l'histoire et la généalogie intéressent ? Pourquoi ne pas lui offrir un Abonnement à la SHLM en guise de cadeau de Noël ? Contactez-nous et nous lui enverrons de votre part une «Carte de membre» dans un envoi spécial.
Dates à retenir
Nous avisons nos membres que les locaux de la SHLM seront fermés du 23 décembre 2005 au 3 janvier 2006. Dès le 4 janvier, la Société reprendra ses activités avec son horaire régulier.
Les « deux » prochaines conférences
Comme le bulletin Au jour le jour ne paraîtra pas en janvier, nous rappelons à nos membres que la prochaine conférence aura lieu le 17 janvier 2006 à 19h30, dans les locaux de la SHLM. C'est l'archéologue Josiane Jacob qui nous entretiendra sur «La palissade fortifiée du village de La Prairie en Nouvelle- France (1667-1779)».
Le 21 février 2006, à 19h30, c'est le Frère Gaston Roy qui viendra nous parler d'une communauté qui a joué un grand rôle dans notre ville: «Les Frères de l'instruction chrétienne à La Prairie».
Erratum
Dans notre édition d'octobre 2005, à la page 4, nous avions écrit, dans la légende sous la photo, que «le moulin à eau situé à la côte Sainte-Catherine aurait disparu lors de la construction de la Voie Maritime». Or, il semblerait que ce moulin avait déjà disparu dans les années '30. Nous nous en excusons auprès de quelques puristes que cette grave hérésie empêchait de dormir.

- Au jour le jour, décembre 2005
À propos du bulletin
Éditeur :
Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine
Internet : www.laprairie-shlm.com
Dépôt légal 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-7312
COLLABORATEURS :
Coordination : Jacques Brunette
Rédaction :
Raymond et Lucette Monette (26)
Jacques Brunette (16)
Révision Jacques Brunette (16)
Linda Crevier (Coord.)
Infographie : SHLM
Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.
Siège social :
249, rue Sainte-Marie
La Prairie (Québec) J5R 1G1
Tél. : 450-659-1393
Téléc. : 450-659-1393
Courriel : [email protected]
Les auteurs assument l’entière responsabilité du
contenu de leurs articles et ce, à la complète
exonération de l’éditeur.

