
- Au jour le jour, décembre 2005
Le coin du livre
ACQUISITIONS
– Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités du Québec, par Hormidas Magnan, 1925 (don: succ. Émard)
– Histoire de Boucherville, une vieille seigneurie; par P. Lalande, s.j., 1890 (don de madame René Côté)
– Joseph Robidoux, the family patriarch; par Clyde Robidoux, 2005 (don de monsieur Clyde Robidoux)
– Dictionnaire généalogique des Prévost-Provost par Adrien Provost, 2005 (don de madame Guy Dupré)
SUCCESSION DU Dr MICHEL ÉMARD
– Archives du Canada; Index aux rapports de 1872 à 1908; collectif; 1910.
– Atlas de la Nouvelle -France; par Marcel Trudel; PUL; 1968.
– Inventories of cemeteries in Ontario; par Verna Ronnow; 1987.
– Index onomastique des Mémoires de la SGCF, volumes 1 et 2; par Roland Auger; 1984.
– Ville de Québec, sous le régime français; volumes 1 et 2; par Pierre-Georges Roy; 1930.
– Histoire de Longueuil et de la famille de Longueuil; par Alex Jodoin; 1989.
– Maison en Nouvelle -France (La); par Robert-Lionel Séguin; 1968.
– Monuments commémoratifs de la province de Québec (Les); volumes 1 et 2; par Pierre-Georges Roy; 1923.
– Inventaire des jugements et délibérations du Conseil supérieur de la Nouvelle -France, 1717 à 1760; en 7 volumes; par Pierre-Georges Roy; 1935.
DONS
Merci de tout coeur aux donateurs dont les noms suivent:
– Madame René Côté
– Madame Guy Dupré
– Monsieur Clyde Robidoux
– Succession du Dr Michel Émard

- Au jour le jour, décembre 2005
Un geste de solidarité
Dans le cadre de sa campagne de financement 2006, la Société d’histoire de La Prairie-de-la- Magdeleine sollicite des dons qui lui permettront de maintenir les services qu’elle offre à ses membres et de se munir d’instruments de recherche de plus en plus performants.
La SHLM vous invite à souscrire généreusement afin que nous puissions atteindre nos objectifs pour l’année 2006, en vous rappelant que les dons de 20$ et plus font l’objet de l’émission d’un reçu pour fin de déduction fiscale.
Pour identifier votre don, vous pouvez utiliser le coupon encadré. Quant au don lui-même, vous pouvez lui donner la forme qui vous convient (Voir les formules possibles ci-dessous).
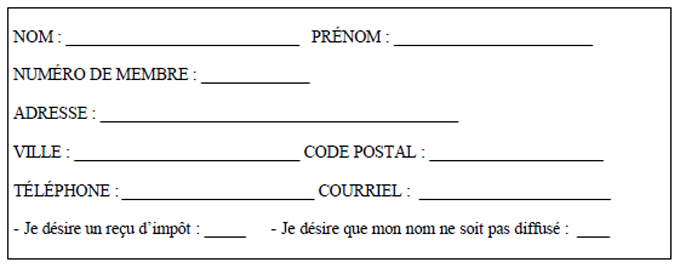
Formules possibles :
– Chèque à l’ordre de la Société d’histoire de La Prairie-de- la-Magdeleine
– Don en argent dans la boîte réservée à cet effet (réception des locaux de la SHLM)
– Legs testamentaire à mon décès (prévu à votre testament)
– Don de livres en histoire ou en généalogie d’une valeur approximative de ____.
Nous vous remercions à l'avance de votre générosité.
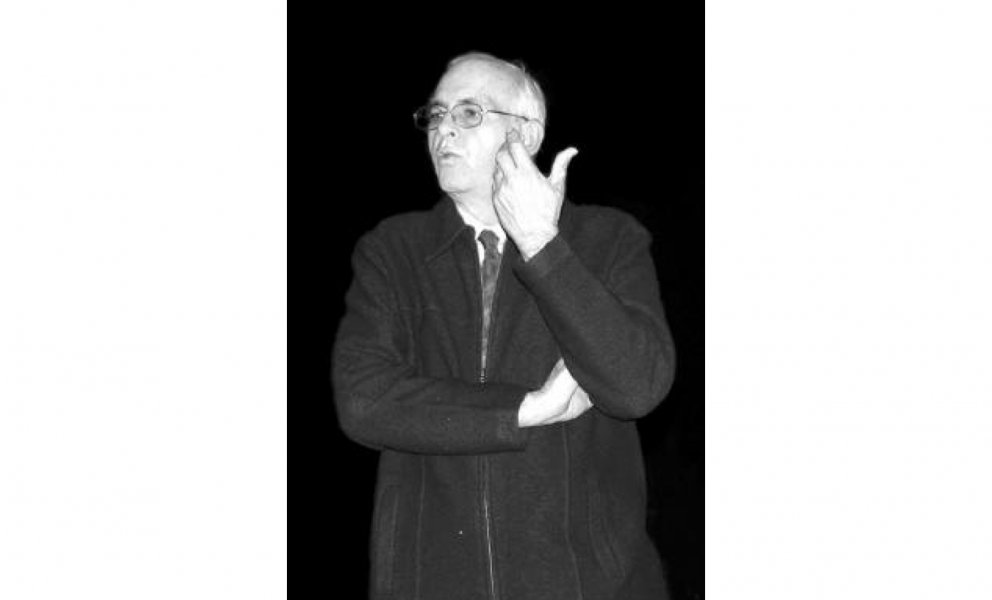
- Au jour le jour, décembre 2005
Conférence de novembre
Il arrive que l'amateur d'histoire ou de généalogie rencontre, au fil de ses lectures, des événements liés à des décès causés par la maladie, voire par des épidémies. Il en prend note comme étant l'une des nombreuses circonstances de la vie de ses ancêtres, sans plus. Cependant, quand le problème des épidémies est étudié dans son ensemble et de façon exhaustive, il prend alors un relief particulier qui explique, pour une large part, les difficultés auxquelles nos aïeux ont eu à faire face.
C'était là l'objet de la conférence de monsieur Michel Barbeau, le 15 novembre dernier sur «Les épidémies en Nouvelle-France». Avec moult acétates et un souci du détail remarquable, le conférencier nous a expliqué les causes et les effets des principales maladies qui ont décimé la population de la Nouvelle-France. Monsieur Barbeau nous a ensuite énuméré, avec force détails, les modes de propagation de ces fléaux, les traitements souvent malhabiles qu'on utilisait pour tenter de les éradiquer et leurs effets sur le peuplement de la colonie. Bref, cet exposé de monsieur Barbeau a éclairé d'un jour nouveau et très précis cet aspect souvent mal connu de la vie de nos ancêtres.

- Au jour le jour, décembre 2005
Nouvelles de la SHLM
La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :
Les conseillers municipaux:
– madame Suzanne Perron (190)
– monsieur Pierre Vocino (191)
– monsieur Donat Serres (192)
– monsieur Jacques Bourbonnais (193)
– monsieur Christian Caron (194)
et deux autres nouveaux membres:
– madame Barbara Fentener (196)
– madame Louise Lord (198)
Oublié ?
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion si ce n'est pas déjà fait. En plus de l'implication généreuse de ses bénévoles, c'est votre appui qui permet à la Société d'histoire de La Prairie de continuer son travail et de maintenir la qualité de ses services.

- Au jour le jour, décembre 2005
Mot du président
L'approche d'une nouvelle année signifie traditionnellement qu'il faut prendre de nouvelles résolutions et surtout, essayer de les tenir. Dans cet ordre d'idées, la SHLM prend la résolution d'accentuer son ouverture sur le milieu, de faire connaître davantage ses activités et, par conséquent, de modifier la perception qu'en ont généralement les gens qui ne nous connaissent que de loin.
Souvent, en effet, les personnes qui entendent parler de notre Société nous perçoivent comme un petit club très fermé de mordus qui, assis sur une pile de vieux documents, contemplent béatement la cime de leur arbre généalogique. Nous comptons sur vous pour nous aider à montrer l'image de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire une équipe dynamique de personnes soucieuses de conserver notre patrimoine et de le faire connaître le plus possible par le biais de nos services, mais aussi par des échanges et des partenariats avec les autres organismes de notre région.
Enfin, toujours dans cet esprit des Fêtes qui approchent, nous profitons de l'occasion pour vous offrir nos meilleurs voeux en vous souhaitant, selon la formule consacrée qu'utilisaient nos aïeux, «santé, prospérité et le paradis à la fin de vos jours».

- Au jour le jour, décembre 2005
Le raid de La Tortue, le 3 novembre 1838 (suite de novembre 2005)
À Odelltown
Le 9 novembre suivant, Hubert Lefebvre-Rigoche, avec Hippolyte Lanctôt, notaire de Saint-Rémi, François Camyré, de Saint-Constant, fut l'un des principaux officiers sous le major Médard Hébert, qui commandait la colonne du centre au combat d'Odelltown, comme en témoigne un autre capitaine chouayen, Michel Lussier, de Saint-Édouard-de-Napierville.
– «Il (Lussier) vit, dit-il, Hippolyte Lanctot à cheval sur une jument qui lui appartenait -… Médard Hébert lui enleva aussi un cheval, une charrette, puis un harnais…- Hébert, Lanctot, Lefebvre Hubert, Desmarais Abraham, étaient armés de sabres et d'épées…»
Après le combat d'Odelltown, Hubert Lefebvre-Rigoche, chef de la troupe de La Tortue, eut la sagesse de mettre la frontière entre lui et les sbires de Colborne et de fuir aux États-Unis.
Pendant ce temps, neuf membres de son parti, soit le capitaine Joseph Robert, Jacques Robert – pas un proche du précédent – les deux frères Ambroise et Charles Sanguinet, fils de l'ancien seigneur de La Salle, Pascal Pinsonneau, François-Xavier Hamelin dit le "Petit Hamelin" – cousin de Lefebvre- Rigoche – Théophile Robert, Joseph Longtin et Jacques Longtin eurent à répondre de la mort de Aaron Walker, en janvier 1839, devant le Conseil de guerre qui avait déjà jugé en décembre précédent, le député de Laprairie, Joseph-Narcisse Cardinal (1808 – 1838), son clerc, Joseph Duquette (1815 – 1838) et al.
Quatre d'entre eux, Joseph Robert, les frères Sanguinet et le "Petit Hamelin", tous de La Tortue, montèrent sur l'échafaud où les avaient précédés, un mois plus tôt, Cardinal et Duquette. Il n'y a pas d'hésitation à dire que pris, Lefebvre-Rigoche eut été du nombre.
État civil de Lefebvre-Rigoche
Pour les notes d'identité, j'ai eu recours à M. Jean-Jacques Lefebvre, archiviste du palais de justice de Montréal.
Hubert Lefebvre-Rigoche naquit à La Tortue le 28 octobre 1817 et fut baptisé à Saint-Philippe-de- Laprairie. Il était le fils de Benoît Lefebvre (1788 – 1823), maître-forgeron, mort prématurément.
Le plus jeune frère de son père, Basile Lefebvre-Rigoche (1805 – 1880) fut élu le premier maire de Saint-Rémi-de-Napierville en 1845.
Son surnom de Rigoche provenait du prénom de son aïeul paternel, Ignace-Rigobert Lefebvre (1758 – 1834), lequel avait épousé à Boucherville, en 1780, sa cousine, Isabelle Sentenne (1761 – 1834), fille d'un sergent du Royal Américain, John Santon – nom francisé plus tard en Santenne – et de Charlotte Lefebvre (1726 – 1791).
Enfin, sa mère, Catherine Vaschereau-Versailles (1789 – 1859), sœur de la mère du malheureux "Petit Hamelin", convola en 1824 avec Louis Sédilot-Montreuil. De ce second mariage, elle fut l'aïeule, entre autres, de notre contemporain, Wilfrid Cédilot (1862 – 1940), qui a été le dernier député de Laprairie à l'Assemblée Législative de Québec, de 1916 à 1923, avant la fusion des collèges électoraux de Napierville et de Laprairie.
Hubert Lefebvre-Rigoche reçut son éducation à l'École de langues classiques que tenait au village de Saint-Philippe, le curé Pigeon, un homme d'initiative, qui publia un journal, dans son village, en 1826. Bénéficiant de l'amnistie, Hubert Lefebvre-Rigoche revint de l'exil et épousa aussitôt (1844), en son village natal de Saint-Philippe-de-Laprairie, Adélaïde Tremblay (1820 – 1872), tante paternelle, entre autres, d'Ernest Tremblay (1852 – 1904), le grand journaliste dont Aegidius Fauteux a parlé dans son Courrier historique et littéraire. Elle mourut à Montréal en 1872.
Il avait eu six enfants dont trois devenus adultes, tous nés à Saint-Philippe-de-Laprairie: Lucien, né en 1848, Joséphine, née en 1854 et Rosalie en 1856.
Notons les parrains des enfants de Hubert Lefebvre-Rigoche: son beau-frère, Julien Tremblay, qui fut le père du docteur A.-L. Tremblay (1846 – 1879), co-fondateur du premier journal franco-américain avec Ferdinand Gagnon; François-Xavier Bonneau (1808 – 1895), plus tard capitaine de milice, marchand à La Tortue pendant plusieurs années, dont une fille, Justine Bonneau, religieuse hospitalière, décédée en 1898, fut supérieure de l'Hôtel-Dieu de Montréal, et enfin, sa belle-sœur, Zoé Tremblay-Lanctot, qui fut la mère du juge Husmer Lanctot, et du docteur Joseph Lanctot, conseiller législatif.
Hubert Lefebvre-Rigoche avait deux frères: son aîné, Joseph, né en 1810, marié en 1832 à Pauline Chatel, qui vécut longtemps à Saint-Édouard-de-Napierville et demeurait en 1890 à Saint-Albert de Russell, Ontario, et un frère cadet, Olivier-L. (1822 – 1903) qui épousa à Saint-Philippe en 1844 Mathilde Deneau (1822 – 1903), fille de Charles Deneau, voyageur au Nord-Ouest.
Olivier avait géré les affaires de son frère pendant l'exil de celui-ci, mais au retour, ils vinrent en difficulté et pour régler et éviter un procès, ils prirent un accord devant notaire.
Hubert Lefebvre fut un temps instituteur à Saint-Philippe, probablement à La Tortue où il possédait une assez grande ferme. Le 26 août 1862, devant A. Beauvais, notaire, Hubert Lefebvre-Rigoche cédait à François Riel-Irlande, une terre sise à La Tortue, dans Saint-Philippe, de 5 X 30 arpents, tenant par devant à la rivière La Tortue, d'un côté à son frère Olivier…et qu'il possède par "bons titres" pour la somme de 42 000 livres (ancien cours).
La maison construite vers 1805 par son père le forgeron Benoît Lefebvre, fut démolie en 1914. Elle fut réquisitionnée par les autorités militaires pour loger un peloton de soldats d'un régiment de Glengarry, qui faisait durant les jours sombres de novembre 1838, l'occupation de la région de La Tortue, alors en ébullition.
Je le consigne ici pour mes fils quand ils auront l'âge de s'intéresser à ces choses, cette ferme passa en 1895 à mon père, Gustave Derome (1871 – 1940), qui y éleva sa famille.
Après la mort de sa femme, lors de la crise économique de 1872, Hubert Lefebvre-Rigoche partit pour les États-Unis avec son fils, Lucien et ses deux filles. Ces deux dernières vécurent dans l'État du Michigan. L'une, Joséphine, avait épousé Pierre Lalonde, l'autre, Rosalie, était mariée à Edmond Lemieux. Hubert Lefebvre-Rigoche alla mourir en octobre 1899 à Minneapolis, Minnesota, où son fils, Lucien, qui était marié à une demoiselle Colin, s'éteignit lui-même en 1933.
Une petite-fille de Hubert Lefebvre-Rigoche, madame Clotilde Lefebvre-Schwartz, de Minneapolis, est venu par deux fois à Montréal en 1945 et 1946 et m'a procuré la photographie de son grand père.
Ainsi mourut sur la terre d'exil le Patriote Hubert Lefebvre-Rigoche, qui à peine majeur, en 1838, avait réussi à conduire 150 hommes dans une insurrection armée contre le plus puissant Empire de l'époque et fut indirectement la cause de la mort sur l'échafaud de quatre de ses coparoissiens et de la ruine et de l'exil pour tant d'autres. Montréal, décembre 1953.
Revue d'histoire de l'Amérique française (RHA); no.7 – 1954; pp. 483 – 489.

- Au jour le jour, décembre 2005
En visite chez les aînés
Pour favoriser son ouverture sur le milieu, la SHLM a pris contact avec madame Jeannine Lavallée afin d'établir les premières bases d'un partenariat avec la Maison des aîné(e)s de La Prairie. Cet organisme, mis sur pied par madame Céline Desautels et son équipe, s'est donné pour but de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Désireuse de participer à ce mouvement altruiste, la SHLM a déjà commencé à offrir des conférences à ce groupe de personnes riches en expérience qui pourront sûrement partager leurs souvenirs avec nous.
C'est ainsi que, le 30 septembre dernier, madame Crevier, accompagnée de messieurs L'Heureux et Bourdages, a rencontré un groupe de ces aîné(e)s pour leur faire l'exposé d'une petite histoire de La Prairie, émaillée de photos anciennes et d'anecdotes. Il faut croire que la conférence a été un succès puisqu'elle s'est prolongée plus longtemps que prévu.

Le 11 novembre, la SHLM réitérait l'expérience. Cette fois, dans le contexte de la Journée du Souvenir, il s'agissait d'illustrer l'implication de La Prairie dans les différents conflits armés de l'Histoire. Cette deuxième initiative a eu comme conséquence de pousser la Société à monter une petite exposition sur ce même thème, exposition qui est toujours en place d'ailleurs.
Comme il ne faudrait pas laisser une aussi belle initiative sans lendemain, la SHLM se propose maintenant d'offrir à la Maison des aîné(e)s de La Prairie une demi-journée qui serait consacrée à l'initiation à la généalogie. Il ne nous reste qu'à souhaiter longue vie à ce partenariat et à espérer que cet exemple sera suivi par d'autres organismes qui pourraient profiter d'une telle symbiose avec nous.

- Au jour le jour, novembre 2005
Divers
Grands prix d'entrepreneuriat Roussillon 2005

Madame Céline Lussier, madame Johanne Jolicoeur, monsieur René Jolicoeur, président de la SHLM, et monsieur Maurice Lécuyer, président de Lécuyer et Fils, Ltée de St-Rémi et généreux commanditaire de la Société pour cet événement.
Marcher dans l'ombre du passé (en reprise)

Nos guides de la période estivale ont repris pour un soir leur visite spéciale du Vieux La Prairie portant sur les grands drames et décès célèbres de l'histoire de notre région. Malgré le froid, cette initiative s'est avérée un franc succès et mérite nos remerciements et nos félicitations.

- Au jour le jour, novembre 2005
Marie Gagnier
À l'automne 2004, je me suis rendue aux archives nationales du Québec à Montréal, afin de poursuivre mes recherches sur la famille de Pierre Ganier et de Catherine Daubigeon. J’ai été attirée par un acte du notaire Jacques David, en date du 4 juillet 1720 dont le titre est : «Contract dEschange Entre S.r Joseph perrau Et damlle marie gagnier Son Epouse, et S.r pierre febvreau Et marie anne perrau Sa femme ». ANQM, GN Jacques David, 4 juillet 1720.
Rappelons que Marie gagnier est la fille de Pierre Ganier et de Catherine Daubigeon, leur aînée. Elle naît à la seigneurie de La Prairie de- la-Magdeleine le 2 novembre 1671; son parrain est Philippe Plamondon dit Lafleur et sa marraine, Marie Barbe Roinay. Marie gagnier épouse Joseph Perrault, le fils de Jacques Perrault dit Villedaigre et de Michelle LeFlot, le 21 avril 1688 à La Prairie. Marie décède le 26 octobre 1739, à l’Île d’Orléans, paroissienne de l’église Sainte-Famille, une semaine avant de fêter ses 68 ans.
Ce contrat a piqué ma curiosité par son titre, espérant connaître les relations entre la famille Perrault de l’Île d’Orléans et celle de Pierre Favreau de Boucherville.
Les contractants sont Joseph Perrault, capitaine de milice à l’Île d’Orléans se trouvant à Montréal à cette période et Pierre Favreau, l’époux de Marie- Anne Perrault, veuve de Jean-Baptiste Normandin dit Beausoleil, la fille de Jacques Perrault dit Desrochers et d’Anne Gagné, la soeur de Marie. Jacques Perrault et Joseph Perrault sont frères. Donc le contrat se fait entre l’oncle Joseph autorisé de sa femme Marie, et Pierre Favreau, autorisé de son épouse Marie-Anne, la nièce de Joseph.
Le contrat est simple : Marie gagnier cède ses droits successifs mobiliers et immobiliers obtenus de la succession de sa mère décédée en 1712 et ceux à obtenir lorsque son père Pierre Ganier décèdera, à sa nièce Marie Anne Perrault et son époux Pierre Favreau; en échange Marie et Joseph reçoivent une terre de deux arpents de front sur quarante deux de profondeur située à la rivière Ouelle, cette concession appartenant à Marie-Anne Perrault provenant des successions de Jacques Perrault dit Villedaigre et Michelle LeFlot, ses grands-parents paternels, les parents de Joseph. Marie et Joseph ont déjà une concession à la rivière Ouelle, voisine de celle des parents de Joseph. En imprimant le contrat, quelle surprise ai-je eue lorsque, sur la dernière page du contrat, une annexe (fig. 1) où Marie donne son autorisation à son mari Joseph Perrault d’agir à sa guise au moment du contrat d’échange, j’ai vu la signature de Marie gagnier !
C’est la première fois que je voyais sa signature; en effet, je croyais que Marie ne savait pas signer n’ayant jamais vu auparavant sa signature au bas des actes notariés que j’avais consultés. Certes cette annexe est écrite au son comme vous pourrez sûrement le constater en la lisant. Mentionnons que « monroyal » est Montréal que Champlain écrit sur sa carte de 1632 «Mont-real » alors qu’il écrit «Mont Royal » pour déterminer la colline. Enfin le fondateur de Montréal, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, écrit en 1642 : « Ville marie de l’isle de Montréal »Commission de toponymie, Dictionnaire illustré Noms et Lieux du Québec, Les publications du Québec, 1996, p. 454.
Je vous présente la signature de Marie gagnier, une signature appliquée qu’elle a écrite ou dessinée, je ne saurais le dire. Elle m’est très chère.

je permet amon mari da gir Comme bonlui Sanblera pour Ce quil pourra mapartenir deritage tans tamonroyal qualapreriede lamadelenne auje promet ratifie les zécri qui anse ronfaiste delaSente tefamille Ce 8 jeun 1720

Merci à madame Estelle Brisson, archiviste et responsable des salles de consultations aux Archives nationales du Québec à Montréal, pour sa collaboration.
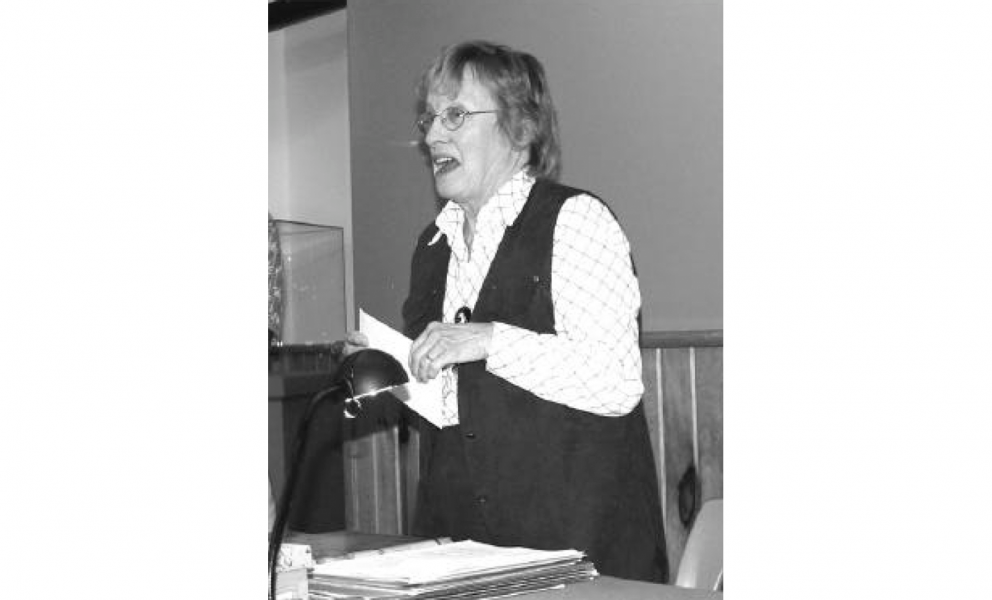
- Au jour le jour, novembre 2005
Les trésors de la tradition orale
Le 18 octobre dernier avait lieu la première conférence de l'année 2005-2006 organisée par la SHLM. Et quelle conférence ! Madame Gisèle Monarque, bien connue du monde québécois de la généalogie, nous a entretenus de la tradition orale avec humour, simplicité et une capacité indéniable de captiver son auditoire que lui insuffle sa passion pour la généalogie. À l'aide d'exemples souvent très personnels, madame Monarque a su nous démontrer l'importance de ces trésors cachés détenus par les aînés ou qui dorment souvent dans des tiroirs. Elle a insisté sur la pertinence de ces informations qui risquent de disparaître à jamais si personne ne se donne la peine de les recueillir et d'en tirer parti.
La conférencière nous a donc énuméré les différentes formes que peuvent prendre ces éléments de la tradition orale et nous a expliqué la façon de les utiliser en les vérifiant, en séparant la vérité des souvenirs imprécis, en nous assurant de la fiabilité de nos sources.
Bref, dans une atmosphère bon enfant, madame Monarque a souligné la valeur de cette source souvent méconnue. Non seulement elle a incité les gens à colliger le plus rapidement possible toutes ces informations, mais elle les a incités à les transmettre à leur tour aux générations qui leur succèderont.

