
- Au jour le jour, juin 1983
Finance$
Société Historique de La Prairie de la Magdeleine
États financiers pour la période du 7 janvier au 3 mai 1983.
SOLDE au 6 janvier 1983 : 3414 ,88$
DEPENSES :
salaires et frais reliés au travail des deux employés : 6218 ,18$
reliées à “Connais-tu La Prairie” : 81 ,88$
d’exploitation : 679 ,28$
entretien du Musée (ménage) : 64 ,88$
impression du Bastion no 4 : 267 ,59$
photos du dixième anniversaire : 148 ,58$
Comité de généalogie : 81 ,90$
TOTAL : 7532 ,45$
REVENUS :
subvention des emplois : 5280 ,67$
cotisations (107 membres) : 1284 ,00$
dons : 31 ,75$
vente de Bastions et recouvrement du coût de l’impression du no 3 : 359 ,61$
livres, photocopies etc… : 89 ,51$
du Comité de généalogie : 185 ,00$
TOTAL : 7230 ,54$
Solde du 3 mai 1983 : 3414 ,88$ + 7532 ,45$ + 7230 ,54$ = 3112 ,09$
Fonds gelés :
- Subvention pour le renouvellement de l’exposition : 1000 ,00$
- Subvention pour “Connais-tu La Prairie” : 2869 ,72$
- pour le Bastion : 23 21$
- pour le Comité de généalogie : 183 ,10$
TOTAL : 3996 ,03$
SOMMES RECOUVRABLES
- troisième tranche de subvention (emplois) : 1600 ,00$
- photos du dixième anniversaire : 150 ,00$
- TOTAL : 1750 ,00$
AVOIR NET : 3112 ,09$ + 1750 ,00$ – 3996 ,03$ = 866 ,06$

- Au jour le jour, juin 1983
Élection
Nouveau conseil exécutif

Le 4 juin dernier était jour d’élection chez les membres de la SHLM. Trois postes étaient à combler; le poste de trésorier occupé jusqu’alors par M. Robert Mailhot, celui de premier vice-président occupé par M. Michel Létourneau, ainsi que la fonction de président assurée par M. André Taillon.
La présidente d’élection, Mme Denise Mailhot et le secrétaire d’élection M. Jules Sawyer entreprirent les procédures d’usage et en moins d’une heure tous les postes étaient comblés; à savoir : M. Michel Létourneau fut élu président, Mme Claudette Rousseau première vice-présidente et M. André Taillon accepta d’occuper les fonctions de trésorier.
Dès le 9 mai le nouvel exécutif se réunissait dans le but de dresser les principales avenues de l’orientation future de la Société.
Denise Mailhot, présidente d’élection
En sortie de scène…

Chers membres,
Au terme de ce mandat j’ai cru souhaitable de vous faire grâce de la traditionnelle et fastidieuse énumération des réalisations du président sortant de charge. Il m’a semblé préférable de mettre l’accent sur les acquis plus personnels des deux dernières années. En effet, deux années au gouvernail… c’est vite passé ! Plus encore lorsque le travail ne manque pas et que des gens dévoués et efficaces vous accordent leur appui de façon soutenue. Sentir que la SHLM maintenait son rythme de croissance des débuts; ce fut là l’une de mes grandes satisfactions.
Que l’on songe un instant à la lourde tâche qu’impose la présidence à notre époque. Si au surplus l’heureux élu ne se croit pas fait pour le poste, qu’il ne pense pas non plus avoir la compétence pour intervenir auprès des organismes officiels dans des dossiers où des milliers de dollars sont en cause, et que le temps lui fait défaut pour assurer la coordination de tant de projets… que penser alors de l’inquiétude qui m’habitait il y a deux ans.
Les heures de loisirs investies et les sacrifices imposés à la vie personnelle et familiale ne se comptent plus. Cependant je réalise aujourd’hui toute la richesse de l’aventure. Et si des mots comme réunions, discussions, budget, appels téléphoniques et décisions résonnaient continuellement dans ma tête, ils étaient vite absorbés par l’écho des appuis, de la collaboration, de l’accomplissement et de la fierté qu’obligeait le travail accompli.
J’ai appris que la profondeur et la sincérité de mon engagement auprès de la Société se mesurait à l’estime, au respect, voire même à l’amitié de plusieurs des membres du groupe. Je vous suis redevable aujourd’hui de beaucoup de patience, de compréhension et de disponibilité.
Je m’en voudrais enfin d’achever cette missive sans transmettre mes vœux de bon succès à mon successeur Michel Létourneau. Qu’il vive avec les membres de la SHLM une aventure aussi passionnante et aussi enrichissante que la mienne. Car c’est à la mesure de la montagne que l’on prend la mesure de celui qui l’a conquise…
André Taillon

Mot du nouveau président

Lorsque M. André Taillon m’approcha il y a quelques semaines pour me demander d’accepter le poste de président, convaincu qu’il était de la faveur des membres envers ma candidature, je n’ai pu m’empêcher de frissonner à la seule pensée que cette situation pouvait se produire. Cette relève à assurer est de taille si on se donne la peine de consulter le travail gigantesque que les Bourdages et les Taillon ont exécuté depuis plus de cinq ans. Ces deux hommes ont établi la “SHLM” parmi les sociétés d’histoire les plus respectées du Québec.
Maintenant, c’est chose faite, vous m’avez élu et je dois maintenant mériter la confiance que vous m’avez témoignée; je vous en remercie de tout cœur.
Nous nous sommes donc mis à la tâche sans tarder et lors de notre réunion du 9 mai dernier, le nouvel exécutif dégageait les grandes lignes des dossiers en cours et des autres à prévoir à plus ou moins brève échéance; ainsi :
1.Le poste d’archiviste est resté trop longtemps vacant au sein de notre société et il faut de toute urgence trouver quelqu’un en mesure de le combler. Car il faut à tout prix poursuivre le travail de nos pionniers Brisson et Choquette et organiser de façon définitive le centre documentation en ce sens.
2. Notre constitution, révisée il y a quelques années, doit être complétée et modifiée au besoin de façon définitive.
3. Il faut mettre un terme aux dossiers en cours : notamment l’installation de capsules didactiques, le renouvellement de l’exposition permanente et l’achèvement du diaporama.
4. Même si présentement l’accueil au Musée est solidement assuré par Ginette Duphily et Gaétan Bouchard, ce jusqu’en août 1983, il faut dès maintenant songer à en assurer la continuité par la suite.
5. Des fouilles archéologiques sur le site des anciennes Académies sont attendues avec impatience pour l’été qui vient. Il faut sans tarder organiser un comité pour en assurer la bonne marche.
6. La “SHLM” endosse maintenant de plus en plus de publications. Outre notre bulletin officiel “Le Bastion” dont la qualité s’améliore d’une façon impressionnante d’une publication à l’autre, il faut mettre sur pied des politiques afin de centraliser l’information propagée, ce qui permet de toujours offrir le même standard de qualité. N’est-ce pas l’image de la SHLM qui est projetée de cette façon ?
7. Les fêtes de la St-Jean approchent; je crois que la participation de la “SHLM” est souhaitée par plusieurs. L’exécutif va tenter, malgré le délai très court, d’y prendre part. Car ne sommes-nous pas l’un des rares organismes à caractère culturel à LaPrairie ?
Ces grandes lignes ne sont en fait qu’une première ébauche et nous savons par expérience qu’une foule de projets viendront bientôt s’y greffer grâce à l’initiative de nos membres et des directeurs de comités toujours très actifs.
En terminant, je tiens personnellement à inviter chacun des membres à venir me rencontrer au sujet de tout nouveau projet susceptible d’être mis en marche et dont les vues coïncident bien sûr avec les objectifs majeurs de notre société.
Je demeure à votre entière disposition,
Michel Létourneau, Président.


- Au jour le jour, juin 1983
Architecture – La maison fortifiée
Construite vers 1688, cette petite maison mesurait environ 25’x30’ et était surmontée d’une énorme cheminée centrale de pierre; un toit à quatre versants en croupe la coiffait. C’était une maison d’habitation qu’on pouvait transformer en redoute sitôt qu’un danger se présentait; de lourds contrevents fermaient les ouvertures et des meurtrières étaient percées au niveau des combles, de sorte qu’on pouvait y tirer sur l’ennemi. Cette curieuse redoute fit couler beaucoup d’encre à la fin du siècle dernier; le courrier de Montréal le 24 août 1880 expliquait en ces termes :
“On construisit vers cette époque un fort de pierre d’environ 25’x30’ pour mettre les colons à l’abri. Cette construction après avoir défié les ravages de plus de deux siècles, est demeurée intacte, seulement le maçon en a fait disparaître les meurtrières et les a remplacées par des croisées, ce qui déroute l’étranger sur sa destination primitive. Ce vieux fort est transformé en maison d’habitation…” !

A cette époque on prenait cette maison pour le fort de LaPrairie mais le docteur T.A. Brisson démentit cette rumeur dans un article qu’il écrivit dans la Minerve du 20 mai 1882 :
“Quant à la maison de pierre qu’on a prise et donnée pour le fort de LaPrairie; il est certain qu’elle est bien ancienne et les meurtrières qu’on y voit dans les mansardes donnent raison de croire qu’elle a été bâtie dans un but militaire, cependant elle n’a jamais été ni le Fort ni dans la fort; elle pouvait être une redoute à défendre le fort comme le moulin à vent construit au sud du fort…”

Le bâtiment a été occupé par les Américains en 1775 du 8 septembre au 6 mai, ils en avaient transformé une partie en cachot. Ce qui expliquerait pourquoi Elisée Choquet confondait ce bâtiment avec un blockaus que les Américains avaient dû ériger durant leur séjour. On aurait même retrouvé après leur départ un boulet de canon marqué du sceau anglais et qui a été conservé par un Monsieur Ingalls de LaPrairie (où se trouve-t-il aujourd’hui ?). La petite maison fortifiée a hélàs été démolie au début du siècle; elle était située sur un terrain occupé présentement par les entreprises Oligny, rue du Boulevard.

- Au jour le jour, juin 1983
Edme Henry
Edme Henry (1760-1841)
Edme était le fils unique de Edme Henry, chirurgien-major dans le Royal-Roussillon, régiment ayant servi en Nouvelle-France et commandé alors par le lieutenant-colonel de Poularies durant la guerre de Sept Ans (1756-1841).
Après avoir terminé son cours classique au collège de Montréal et trois ans de droit, Edme, reçut le 2 juillet 1783 une commission de notaire du général Haldimand, gouverneur de la Province. Le 17 février 1794, il alla se fixer à LaPrairie et résider là où devait se fixer plus tard l’Académie St-Joseph, au coin des rues St-Ignace et Chemin de St-Jean. Dès 1796, il devint notaire du général Christie et bientôt l’agent de ses six seigneuries : Lacolle, Noyan, Sabrevois, De Léry, Bleury, Repentigny ainsi que de vastes intérêts à Chambly. Le gouvernement y joignit l’agence de la seigneurie de LaPrairie. Vers 1811 s’annonce la guerre avec les États-Unis. Nommé major au 2e bataillon de la milice de Beauharnois il se distingua sous les ordres du lieutenant-colonel De Salaberry et fut promu lieutenant-colonel commandant du 2e bataillon de Huntingdon le 2 juillet 1822. Cédant aux besoins et instances de ses compatriotes le 7 juin 1837, il ouvre une banque dont le bureau principal est à LaPrairie : c’est en pleine crise économique; une centaine de banques aux États-Unis font faillite et, au Canada, elles suivent. Pour venir en aide aux gens de LaPrairie et des environs, il fonde sa banque : “La Banque Henry”.
Il émet des billets de 5, 2 et 1 dollars et en petites coupures de 75 sous, un écu et 30 sous, et ce, en billets strictement bilingues.
A travers toutes ces occupations, il pratiqua le notariat jusque vers 1831 : 4831 actes, greffe important d’une époque de transition. Il s’occupa de l’aménagement des routes du comté de LaPrairie, aida à la création d’écoles, et encouragea la colonisation. Il fonda Napierville, Christieville (Iberville), Burtonville (St-Césaire) et Henryville. Il créa le Fort Neuf en 1822 pour les artisans qui affluèrent à LaPrairie, et se lança dans une compagnie de bateaux à vapeur : “Edmund Henry” et “Montréal”, puis, avec M. Ryland allongea le quai pour permettre à des bateaux de plus fort tonnage, d’accoster.

- Au jour le jour, juin 1983
Outils généalogiques
On dit souvent “faire sa généalogie”; voilà une expression pour le moins ambigue car si on la prenait à la lettre elle signifierait “choisir ses ancêtres”. Quoi qu’il en soit nous comprenons tous que la phrase désigne l’ensemble des recherches effectuées pour arriver à connaître les noms de nos ancêtres maternels et paternels de génération en génération. Les répertoires de mariages et les registres de baptêmes et de sépultures sont des outils indispensables pour arriver à cette fin. S’y ajoutent de patientes et laborieuses lectures d’actes notariés et la consultation d’une publication récente par un groupe de chercheurs en démographie de l’Université de Montréal, à savoir : la liste informatisée des noms de tous les résidents de la Nouvelle-France et des renseignements qui les concernent (baptême, mariage, sépulture, métier etc…). L’information ainsi recueillie doit par la suite être organisée de façon à ce que chacun puisse s’y retrouver assez rapidement. La méthode la plus fréquemment utilisée consiste à inscrire ces renseignements sur des feuilles (voir illustration), chacune permettant de connaître les quatre générations qui ont précédé un ancêtre donné. Chaque ancêtre y porte un numéro et son père est désigné par le double de ce numéro (nombre pair) alors que sa mère est identifiée par le double plus un (nombre impair). Pareille façon de travailler offre ses avantages et ses inconvénients; ainsi puisque les noms sont en ordre numérique il devient impossible de repérer un nom par ordre alphabétique, de plus les mariages consanguins y sont difficilement décelables.
Déçu de ne pouvoir vérifier rapidement si j’avais des ancêtres communs avec certains de mes amis et soucieux de mesurer les risques génétiques légués par mes aieux, j’ai pensé mettre au point un fichier que je vous propose aujourd’hui. Vous le constaterez rapidement, tout comme la précédente, cette manière de faire a aussi ses limites et ses profits. A chaque ancêtre sa fiche et son numéro, le nom étant toujours suivi de celui du conjoint (voir illustration) ainsi que des renseignements concernant le mariage, le baptême et la sépulture. Suivent les indications sur le lieu d’origine et des informations à caractère historique.


Comme ce fichier est destiné à mes enfants, ils peuvent donc y retrouver leurs ascendants paternels et maternels, aussi pour ne pas confondre les deux, les ancêtres de leur père voient leur numéro précédé de la majuscule B (pour Bourdages) et ceux de leur mère de la majuscule P (pour Péloquin). S’il s’agit en plus d’un ancêtre maternel, son numéro sera suivi de la majuscule M. Ainsi on aura vite compris que le numéro B 3114M indiquera à mon fils qu’il est en présence d’un ancêtre de son père et qu’il s’agit d’un ancêtre maternel. Toutes les fiches sont par la suite classées par ordre alphabétique et lorsqu’un personnage est plusieurs fois mon ancêtre sa fiche porte donc plusieurs numéros. Cette manière de procédér m’a permis de découvrir entre autre que j’avais des ascendants qui étaient communs à mon père et à ma mère ainsi qu’à mon épouse et à moi. J’y ai de plus appris qu’en Acadie nombreux sont ceux qui parmi mes ancêtres étaient frères et sœurs. Bref un fichier ainsi conçu permet un repérage rapide de n’importe quel prédécesseur et facilite la compilation de certaines statistiques. Tout compte fait je crois bien que l’effort en vaut la peine. Bon travail…


- Au jour le jour, juin 1983
Fonds Élisée-Choquet
Les jours et les années passent. Pour quelle raison a-t-on oublié de signaler en 1917 les 250 ans de la fondation de LaPrairie? Peut-être à cause de la guerre qui faisait rage en Europe? Quoi qu’il en soit, on confie en 1923 à T.A. Brisson le soin d’organiser des fêtes grandioses soulignant les 250 ans de la fondation de la “paroisse” de LaPrairie. Un cairn (petite pyramide de pierre) rappelant la bataille de 1691 sera dévoilé au “Carré La Mennais”.
Nous sommes en juin 1923 et Elisée Choquet vient d’être ordonné prêtre, il est tout jeune, à peine 23 ans. En attendant son départ pour Rome en septembre, où il étudiera pour obtenir un doctorat en philosophie, il est nommé “vicaire de vacances” à LaPrairie. Une “visite de paroisse” lui permet de rencontrer en sa demeure le docteur Thomas-Auguste Brisson. Ébloui par la richesse de sa bibliothèque et de sa documentation, épaté aussi par les connaissances de l’homme, Elisée Choquet se lie très rapidement à T.A. Brisson et devient bientôt son “bras doit” : organisateur des fêtes de LaPrairie qui auront lieu en août; ce sera une réussite.
Elisée Choquet revint comme vicaire à LaPrairie en 1929. Thomas-Auguste Brisson a déjà 77 ans à cette époque. Il habite depuis plusieurs années dans la famille de Joseph-Auguste, son frère, demeure qu’il devra bientôt quitter. Le grenier de son ancienne demeure sur le Chemin de St-Jean (aujourd’hui la maison Aubin) déborde de journaux accumulés depuis plus de 40 ans. L’abbé Choquet conscient de la valeur historique de ces documents demande au docteur Brisson l’autorisation de faire l’inventaire de ce riche contenu; c’est ainsi que commence à prendre forme l’actuel “Fonds Elisée Choquet”. Les deux compères sont liés par une passion réciproque pour l’histoire : Thomas-Auguste Brisson fournit la documentation tant et si bien qu’à son entrée comme résident à l’hospice de la Providence vers 1931 il aura presqu’entièrement cédé tous ses documents. T.A. Brisson est décédé le 18 décembre 1937. Elisée Choquet, homme d’action, étudie, classifie, note et se renseigne et avec l’aide de secrétaires de circonstance, Yvette Jubinville et Annette Lafond, les notes manuscrites sont dactylographiées.
L’éloquence d’Elisée Choquet était bien connue. Suite à une conférence fort appréciée, donnée à la “Société Historique de Montréal” paraître son volume sur les “Communes de Laprairie” en 1935. Sous la rubrique “En vidant mon carquois” il fera connaître LaPrairie et ses habitants aux lecteurs du Richelieu (journal hebdomadaire régional). Se basant également sur une vieille carte de la Seigneurie de Laprairie signée Joseph Riel et à l’aide des terriers (actes de concessions des terres) Elisée Choquet établira des cartes situant les concessions des premières familles de la seigneurie.
Riche de la documentation à laquelle il a lui-même éminemment travaillé; Elisée Choquet quittera LaPrairie en 1936. Les précieuses caisses de dossiers le suivront d’un endroit à l’autre : Longueuil, Delson, Saint-Edouard, Saint-Isidore et Varennes. Les recherches historiques sur LaPrairie se terminent presqu’entièrement au début des années 30, mais l’abbé Choquet complètera son documentation par de nombreux sujets et poursuivra les études généalogiques dans les paroisses du diocèse de St-Jean jusqu’à sa retraite en 1970. Il devait nous quitter le quitter le 14 mai 1972.
Voilà donc comment s’est constitué le “Fonds Elisée Choquet”.
(à suivre)

Références :
Fonds Elisée Choquet, Musée du Vieux Marché, Société Historique de LaPriarie.
Biographies Canadiennes-françaises, J.J. Lefebvre, Edition 1927, page 30.
Biographie d’Elisée Choquet, Archives du Diocèse de St-Jean, Québec.
Notes personnelles de Marcelle Brisson, nièce du docteur T.A. Brisson.
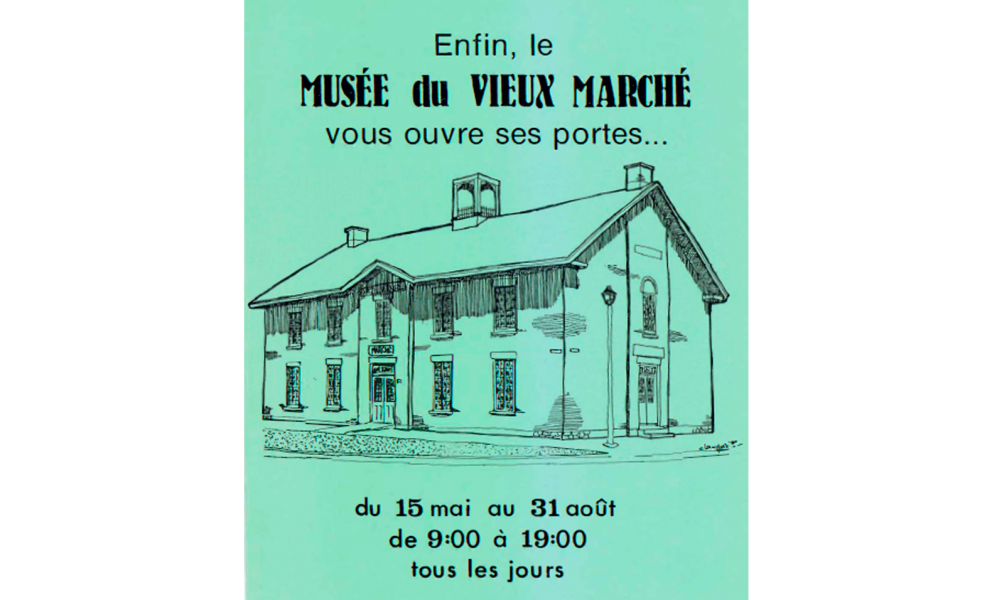
- Au jour le jour, février 1983
Quatrième de couverture
Enfin, le Musée du Vieux Marché vous ouvre ses portes…
du 15 mai au 31 août
de 9 :00 à 19 :00
tous les jours

- Au jour le jour, février 1983
Cotisations
Ne tardez pas à renouveler votre carte de membre. Votre diligence à ce faire accélère la réalisation de nombreux projets. Nouveau tarif en 1983 : 12$ pour l’année.

- Au jour le jour, février 1983
Psst…
Ne manquez pas le prochain numéro des Cahiers de la Société d’Histoire de Longueuil qui portera sur la querelle entre les curés Armand Ulric (LaPrairie) et Joseph Ysambart (Longueuil) au sujet du rattachement du Mouille-pied à la paroisse de Longueuil en 1722.
Il s’agit d’un dossier quasi complet mettant en relief tous les échelons de l’administration d’une société seigneuriale d’Ancien Régime où il n’y avait pas de séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Cette affaire, qui suscita une volumineuse correspondance, impliqua les deux curés concernés, les paroissiens, le baron de Longueuil, l’Intendant de la Nouvelle-France, l’évêque de Québec, et eut son point culminant jusqu’à Versailles.

- Au jour le jour, février 1983
Éditorial – La culture : un service essentiel
Les institutions multiples dont s’est munie la ville de LaPrairie depuis quelques années ne sont pas sans augmenter le bien-être de l’ensemble des citoyens : équipements modernes pour la lutte contre les incendies, hôtel de ville, garage municipal, centre et centre d’achats sont là, il faut bien le reconnaître, des services essentiels.
Cependant nous croyons que l’évolution et la composition actuelle de la population de LaPrairie exigent le développement plus marqué d’un secteur de l’activité humaine jusque là laissé dans l’ombre : à savoir le domaine culturel. Outre l’existence du Café instantané, du restaurant-théâtre du Vieux Fort et du Musée du Vieux Marché, les acquisitions à caractère culturel constituent à ce jour un bien maigre tribut. Cependant depuis quelques années, le dynamisme des édiles municipaux face à la Maison à tout l’monde et au Vieux Marché, autorisent, quant à la mise en place d’une maison de la culture, des espoirs encore insoupçonnés.
Il y a cent ans LaPrairie, grâce à la Société littéraire, était dotée d’une bibliothèque, d’une salle de lecture et d’une salle de discussion : hélas tout cela n’est plus. Et pourtant l’intérêt marqué des dernières années pour les nombreuses expositions d’œuvres d’artistes et d’artisans, la demande croissante pour des cours à caractère culturel (émaux sur cuivre, tissage, peinture, danse etc..) et l’augmentation des heures disponibles pour les loisirs appelle de plus en plus l’ouverture d’un véritable centre culturel à LaPrairie.
La Banque centrale de Prêt (dépôt régional de volumes qui sont prêtés aux nombreuses bibliothèques municipales de la région) en choisissant notre ville comme site posait sans le savoir un premier jalon en ce sens. Il va sans dire que les débuts peuvent être modestes et prendre place à l’intérieur d’un édifice déjà existant (n’a-t-il pas fallu vingt ans à la bibliothèque municipale de Boucherville avant d’être logée dans le magnifique centre culturel actuel ?). Quoi qu’il advienne, nombreux sont ceux qui dans notre ville songent de plus en plus à la nécessité d’une bibliothèque municipale et croient que sur ce point il serait grand temps de revenir cent ans en arrière.

