
- Au jour le jour, septembre 1996
Commission des biens culturels du Québec
Le 1er août dernier, le Conseil de la SHLM et M. Taillefer, conseiller municipal, avaient l'honneur de recevoir officiellement les membres du Comité provincial des Biens culturels sous la direction de M. Cyril Simard, président. Ce comité a pour mandat de conseiller Madame la Ministre Beaudoin, des Affaires culturelles. Ces personnes se sont intéressées à l'ensemble des activités et réalisations de la SHLM. Une attention particulière a été portée aux Archives de la SHLM, classées et informatisées, archives abondantes et mises à la disposition des nombreux chercheurs que nous recevons. L'étape suivante de l’informatisation, l'INTERNET, sera atteinte d'ici quelques mois et informera par sa page WEB un public multinational.
Nos visiteurs ont également parcouru certaines rues de l'arrondissement historique et visité l'intérieur de l'église. La déclaration ministérielle de 1975 qui classait le Vieux-La Prairie « arrondissement historique » leur est apparue entièrement justifiée. À l'époque, le Ministre de la culture M. Denis Hardy voulait offrir aux résidents et visiteurs « un exemple typique d'un village du Québec à la fin du siècle dernier ». Le quartier est en « devenir » et déjà on peut admirer plusieurs bâtiments, publics ou résidentiels, qui ont été restaurés d'une façon exemplaire.

- Au jour le jour, septembre 1996
Archi-Log – Internet – Page Web
La SHLM a demandé une subvention, et l'a obtenue, pour continuer le travail déjà accompli en informatisation de nos archives afin de pouvoir être branché sur INTERNET – une PAGE WEB sera complétée au printemps 1997. Les internautes nationaux et internationaux pourront connaître notre Société historique, ses activités et certains sujets particuliers de l'histoire de La Prairie. On y ajoutera une série de photos qui seront une invitation à venir visiter notre petit coin de pays. De plus, notre service de généalogie sera publicisé, certains fonds d'archives seront sommairement présentés ainsi que la liste de nos publications. L'archéologie et les résultats des fouilles effectuées seront également mentionnés.
Brochure
La subvention obtenue, citée plus haut, comprend un volet qui permettra de présenter à toute la population de La Prairie, via le service des Postes, une BROCHURE DE 8 PAGES. Au moyen de textes et de photos, l'arrondissement historique sera présenté et nos concitoyens de La Prairie seront invités à venir partager les richesses de notre patrimoine. Cette brochure « numérisée » sera incluse dans la page WEB préparée pour INTERNET.
Archi-Log
Ce logiciel de base pour le traitement et la conservation des archives d'organismes privés ou publics a été créé par la SHLM et André Kahlé, informaticien. Il est conforme aux règles pour la description des Archives (RDDA) des Archives nationales du Québec. La SHLM a vendu à ce jour trois exemplaires de ce logiciel à des centres d'archives ou institutions. Un guide d'aide à l'utilisateur de ce logiciel est terminé depuis peu.
En complément à ARCHI-LOG, notre secteur Archives a piloté nos informaticiens qui ont créé des logiciels complémentaires, à savoir : Bibliothèque, BMS, photographies, cartographie historique (Fonds des Jésuites), inventaire. Notre logiciel RECHERCHE établit une interrelation entre tous les fonds d’archives informatisés. Tel que souligné précédemment, l’étape suivante est l’entrée de la SHLM dans le réseau INTERNET.
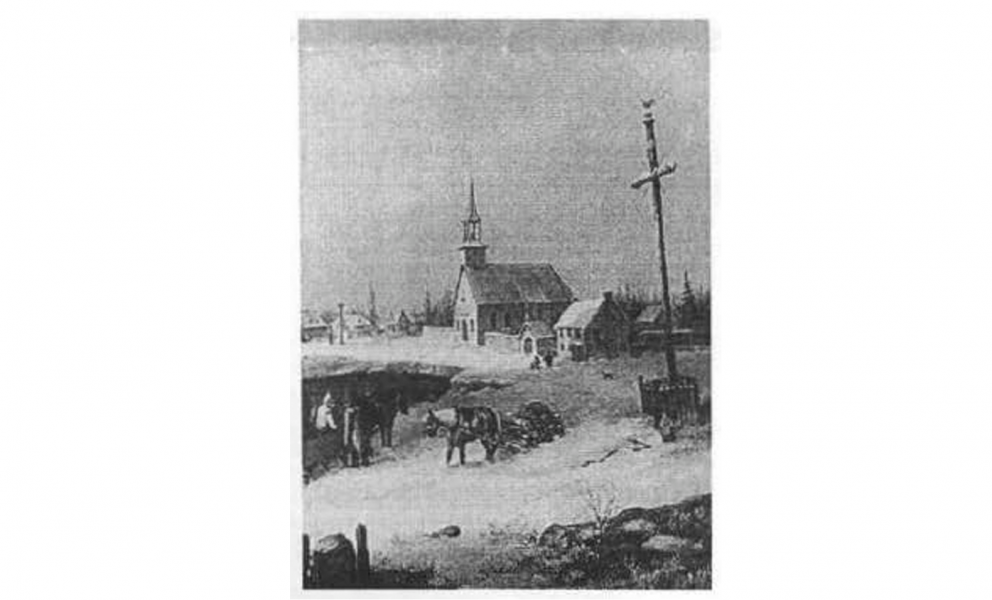
- Au jour le jour, septembre 1996
Jean L’Heureux sur Internet
Notre président M. Jean L'Heureux est devenu bien malgré lui une célébrité internationale depuis que son nom apparait sur internet. Pour s'en convaincre il suffit de consulter la liste des sociétés d'histoire membres de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec; l'internaute a accès à cette liste à travers le site de l'Association des archéologues du Québec. Mais attention, il est toujours possible d'accéder à cette information à travers d'autres sites ou web (www).
D'ailleurs il m'a suffi d'à peine quelques heures de navigation sur internet pour constater qu'il existe de l'information sur La Prairie disponible sous de nombreuses rubriques. En voici quelques exemples parmi plusieurs :
- Le CD Canadisk (http://www.schoolnet.carleton.ca/cdisk/) propose près de 2000 images sur l’histoire du Canada dont « Le premier train » par J. D. Kelly ou encore cette vue de Longueuil par Krieghoff que l’on retrouve dans cet article.
- Le CD E-Stat offre à travers le site CANSIM des tonnes de statistiques sur le Canada et il est donc possible d’y consulter et de télécharger des données sur La Prairie.
- Le site des Ressources naturelles du Canada, section Toponymes, propose également de l’information sommaire sur La Prairie.
- Le site « Francêtres : la page de généalogie du Québec! » fera l’envie de tous les généalogistes, particulièrement pour ses informations sur les premiers Acadiens. Ce site est en progression continuelle.
- Le site « 1775 : The French and Indian War », hélas uniquement en anglais, fournit la liste des noms de tous les soldats des régiments français venus combattre en Nouvelle-France entre 1755 et 1760. On y retrouve donc tous les soldats du régiment de Roussillon. L’auteur prépare la publication d’un volume qui contiendra des informations sur chacun de ces soldats et particulièrement sur ceux qui se sont installés ici après la guerre. Un site à surveiller de près…
Bien sûr la liste qui précède est loin d'être exhaustive et j'invite tous les membres de la société qui sont branchés sur internet à nous faire part de leurs découvertes. L'information abonde pour les amateurs d’histoire, de généalogie et d'archéologie. Les sites francophones intéressants se multiplient. N’oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger l'information offerte et choisir de la conserver sur disquette ou l'imprimer. Il est également possible de communiquer avec les auteurs des sites (la plupart réclament des commentaires) grâce au courrier électronique (E-mail) et ce quel que soit l'endroit où ils habitent sur la planète.
Je vous souhaite une excellente ballade à travers le réseau des réseaux.
Gaétan Bourdages

- Au jour le jour, septembre 1996
Première conférence : évolution des terres occupées par les F.I.C. et histoire de la petite chapelle
Le 18 septembre à 20 heures, Gaston Roy f.i.c. nous présente son travail sur l'évolution des terres occupées par les frères et l'histoire de la petite chapelle.
Un rendez-vous à ne pas manquer!

- Au jour le jour, septembre 1996
Le village de La Prairie, son climat social au début du siècle
Nous citons quelques idées ou descriptions qui sont un « portrait » du Vieux-La Prairie, que ce soit des personnages, des événements, des attitudes, des lieux qui étaient familiers à tous les résidents de La Prairie, village et campagne. Les anciens actuels (55 ans et plus) auront facilement souvenance de maintes choses et lieux évoqués dans ce petit roman. Tous apprendront qu'en 1920, le fleuve offrait à qui venait les cueillir de magnifiques nénuphars. Inutile de redire que le mot pollution n’était pas familier à ceux qui fréquentaient régulièrement les rives du beau fleuve Saint-Laurent à cette époque.
- Il y a huit ans, le service d'autobus n'existait pas à Laprairie, et l'unique voie rapide pour gagner Montréal était celle du Grand-Tronc qui existe encore. Jusqu'à l’été de 1909, alors qu'il lui advint de brûler, un vapeur faisait aussi la traversée de Montréal. p. 44
- Blandine trouva belle sa petite ville sous les reflets du soleil mourant et elle, si satisfaite tout à l’heure de se promener dans d'autres parages, elle se disait à présent que la douceur du retour vaut encore mieux que tout. p. 44
- Le soleil n'avait pas encore disparu et, avec une magnificence folle, il continuait d'embraser l'horizon. Ses rayons obliques, capricieusement, teignaient de pourpre quelques maisons, en dédaignaient d'autres, transmutaient en or d'humbles vitres et, soudain obstrués par un nuage, vernissaient de claire lumière une partie de la ville quand l'autre partie allait s’éteindre dans l’ombre. p. 45
- La jeune femme ne se lassait pas d'admirer cette féerie, vieille comme le monde, du soleil qui se couche. En face d'elle, quelque part à l'entrée de la Commune, qui est un ancien champ de manœuvres, une petite maison de pierre des champs, toute basse sous sa toiture en pente, se voyait particulièrement favorisée par le royal pinceau. Toutes ses vitres flambaient et ses vieilles pierres, couleur du chemin que chacun foule, tour à tour s'empourpraient ou se rosissaient comme sous l'ardeur de quelque émotion juvénile. p. 45
Les citations qui précèdent sont tirées d'un don particulier de Jeannine Brillon, autrefois de La Prairie. Il s'agit d'un roman.
Jarret, Andrée, Le Médaillon fatal, roman canadien inédit, Éd. Edouard Garand, Montréal, 1924, 48 pages.
Andrée Jarret est le pseudonyme de Cécile Beauregard, possiblement résidente de La Prairie à l'époque.
Dans ce roman toute l'action se déroule à La Prairie. L'intrigue amoureuse se joue entre une demoiselle Blandine Lanctôt, issue d'une famille à faibles revenus, et le fils du notaire Bisaillon. On y parle de la maison du « domaine », de la bibliothèque paroissiale et de celle de la Salle Littéraire et d'un bon vieux monsieur Bonneterre. La parenté de la « ville » venait en train pour fêter le nouvel An. Après la débâcle à La Prairie, tous participaient à la fête de l'eau. Même alors, les terrains non bâtis autour du village étaient couverts de nappes d'eau et dans les campagnes, l'eau atteignait en hauteur les trois-quarts des clôtures. La petite Marie-Jeanne Brosseau, orpheline de mère, était pensionnaire au couvent pour ensuite être placée à Villa-Maria avec les jeunes filles riches de Montréal.
Un après-midi de novembre, Blandine, l'amoureuse, approchait du réservoir de l'aqueduc, tonne ronde montée sur des échasses et elle débouche sur la rue Saint-Jacques.
***
Un jour d'hiver, Blandine inspectait autour d'elle la neige piétinée. Les citoyens de Laprairie, pensait-elle, sont une race active et laborieuse, ils possèdent toutes les qualités pratiques, moins celle de débarrasser leurs rues de la neige d'hiver. D'ailleurs, cette négligence ajoute pittoresquement au charme des vieilles maisons dépeintes.
Blandine aimait l'eau et le grand fleuve au bord duquel elle était née. Aussi en s'engageant à l'entrée du Carré, petit parc situé au bord de l'eau, elle vit qu'il était vide et elle s'avança le plus près possible de la grève. Montréal se distinguait nettement avec sa pointe avançante qu'est Verdun. Entre toutes les fleurs, c'était les nénuphars qu'elle préférait, elle les avait cueillis au bord du fleuve. Ce roman d'amour se termine tout simplement par cet échange entre deux êtres qui ont vécu mille difficultés et qui enfin retrouvent la liberté de se donner l'un à l'autre : « Que puis-je pour vous, Blandine? Aimez-moi, mon cher Maurice ».

- Au jour le jour, septembre 1996
Interventions archéologiques à La Prairie
Le grand potentiel archéologique que recèle le sous-sol du Vieux-La Prairie est depuis longtemps reconnu par tous les intervenants bien informés. En effet, La Prairie, qui connaît une occupation eurocanadienne depuis le XVIIe s., était déjà, bien avant, un endroit privilégié par les Amérindiens. Grâce à sa situation géographique propice, La Prairie a connu un développement progressif intense entre le début du XVIIIe et le milieu du XIXe s. Malheureusement, d'un point de vue économique, un incendie allait stopper cette progression en 1846. Mais cette même conflagration allait faire en sorte que le site du Vieux-La Prairie soit demeuré depuis ce temps une zone très peu perturbée par le progrès, conservant ainsi dans son sol les artéfacts qui servent si bien à décrire son histoire et même sa pré-histoire.
Conservant toujours les vestiges de plusieurs structures intéressantes d'un autre âge telles les palissades de bois, les moulins, le blockhaus, et bien d'autres, en plus d'objets témoins d'une occupation amérindienne, le Vieux-La Prairie offre aux chercheurs des sites de choix pour les fouilles archéologiques. Si bien que depuis 1973, pas moins de vingt-deux interventions archéologiques y ont été faites.
Parmi les plus récentes citons celles qui ont davantage retenu l'attention des gens, dont celles effectuées en 1984 sur les lots cadastraux 86 et 89, site de l'ancienne Académie St-Joseph, où on a retrouvé des composantes archéologiques historiques aussi bien que préhistoriques. En 1994 les fouilles entreprises suite à l'incendie de la taverne Laprairie sur le lot 94, angle Ste-Marie et St-Georges alors que l'on a mis à jour les traces de la palissade de bois de 1689. Dernièrement, une surveillance archéologique lors de travaux effectués par Gaz Métropolitain angle des rues Ste-Marie et Chemin St-Jean alors que l'on a retrouvé une partie des fondations de l'hospice des Sœurs-de-la-Providence, construit en 1868 et incendié en 1901.
D'autres interventions récentes, d'abord en 1995, sur la propriété de M. Marcel Oligny et cette année sur le lot 178, derrière la station Shell rue St-Henri, ont été trop brèves pour localiser précisément les structures recherchées, soit le blockhaus et le vieux moulin; mais il n'en reste pas moins que ces endroits de même que beaucoup d'autres recèlent un potentiel indéniable.
Présentement, la Ville de La Prairie, dans le cadre d'une entente avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, a mandaté la firme Arkéos Inc. pour réaliser un plan de gestion des ressources archéologiques du Vieux-La Prairie. La réalisation de ce projet devant inclure une vérification du potentiel par des sondages et tranchées sur deux ou trois sites vacants prioritaires, des fouilles ont été faites sur les lots 59, 60 et 61, face à la Maison-à-tout-le-monde, Chemin St-Jean. Cette intervention aura permis d'abord de préciser la localisation de l'église construite en 1705 et remplacée par l'église actuelle en 1841, de confirmer l’occupation de ce site par les Amérindiens avant l'arrivée des blancs et de localiser un édifice ancien et les traces de la palissade de bois qui entourait autrefois le vieux village.
Compte tenu de ce grand potentiel, la Société historique souhaiterait la création d'un parc archéologique dans le Vieux-La Prairie où se succèderaient années après années durant la période estivale des fouilles intensives. Espérons qu'un jour ce vœu sera réalisé.
Marcel Lamarche, août 1996.

- Au jour le jour, juin 1996
Dons
De Gaétan Bourdages, 6 volumes traitant de toponymie produits et édités par la Commission de Toponymie, Gouvernement du Québec.
- Bibliographie toponymique du Québec, 1912-1987
- Guide toponymique du Québec, 1912-1987, politiques principes et directives
- Guide odonymique du Québec, 1912-1987
- Méthodologie des inventaires toponymiques, dossier numéro 16, méthodologie des inventaires, mai 1986
- Guide topographique municipal, document de travail, 1979
- Dossier toponymique de la région de Montréal, mai 1980.
De Jules Sawyer, f.i.c.
- E. Z. Massicotte, Faits curieux de l’histoire de Montréal, Éditions Beauchemin, Montréal 1924. 1er texte : reproduction des pages 147-180 : La complainte des 40 noyés, 14 mai 1819, analyse des récits recueillis qui relatent ce naufrage d'un bateau qui ramenait ses passagers à La Prairie. 2ème texte : Le combat de la Rivière-des-Prairies, 1690. L'auteur dresse la liste, qu'il sait incomplète, des Français qui ont péri ou furent fait prisonniers lors de celle bataille contre les Iroquois. Le combat de 1690 se livre un an après l'hécatombe de Lachine en août 1689.
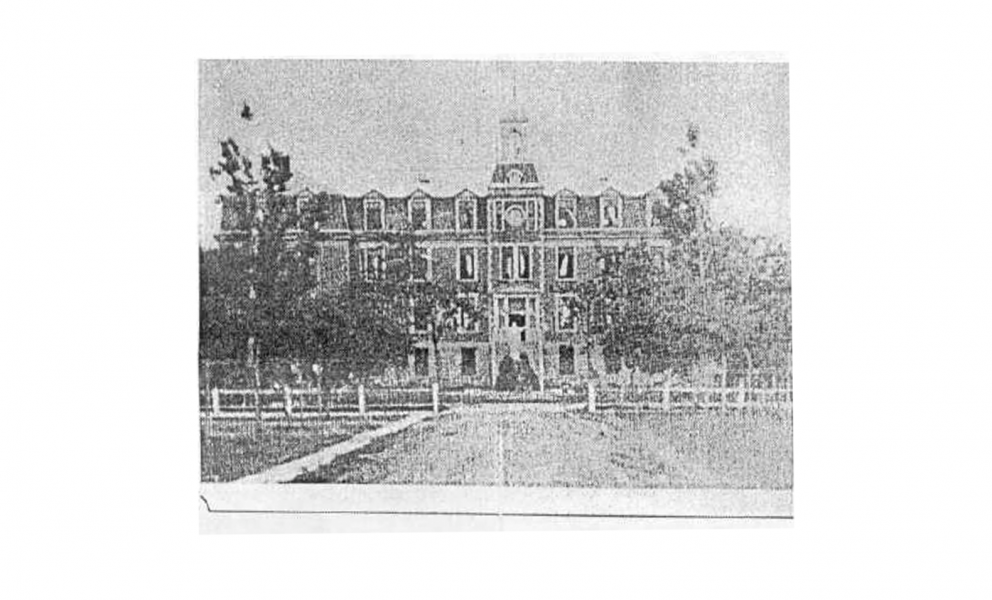
- Au jour le jour, juin 1996
Nouvelles
Notre prochaine exposition
La prochaine exposition, présentée au Musée du Vieux-La Prairie, portera sur la présence des Frères de l’Instruction Chrétienne à La Prairie.
Au moyen de photos, nous évoquerons la fondation du noviciat en 1886, puis de l’Académie St-Joseph, de l’École St-François-Xavier et du Collège Jean-de-La Mennais.
Un bref aperçu de la vie de leur communauté ainsi que des publications et manuels scolaires des F.I.C. seront également exposés.
Cette exposition débutera le 15 juin et se continuera tout l’été, jusqu’à la Fête du Travail. Des guides-étudiants seront à la disposition des visiteurs tous les jours. Bienvenue à tous, amenez-vous amis et les « anciens » étudiants des F.I.C. à La Prairie.
Remerciements
Un merci particulier à madame Isabelle Robert, consultante en archéologie, qui nous a remis le texte écrit de la conférence qu’elle a donnée à la SHLM le 15 mai 1996, « Étude du potentiel archéologique des lots 29 à 33 et partie des lots 300 et 301 dans le Vieux-La Prairie ».

- Au jour le jour, juin 1996
Généalogie de Lucien Lefrançois
|
Lucien C. Lefrançois Germain Charron |
Mont Saint-Grégoire 26 novembre 1938 |
Hormisdas Charron Eugénie Auclair |
|
François Lefrançois Éva Collette |
Saint-Dominique, cté de Bagot 09 juillet 1917 |
Auguste Collette Hermine Duchesneau |
|
Joseph Lefrançois Mathilde Desjardins |
Sainte-Félicité de Matane 20 avril 1874 |
Jean Desjardins Marie Bérubé |
|
Joseph Lefrançois Marie Gagné |
Saint-Germain de Rimouski 13 août 1831 |
Joseph Gagné Marie Paré |
|
Ignace Lefrançois Rosalie Gravel |
Château-Richer 8 novembre 1785 |
Ignace Gravel Agnès Gagnon |
|
Louis Lefrançois Louise dite Geneviève Cloutier |
Château-Richer 15 novembre 1751 |
Louis Cloutier Geneviève Chaplain |
|
Charles Le François Véronique Quentin |
Ange-Gardien 11 janvier 1722 |
Louis Quentin Marie Mathieu |
|
Joseph Lefrançois Anne-Cécile Caron |
Sainte-Anne de Beaupré 20 janvier 1698 |
Robert Caron Marguerite Cloutier |
|
Charles Le François Marie-Madeleine Triot |
Notre-Dame de Québec 10 septembre 1658 |
Jacques Triot Catherine Guichart |
|
Charles Le François Suzanne Montigny |
De Saint-Pierre de Muchedent, arrondissement de Dieppe, archevêché de Rouen, Normandie (France) |
|
Lucien C. Le François
Notre ami Lucien, qui se définit comme un guide touristique de Saint-Hyacinthe, a vu le jour sur les rives de la rivière Richelieu, à McMasterville, face au Mont Beloeil, le 17 juillet 1918. Son père travaille à la Poudrière « C. I. L. » de Beloeil. La famille s'installe à Saint-Hyacinthe à partir de 1923. Après s'être retire des affaires, Lucien continue de cultiver son amour pour l'histoire et la généalogie. Il est membre de dix sociétés d'histoire de la région et des deux principales sociétés généalogiques du Québec.
Charles Le François (1626-1700)
Originaire de Muchedent, arrondissement de Dieppe, en pleine Normandie, et fils do Charles François et de Suzanne Montigny, Charles Le François débarquait en Nouvelle-France, en 1650, à l'âge de 24 ans. Il épouse à Québec une Parisienne de 19 ans.
Sur la côte de Beaupré, comprise entre la rivière Montmorency et la rivière du Petit-Pré « ou Lotinville », l'ancêtre acheta trois arpents de terre, longeant le fleuve Saint-Laurent, avec droits de chasse et de pêche. Il défricha son terrain et s'y construisit une maison de pierre. Son épouse lui donna ses trois premiers enfants à cet endroit. Après quatre ans de séjour, le 29 août 1663, il vendit sa propriété au sieur de Chastillon, au prix de 1 150 livres tournois. Il ne put assister à la fondation officielle de la paroisse l'Ange-Gardien « ou se trouvait son premier terrain », qui se détacha de la paroisse de Château-Richer, en 1664.
La veuve de Pierre Le Gardeur lui vendit en 1667 un lopin de terre de trois arpents et cinq perches à Château-Richer sur la rive du fleuve. L'année suivante, il acquit une nouvelle propriété de 5 ½ arpents de front sur une 1 ½ lieue de profondeur, à une distance de 6 arpents de la rivière Petit-Pré. Il y demeura jusqu'à la fin de ses jours. Au recensement royal de 1681 l'ancêtre possédait 20 arpents de terre, 100 enfants, 2 fusils, 1 cheval, et 14 bêtes à cornes.
De 1666 à 1700 il occupa diverses professions pour la Côte de Beaupré et le fief de l'Ange-Gardien; les seigneurs et sénéchaux de la région choisirent Charles comme estimateur de possessions mobilières des habitants, contrôleur des exécuteurs testamentaires, et médiateur pour les querelles de toutes sortes. On reconnaissait ainsi son impartialité et son sens de la justice.
Fait remarquable
De génération en génération il y a toujours un Lefrançois arpenteur depuis te régime français de 1732 à nos jours. Huit arpenteurs se sont succédé. 1732, Charles Le François à Ange-Gardien, arpenteur juré royal
1749, Charles Le François fils à Ange-Gardien, arpenteur juré royal
1823, Nicolas Le François à Ange-Gardien, arpenteur géomètre
1848, Nicolas Venant Lefrançois à Ange-Gardien, arpenteur géomètre
1856, Pierre Octave Lefrançois à Ange-Gardien, arpenteur géomètre
1882, J. M. Émile Lefrançois à Québec, arpenteur géomètre
1962, Marc Lefrançois à Ange-Gardien, arpenteur géomètre
1979, Lefrançois et Lefrançois et Nault à Beauport, arpenteur géomètre

- Au jour le jour, juin 1996
L’école du Fort-Neuf
Pour vous préparer à l'exposition qui aura lieu à la SHLM cet été qui porte sur les écoles des f.i.c. à La Prairie, nous vous offrons quelques textes inédits d'un père qui relate à ses enfants ses souvenirs d'écolier dans les années 1930.
L'ÉCOLE DU FORT-NEUF
En ce temps-là, il y avait aussi l'école. J'ai commencé à la fréquenter en septembre 1931, inscrit au cours préparatoire à l'école du Fort-Neuf. Il n'y avait dans cette école que ce cours et la première année, du moins pour les garçons. Je sais que plus tard il y eut dans le bâtiment agrandi plusieurs classes de filles, mais j'ignore s'il en était ainsi au moment où j'y étais. On allait à l'école toute la journée en cours préparatoire, et sans doute que l'approche pédagogique y différait un peu d'une classe maternelle. Les enseignants étaient des Frères de l'Instruction Chrétienne, et j'ai toujours retenu le nom de celui qui avait charge du cours préparatoire, le frère Anatolius. La photo de classe d'alors, que j'ai conservée, le montre comme un homme près de la cinquantaine, bien bâti, inspirant le respect mais qui paraissait sympathique.
Je fis aussi ma première année à cet endroit. Je crois que j'étais un bon élève, apprécié de ses maîtres et dont ses parents étaient fiers. Je n'ai que deux souvenirs en rapport avec ces deux années scolaires. Le premier vient peut-être du fait que mes parents en reparlaient en se moquant un peu pour souligner un petit trait de caractère. À cette époque, il était coutume en s'adressant à des religieux d'utiliser des formules de respect dont comme enfants nous ne saisissions pas vraiment le sens et que nous répétions comme nous les avions entendues. En adressant la parole au frère pour lui demander quelque chose, par exemple, on devait dire « Révérend frère ». J'avais dû mal entendre ce mot pour moi sans signification et comme je le répétais habituellement automatiquement en parlant plutôt vite, je disais « orange frère » au lieu « révérend frère ». Le plus surprenant est que j'ai dû faire cette substitution maintes et maintes fois sans que personne ne me reprenne. Lors de notre voyage en Gaspésie, j'eus le désir d'envoyer une carte postale au frère Anatolius, une carte évidemment écrite de ma main. M'adressant au frère je commence mon message par : « Orange frère ». Mon père me relisant pour m'aider à corriger des fautes possibles me fait remarquer que ce n’est pas orange mais bien révérend qu'il faut écrire. Je n'en veux rien croire, qu'est-ce qu'il en sait lui, ce n’est pas lui qui va à l’école et puis moi c'est toujours ça que j'ai dit et le frère en question, lui, a toujours approuvé. Paraît que j'en fis une scène et que je ne voulus jamais en démordre et que finalement la fameuse carte postale ne fut jamais mise à la poste, du moins pas à ma connaissance. Si elle le fut avec altérations, je n'en sus jamais rien. Cet incident montre que j'étais capable de persistance et même d'un certain entêtement quand je le jugeais à propos. Je reconnus cependant plus tard de façon implicite cette erreur de jeunesse en rajustant mon tir verbal tant à l'oral qu'à l'écrit et il est évident que sans avouer quelque honte que ce fut je me mis à l’écoute des gens d'expérience avec plus d'attention.
L’autre souvenir que j'ai gardé en mémoire est un événement cosmique survenu en une fin d'après-midi, possiblement de septembre, sur le chemin du retour de l’école. L'école n'était qu'à deux ou trois rues de chez nous et comme la plupart des enfants quand il fait beau j'avais plaisir à m'attarder sur le chemin du retour en m'amusant avec les amis. La chose était courante et, je pense, bien tolérée de ma mère quand l'arrivée à la maison n'était pas exagérément distante du moment de la fin des cours. Trop de retard entraînait des remarques et possiblement des réprimandes. Ce jour-là, je ne me hâtais donc pas particulièrement; il faisait beau et il n'y avait aucun signe d'orage pouvant laisser présager que le ciel pourrait s'assombrir. Cependant, c'est effectivement ce qu'il advint. Au cours de mon jeu, je réalisai tout à coup qu'il faisait sombre comme si ayant oublié le temps ou en ayant sauté un bout je me retrouvais au début de la soirée et donc très en retard pour rentrer à la maison. Est-ce qu'alors je pris mes jambes à mon cou pour rentrer à la maison au plus tôt? Ou bien ai-je tenté avec mes compagnons de comprendre ce qui se passait? Ai-je regardé le ciel pour voir ce qui arrivait au soleil? Je n'ai nul souvenir du processus que j'ai employé pour résoudre ce problème complexe et qui finit par se résoudre de lui-même quand la lune ayant terminé son passage devant le soleil l'ombre de ce soir artificiel disparut ramenant la conscience du temps à son état naturel.

