
- Au jour le jour, avril 1999
Grande vente de livres usagés
Nous disposons, actuellement, de près de 800 livres, qui sont soit des doubles, soit des volumes qui ne sont pas connexes aux activités de la S.H.L.M. et qui nous ont été légués par nos membres ou par d’autres bienfaiteurs.
L’objectif principal est de liquider ces livres et de ramasser des fonds pour enrichir notre bibliothèque. Dans certains cas, il s’agira d’aubaines, dans d’autres, de prix conformes à ceux du marché actuel. Ces livres sont, en général, en très bon état.
Voici les étapes que nous avons envisagées dans le déroulement de cette vente:
1. Vente aux membres de la S.H.L.M.
Dans un premier temps, la vente sera consacrée exclusivement aux membres de la S.H.L.M. et les prix seront de 50% de l’évaluation que nous avons effectuée auprès des libraires ou en consultant leurs catalogues.
Pour ce faire, il y aura dans les locaux de la S.H.L.M. des listes mises à la disposition des membres et contenant les titres des livres avec les prix.
Ces listes pourront être consultées dans les semaines du 3 et du 10 mai’99 durant les heures régulières d’ouverture de la S.H.L.M.
Par la suite, la vente se tiendra exclusivement pour les membres, à la Maison-à-Tout-le Monde, près de l’Église, les 19 et 20 mai 1999, de midi à 20 heures.
2. Vente au grand public.
Dans un deuxième temps, les livres qui n’auront pas été achetés par les membres, seront offerts au grand public.
Le tout se déroulera le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le jeudi 24 juin 1999, à l’extérieur et autour des locaux de la S.H.L.M. À cette occasion nous retiendrons les services d’un «encanteur» professionnel. Cette fois encore, il ne faut pas oublier que l’opération vise exclusivement à ramasser des fonds pour la bibliothèque.
Voilà, brièvement, le sens et le déroulement de cette vente de livres. Espérons que nos membres répondront généreusement à cette invitation.
Les responsables de la bibliothèque
Lucette et Raymond Monette

- Au jour le jour, avril 1999
SHLM Nouvelles
Cours d’archéologie
Les inscriptions pour le cours d’archéologie vont bon train. Déjà, nous avons 22 personnes d’inscrites. Il y a encore de la place. D’ici le 14 avril, les personnes intéressées peuvent nous rejoindre au local de la Société ou au numéro suivant : 659-1393. Rappelons que le coût est de 30$ pour les membres. Les cours se donneront à tous les mercredis soirs à la Maison à Tout le Monde. En plus des 7 rencontres, il y aura 3 excursions les samedis.
Programme d’échange et de coopération en archéologie entre la France et le Québec.
La Société historique de La Prairie a été approchée pour participer à un important projet d’échange et de coopération en archéologie entre la France et le Québec. L’invitation nous a été faite par Messieurs Benjamin Masse et Christophe Rivet de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs; organisme créé pour gérer le projet. La Commission regroupera divers organismes, instituts et spécialistes des deux côtés de l’Atlantique, dont la Société historique de La Prairie. Le projet de recherches archéologiques s’étalera sur cinq ans. Du côté québécois, c’est le site du Vieux-La Prairie qui a été retenu pour la qualité de la préservation de ses vestiges. Du côté français, les recherches s’effectueront dans un château du 17e siècle situé sur l’île d’Oléron qui se trouve en face de La Rochelle. Les recherches archéologiques sur le terrain débuteront l’an prochain dans le Vieux-La Prairie. Elles seront dirigées par M. Marcel Moussette de l’Université Laval. Quant à la Société historique de La Prairie, elle verra principalement à la mise en valeur et à la diffusion des résultats de recherche pendant et après les fouilles. Certes un dossier à suivre dans les prochains numéros du « Au Jour le Jour».
Travaux au local de la Société historique
Les travaux de rénovation au local de la Société historique commenceront dans la semaine du 19 avril prochain. La Ville de La Prairie annoncera publiquement le choix du contracteur le 13 avril. Malgré les inconvénients que cela apportera, nos locaux resteront ouverts pendant toute la durée des travaux. Un local nous a aussi été réservé à la Maison à Tout le Monde où certaines activités pourront y être tenues.
Don
De René Barbeau: The New Orleans Genesis, January 1995, vol. XIV, No 53 _ Genealogical Research Society of New Orleans.

- Au jour le jour, avril 1999
Attention !!!
Les travaux effectués à nos locaux mettent un terme aux conférences pour la saison en cours.
La Fondation de la Société historique de La Prairie a vu le jour.
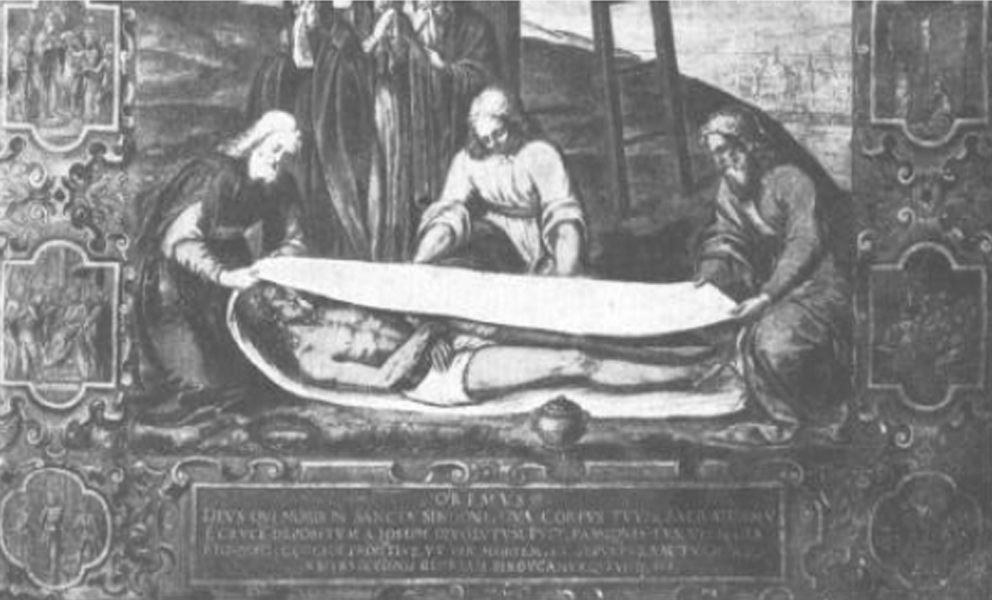
- Au jour le jour, avril 1999
Jésus-Christ est-il un personnage historique?
Pour tout chrétien la personne de Jésus est au coeur même de sa foi. Homme véritable et Dieu incarné sont deux dimensions indissociables du dogme chrétien. Tous, croyants ou incroyants, reconnaissent l'importance capitale qu'il a eue dans l'histoire de l'humanité. Cependant, les témoignages historiques de l'existence de Jésus hormis ceux de la Bible sont peu nombreux. Depuis plusieurs années, de nombreux spécialistes se posent des questions sur la réalité du personnage du Christ. De nouvelles découvertes faites par les historiens, les exégètes et les scientifiques apportent un éclairage nouveau sur le sujet.
Parmi les reliques vénérées par les chrétiens, le suaire de Turin constitue certainement la plus connue et la plus mystérieuse. Depuis 1978, le tissu qui aurait servi à envelopper le corps du Christ a été passé au crible par des dizaines de spécialistes. Leurs analyses révèlent entre autres des traces de sang véritable, des pollens de plantes provenant exclusivement de la Palestine et des différentes régions où le linceul se serait retrouvé à travers les siècles. Les fibres de lin du linceul proviennent d'une espèce de cotonnier du Moyen-Orient (le Gossypium herbaceum). Elles ont été tissées selon une ancienne méthode fréquente en Syrie.
Certaines personnes parlent du suaire comme d'un faux qui aurait été fabriqué au Moyen-Âge (probablement au 14e siècle) par un artiste. Cependant, la représentation du corps que l'on voit sur le drap funéraire ne correspond en rien aux techniques et aux connaissances qu'on avait à cette époque. C'est en 1889, lorsque les premières photographies ont été prises du suaire qu'on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une image imprimée en négatif sur le tissu. C'est en tirant le négatif que le photographe a retrouvé, à son grand étonnement, une image positive saisissante de réalisme. De plus, les analyses de la NASA ont démontré que l'image était aussi tridimensionnelle. L'intensité de l'image décroît dans la proportion où augmente l'intervalle séparant le tissu du corps. Les hypothèses de dessin, de frottis, de pochade ou de peinture ne tiennent pas non plus. En effet, toutes ces techniques montrent une direction dans l'application de la substance colorante, ce qui n'est pas le cas ici. L'image est égale dans toutes les directions. On peut se demander alors comment et pourquoi un faussaire du Moyen-Âge aurait réalisé une relique difficilement visible à l'œil nu selon des techniques inconnues à l'époque et représentant un crucifié avec une surprenante exactitude anatomique.
Toutefois, la datation au carbone 14 a donné un âge variant entre 1260 et 1390. Ce qui correspond avec la date des premières mentions historiques du linceul à Lirey en 1355. Mais certains chercheurs pensent que le tissu aurait pu être contaminé, ce qui donnerait un âge trop récent. En effet, un incendie en 1532 a ravagé la sacristie de Chambéry dans laquelle il était conservé. Ce qui l'aurait enrichi en carbone 14. Des tests ont été effectués sur d'autres tissus de l'époque du Christ et auraient été “rajeunis” artificiellement. D'autres enfin prétendent que c'est l'énergie produite lors de la résurrection qui a faussé les données. On voit que la controverse à ce sujet est loin d'être terminée.

- Au jour le jour, avril 1999
Une bouffée d’air frais
Sous la présidence de M. Denis Senécal, directeur de la Caisse populaire de La Prairie, avait lieu le premier avril dernier, en présence de nombreuses personnalités de notre ville, le lancement de la Fondation de la Société historique de La Prairie.
En effet, considérant que l’action bénévole a ses limites et compte tenu du fait que les besoins matériels et les coûts administratifs d’une société aussi dynamique que la nôtre deviennent de plus en plus lourds. Et aussi parce que l’appui des différents niveaux de gouvernement est parfois incertain et n’arrive jamais à tout combler; un groupe d’individus convaincus, avec en tête de file M. Jean-Eudes Gagnon, a eu l’idée d’associer la Société à une Fondation afin de lui venir en aide.
Déjà deux activités de financement ont été choisies:
- Du homard à volonté le 4 juin prochain au Complexe Saint-Laurent. Activité organisée en collaboration avec «La Prairie en fête» et partage des profits à part égale entre les deux organismes. Billets disponibles à 40$ par personne.
- On prévoit pour l’automne prochain un «bouillon au maillé» selon la fameuse recette de M. Bernard Bonneterre.
En guise de mise de départ, la Fondation Guy Dupré remettra à la nouvelle Fondation un chèque de 3 000$ lors de son brunch annuel du 25 avril 1999.
Ainsi la Société historique, après 27 ans d’un travail assidu au service de la conservation du patrimoine de La Prairie, pourra enfin compter sur un appui financier permanent. N’est-ce pas là une forme de reconnaissance publique de la pérennité de notre organisme et de l’importance qu’il occupe dans notre société?
Composition du C.A. de la Fondation de la Société historique de La Prairie:
M. Denis Senécal, président
M. Claude Aubry, de la Résidence La Belle Époque
M. Charles Beaudry, de la SHLM
M. François Bourdon, avocat
M. Jean-Eudes Gagnon, conseiller municipal
M. Jean-Guy Guérard, agent immobilier
Mme Sylvie Lussier, auteure
M. Alfred Martin, du CIREM-HEC
M. Michel Sainte-Marie, Lithographie du Vieux La Prairie
M. Claude Taillefer, conseiller municipal

- Au jour le jour, mars 1999
Lettre à Monseigneur J. Octave Plessis (suite)
L’an dernier des Anglois pendant la messe de Minuit ne firent que tourner en voiture autour de l’Eglise pour troubler l’office, et il y a deux ans quelques filles, au retour de la messe furent insultées par des jeunes gens de Font-arabie ou prétendirent avoir été insultées par eux, et cela causa au procès, où deux familles ont été ruinées.
Le charivari n’étoit qu’un jeu d’enfans, disent-ils; et ils prétendent qu’il n’y a qu’un petit nombre qui y a pris part.—- Je connois 36 de ceux qui se sont masqués; dont 5 seulement sont protestans, je ne voudrois pas pourtant les nommer et le Sr Nolin me reprochoit qu’il y en auroit 60 qui pour cela ne feroient pas leurs pâques, qu’à ce nombre on ajoute ceux qui ne les faisoient pas auparavant et ceux qui n’ont pas encore l’âge de le faire; et on verra si mon calcul a été faux. je peux produire pour temoins les soldats Anglois qui sont cantonnés dans le Village—–au surplus, je craignois qu’ils ne fussent pas assez sensibles au châtiment, et heureusement,ils le sont assez—–les masques se conservoient pour d’autres occasions; et j’ai appris que les travestissements auroient déjà eu lieu dans des bals d’été dernier, et que tout cela avoit donné lieu à des horreurs comme votre Grandeur l’avoit conjecturé.
Je suis avec le plus profond respect,
Monseigneur,
de votre Grandeur
Le très humble et très obéissant serviteur
J.B. Boucher
ptre.
P.S. il est bien entendu qu’il y a toujours une exception à faire en faveur de plusieurs personnes tant du village que des campagnes.
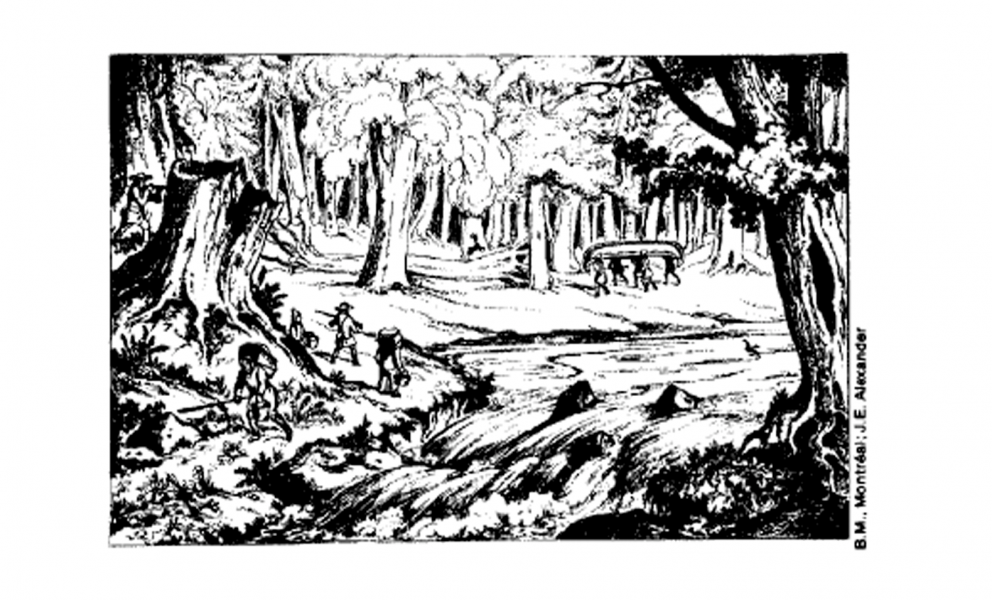
- Au jour le jour, mars 1999
Le chemin de Lanoullier (suite)
De nombreux travaux seront effectués à plusieurs reprises entre 1752 et 1760 pour consolider le chemin à l'aide de troncs d'arbres, mais toujours sans succès. On construisit un pont sur la rivière l'Acadie en 1756. Malgré cela, il fallut au début du mois de septembre de cette année deux jours aux soldats pour relier La Prairie à Saint-Jean. Au mois d'avril de 1757, les 500 soldats du régiment de La Sarre ne peuvent se rendre à Saint-Jean.
Puis en 1760, c'est la défaite. On abandonne le fort de l'Ile-aux-Noix et on brûle celui de Saint-Jean. Les soldats de Bougainville se réfugient dans des retranchements sur les bords de la rivière l'Acadie.
Après la conquête, les Britanniques établissent quelques campements militaires le long du chemin de Saint-Jean surtout lors des conflits avec les États-Unis. Par la suite, les premiers colons viendront s’établir le long de cette route. Un des premiers foyers de développement se situait à la rencontre de la rivière l'Acadie avec ladite route. A la fin du 18e siècle on y retrouve un hôtel et une nouvelle route longe la rivière. Plus tard des casernes seront construites à cet endroit (casernes de Blairfindie). Après la guerre de 1812, les liens économiques avec nos voisins du sud se raffermissent. Le chemin de Saint-Jean deviendra alors une des routes les plus importantes du Bas-Canada. L’ajout du premier chemin de fer le long de cet axe en 1836 viendra confirmer sa vocation commerciale. La Prairie se retrouvera au cœur de celui-ci. Elle fera la jonction entre le lien maritime qui rattache Montréal à la rive sud et le lien terrestre (voie carrossable et chemin de fer) menant vers les États-Unis en passant par le Richelieu. Cela favorisera le développement économique de La Prairie. De nombreux commerces reliés au transport et à la manutention verront alors le jour.
Malgré tout, ce n'est qu'en 1919 que le chemin deviendra carrossable en tout temps et en 1932 qu’une première couche d'asphalte sera posée. Aujourd’hui, il peut être difficile d’imaginer ce qu’a été le chemin de Saint-Jean à la belle époque. Et même si le tracé actuel est pratiquement le même que celui fait par Lanoullier au 18e siècle, peu de gens savent que nous avons une des voies carrossables les plus anciennes du Canada.
Image : Là où les chemins sont inexistants, pour passer d’un cours d’eau à l’autre le portage constitue une véritable hantise pour le voyageur. L’exercice requiert des efforts considérables.

- Au jour le jour, mars 1999
SHLM Nouvelles
Le courriel et la généalogie.
Les visiteurs sont nombreux à venir à notre local afin de consulter les volumes traitant de généalogie. Disponible cinq jours/semaine, de 9h. à 17 h., le personnel apporte l’aide sollicitée. Nous soulignons une autre forme de support que nous permet le courrier électronique en plus du courrier postal. Les demandes nous parviennent particulièrement des États-Unis. La Prairie et sa région ont été le lieu d’habitation de très nombreux pionniers venus de France. Les descendants ont essaimé dans plusieurs états américains et la recherche généalogique y connaît un grand essor. Mentionnons un exemple: M. Ken Eaton de Lakeside, Californie. Son ancêtre Clément Leriger, Sieur de Laplante est décédé à La Prairie le 7 décembre 1742. Trois personnes de sa famille ont fait le voyage jusqu’à La Prairie et sont venus au local de la SHLM pour ajouter à la documentation déjà recueillie sur l’ancêtre. Les échanges via Internet se poursuivent.
Dialogue avec l’histoire
Le projet Dialogue avec l’histoire va de l’avant!
Le projet éducatif Dialogue avec l’histoire continue sur sa lancée avec l’obtention d’une subvention de 6 263 $ provenant du Ministère de la Culture et des Communications ainsi que d’une contribution de 3 000 $ de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Ces sommes serviront à compléter le projet pilote de l’année dernière afin d’améliorer cette nouvelle méthode pédagogique mise au point par la Société historique de La Prairie en collaboration avec l’école secondaire La Magdeleine. Au mois de juin, nous aurons donc complété la partie expérimentale du projet. Par la suite, nous avons l’intention de l’appliquer à l’ensemble de toute la Commission scolaire et à moyen terme à l’ensemble du Québec.

- Au jour le jour, mars 1999
Conférence: Les troubles de 1837 et 1838
Prochaine conférence mercredi le 17 mars, 20h Les troubles de 1837 et 1838 à La Prairie
Par Gaétan Bourdages, enseignant
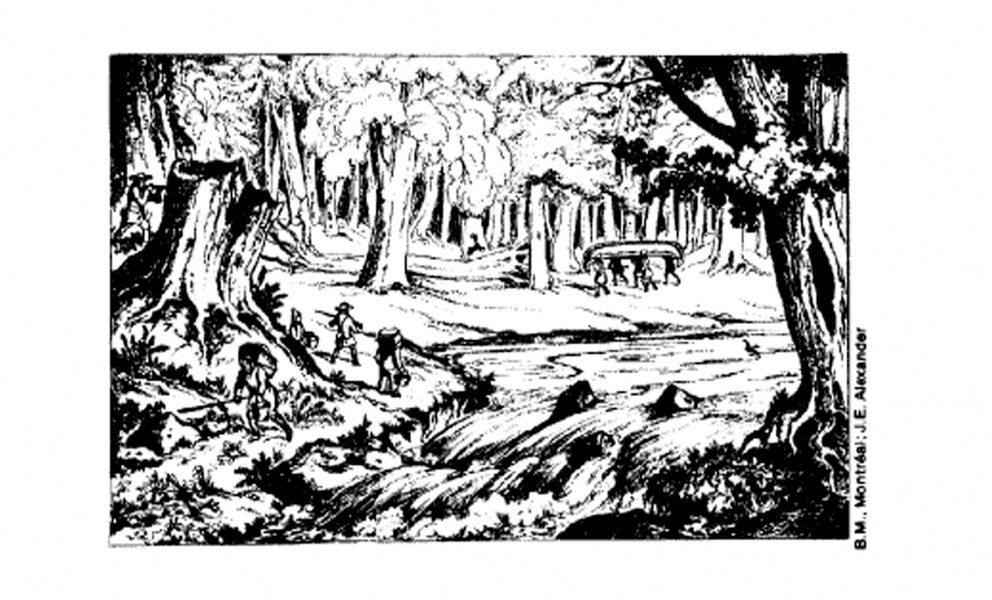
- Au jour le jour, mars 1999
Le chemin de Lanoullier
Avant la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent et des grands axes routiers modernes, La Prairie occupait une position stratégique sur la voie qui reliait Montréal aux États-Unis. En effet, lorsqu’on regarde une carte géographique, une évidence saute aux yeux. Le plus court chemin reliant Montréal à la rivière Richelieu passe par notre municipalité.
Avant même l’arrivée des premiers Européens en terre d’Amérique, un sentier existait déjà entre Kentaké (La Prairie) et la rivière des Iroquois (Richelieu). C'est le long de ce sentier qu'eut lieu en 1691 un combat entre les soldats britanniques du capitaine Schuyler et la petite troupe française commandée par M. de Valrenne. Le nom du rang de La Bataille rappelle cet événement. Au tout début de la colonie un tel sentier pouvait suffire. Cependant, dès le 18e siècle, la nécessité d'un lien rapide et efficace entre Montréal et la partie haute de la rivière Richelieu s'est fait sentir entre autres pour des besoins militaires et économiques. Auparavant, pour acheminer des troupes et du matériel vers le lac Champlain, il fallait descendre le fleuve jusqu'à Sorel, puis remonter le Richelieu jusqu'à Chambly pour se rendre par voie de terre jusqu'au fort Saint-Jean en passant par le fort Sainte-Thérèse. Ensuite, on reprenait le Richelieu. Cela exigeait, on s'en doute, beaucoup de temps et d'efforts.
Le ravitaillement des forts du Richelieu et surtout celui de Saint-Frédéric sur le lac Champlain, nécessita la construction d'un véritable chemin carrossable en 1739. Cette première route reliait La Prairie au fort Chambly. En 1748, on profite de la construction d'un nouveau fort à Saint-Jean pour relier ce dernier au chemin de 1739 en passant par la Savanne (Saint-Luc). Toutefois, cette section causera de nombreux problèmes pendant près de cent ans.À cette époque la majeure partie du territoire de Saint-Luc est constituée de terrains marécageux, ce qui ne constitue pas un endroit idéal pour la construction d'une route. Le grand voyer de la Nouvelle-France, Jean-Eustache Lanoullier, fait creuser à l'été de 1748 des fossés pour assécher le sol en déversant les eaux d'écoulement dans la petite rivière de Montréal (rivière l'Acadie) et dans celle des Iroquois. Toutefois, au printemps et à l'automne, suite à la fonte des neiges et les pluies abondantes, la terre redevient un véritable bourbier.
Image : Là où les chemins sont inexistants, pour passer d’un cours d’eau à l’autre le portage constitue une véritable hantise pour le voyageur. L’exercice requiert des efforts considérables.

