
- Au jour le jour, octobre 1999
Prochaine conférence: Le développement du Vieux La Prairie
Mercredi le 20 octobre à 20h
M. Bernard Morel, dir. adjoint au Service de Génie et d'Urbanisme à La Prairie.
Le développement du Vieux La Prairie.

- Au jour le jour, octobre 1999
Le pouvoir des femmes solidaires Hier-Demain
Colloque, 9 février 1999
Centre des femmes L’Éclaircie, La Prairie
Dans la région de La Prairie, les femmes ont développé la SOLIDARITÉ DU CŒUR dès le début de la colonie el de la fondation de La Prairie en 1667. Chacune a su regarder les BESOINS des autres femmes pour apporter son AIDE aux voisines et amies. Pendant près de 300 ans, les femmes vivaient en majorité sur des fermes et accouchaient en moyenne tous les 2 ans. Le médecin était rarement disponible et les sages-femmes avaient un grand territoire à desservir, les voisines devaient donc assister les futures mères.
La solidarité du cœur fait naître également des actions collectives.
Trois occasions qui en témoignent nous sont relatées dans les archives:
1ere 1714 – L'Évêque veut «rationaliser» le territoire d'une paroisse voisine et amputer des secteurs de cette paroisse «Son représentant qui vient enquêter est attaqué par une foule de femme qui menacent de le tuer et de jeter son cadavre dans le marécage.» Pour nos ancêtres, la paroisse fixe le sentiment d'appartenance à une communauté. (Allan Green, Brève histoire de la Nouvelle-France,) Boréal, p.51
2e 1728 – Solidarité économique, à La Prairie. Les femmes appréciaient le coton des Indes pour fabriquer des vêtements d'été. La France n'y gagnait pas financièrement. Ordre du Roi est donc donné à toute la colonie, défendant d'acheter de l'indienne. Le notaire Barette est chargé de lire cette ordonnance sur le parvis de l'église de La Prairie après la messe du dimanche. Plusieurs femmes sont mises au courant, s'assemblent à la porte de l'église et décident de saisir le notaire, de lui bander les yeux, sans violence. Elles lui arrachent le texte qu'elles déchirent en mille morceaux. (Louis Lavallée, La Prairie en Nouvelle-France, McGill-Queen's University Press, p.161
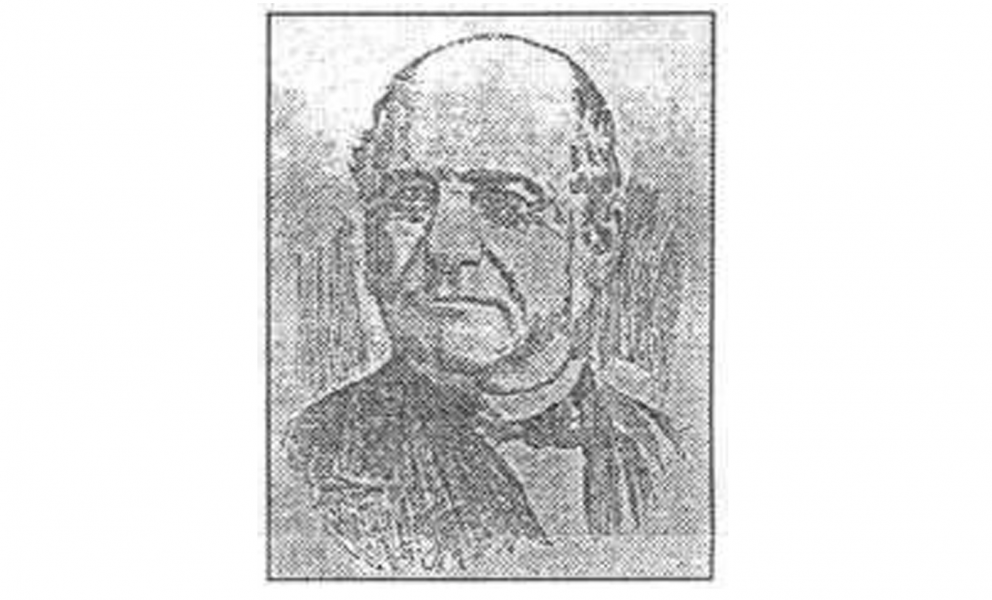
- Au jour le jour, septembre 1999
Jean-Baptiste Varin (1812-1899) Un personnage d’envergure nationale (suite)
Celui-ci lui confie le poste d’agent de la Seigneurie de La Prairie, qu’il occupera pendant 50 ans. L'essentiel de sa tâche consiste à collecter leur dû auprès des censitaires. Les sommes recueillies sont versées au trésor public et distribuées pour l'éducation au Bas-Canada. Les Jésuites conservent cependant leurs droits de propriété reconnus inaliénables en droit international.
Varin, député, prépare un projet de loi pour l'abolition de la tenure seigneuriale à la demande de Georges-Étienne Cartier. Cette loi est votée par le parlement en 1854. Cartier fonde le bureau du cadastre en 1864, Varin y siège à titre de principal responsable. Ce registre public définit la surface d'un terrain et la valeur des biens immobiliers qu'on y retrouve. L'inscription au cadastre permet au gouvernement d’établir l’impôt foncier. Un véritable système municipal avait déjà été créé en 1850.
Le cadastre de 1867, dont La Prairie a été doté, est encore en vigueur aujourd'hui en l'an 2000. Une mise à jour a été entreprise par le gouvernement provincial. La Prairie sera particulièrement touchée, puisque de nombreuses terres agricoles ont été loties pour la construction résidentielle. Bien plus dans les années 1950, des villes nouvelles, Brossard et Candiac, ont été créées à même des terres agricoles.
Lorsque la fabrication du cadastre est terminée, Varin occupe différents postes de commissaire au gouvernement. Avec ses collaborateurs, il élabore un règlement régissant la question des Lotis et ventes, droits autrefois dévolus aux seigneurs.
Jean-Baptiste Varin décède en 1899 à l'âge de 87 ans. Pendant sa vie, il a rempli des tâches importantes. Sa compétence et la qualité de son travail lui ont valu la confiance des hommes politiques qui ont fait appel à ses services.


- Au jour le jour, septembre 1999
Les Desmidiées de La Prairie (suite)
En plus de l’étude systématique et descriptive des Desmidiées présentes dans les tourbières, le Frère Irénée-Marie se penchât sur le problème de leur dispersion. Il essaya d’examiner toutes les possibilités de transport de cette flore minuscule. Ainsi, il planta à plusieurs endroits des perches portant une tablette sur laquelle était posée une assiette remplie d’eau filtrée. Celles-ci recueillaient tous les débris minéraux et organiques apportés par le vent. Les animaux fréquentant ces milieux ont aussi été examinés. Le fusil et les pièges faisaient donc partie de l’équipement du Frère Irénée-Marie. Il releva la présence de 13 espèces d’oiseaux aquatiques, dont les plus communs étaient les canards, les hérons, les bécassines, les martins-pêcheurs, les pluviers et les mouettes. Il a pu constater que ceux-ci étaient d’importants colporteurs de Desmidiées qui se retrouvaient sur leur patte ou dans leur plumage. De nombreux animaux à fourrure (7 espèces identifiées) jouaient le même rôle. Parmi les autres animaux assurant la dispersion des Desmidiées, on retrouve les grenouilles, les crapauds, les tortues et les couleuvres. De plus, lors des crues du printemps et de l’automne, les poissons peuvent passer d’une mare à l’autre, transportant sous leurs écailles de nombreuses algues. L’étude révéla aussi l’importance des insectes dans ce domaine. Les plus fréquents étant les libellules, les nèpes, les notonectes, les gyrins et les hydromètres.
Après la cueillette venait ensuite le nettoyage et la préparation des échantillons, l’identification des différentes espèces et leur dessin. Pour mener à bien la tâche d’identification, le Frère Marie Victorin, mis à la disposition du Frère Irénée-Marie la bibliothèque de l’Institut Botanique de l’Université de Montréal. Des milliers d’heures de laboratoire allaient révéler la richesse des tourbières de notre région. En effet, 527 espèces furent identifiées, dont 357 nouvelles pour la province de Québec et 48 inconnues jusqu’alors. Le Frère Irénée-Marie déclare même que le Québec se place parmi les contrées les plus riches en Desmidiées. Ces petites algues s’inscrivent dans la longue chaîne alimentaire qui sert à nourrir de nombreuses espèces de poissons, de batraciens, de mammifères et d’oiseaux. Une fois asséchées, les tourbières fournissent un sol très riche pour la production maraîchère. Le Frère Irénée-Marie souligne même que les compagnies de chemin de fer se servaient de la tourbe pour chauffer les locomotives au 19e siècle avant l’exploitation des mines de charbon des Maritimes.
À notre époque, où nous prenons de plus en plus conscience de l’importance et du rôle que jouent les milieux humides dans l’écologie de notre planète, nous pouvons dire que le travail du Frère Irénée-Marie nous a révélé l’importance de ces milieux. Souhaitons que nous saurons préserver ce qui nous reste de cette richesse.
Cet article résume le travail du Frère Irénée-Marie, qui a publié le résultat de ses travaux dans le livre : «Flore desmidiale de la région de Montréal». La Bibliothèque de la Société historique de La Prairie possède un exemplaire de cet ouvrage publié à La Prairie en 1939. Vous pouvez venir le consulter.

- Au jour le jour, septembre 1999
Liste des conférenciers pour la saison 1999-2000
20 octobre 1999
Bernard Morel, directeur adjoint du Service de Génie et Urbanisme de la Ville de La Prairie.
Sujet : Projet et réalisation du comité de Développement du Vieux La Prairie.
17 novembre 1999
Marc Lefebvre, conseiller en relations industrielles.
Sujet : Châteauguay, au temps des Lemoyne.
19 janvier 2000
Linda Gray, docteur en histoire.
Sujet : La Prairie, carrefour 1667 – 1720.
16 février 2000
À déterminer…
Sujet : Archéologie.
15 mars 2000
François Lafrenière, recherchiste en histoire, patrimoine et généalogie.
Sujet : Le curé Boucher dit Belleville et la Guerre de 1812.

- Au jour le jour, septembre 1999
Fête des Perras
Une «Fête des Perras» se tiendra pour le 350e anniversaire de l’arrivée de l’ancêtre. Si intéressé, contacter Pierre Perras au 450-923-1223.

- Au jour le jour, septembre 1999
Sur les traces du premier chemin de fer
Deux citoyens de La Prairie, messieurs Robert Mailhot et Gilles Desmeules, proposent la création d’une nouvelles piste cyclable reliant les villes de La Prairie et de St-Jean. Une telle réalisation aurait pour effet de souder ensemble deux réseaux cyclables déjà existants ; à savoir celui de l’Estrie (Granby, Farnham, etc.) et celui de la rive-sud de Montréal, qui s’étend de la Côte Ste-Catherine jusqu’à Boucherville. D’ailleurs, il est déjà possible d’atteindre Montréal en vélo depuis la rive-sud.
La piste cyclable proposée longerait sur une partie de sa course le tracé du premier chemin de fer canadien établi en juillet 1836 entre La Prairie et St-Jean. Voilà donc une occasion unique de mettre en valeur l’histoire locale et nationale. De plus, ce lien cyclable attirerait des centaines de nouveaux visiteurs dans le Vieux La Prairie : un apport touristique à ne pas dédaigner.

- Au jour le jour, septembre 1999
La fabuleuse histoire de l’Humanité
La Société historique de La Prairie vous propose un voyage de plus de 5 millions d’années, des débuts de l’histoire de l’humanité en passant par les grandes étapes de son évolution : les premiers hominidés, l’apparition du langage, la découverte du feu, les débuts de l’agriculture, les premières cités et les premiers états. C’est une des plus passionnantes histoires, la nôtre, qui vous sera racontée par l’archéologue Charles Beaudry tous les mardi soir du 5 octobre au 16 novembre 1999.
Pour s’inscrire, il suffit de faire parvenir d’ici le vendredi premier octobre son nom, son adresse et son numéro de téléphone avec un chèque au nom de la Société historique de La Prairie à l’adresse suivante : 249, rue Sainte-Marie, C.P. 25005 La Citière, La Prairie, (Qué.) J5R 5H4
Le coût est de $35,00 pour les membres de la Société historique et de $40,00 pour les non-membres.
On peut aussi s’inscrire en se présentant au local de la Société.

- Au jour le jour, septembre 1999
Nouveau site internet
La Société historique de La Prairie a complètement remis à jour son site Internet. Nous avons maintenant une version anglaise afin de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses venant des États-Unis et des autres provinces canadiennes. D'une présentation agréable avec de nouvelles sections, nous pouvons être fiers de cette réalisation. Il faut souligner l'apport des employés subventionnés et des nombreux bénévoles qui ont œuvré pour rendre notre site de plus en plus beau et instructif.
Notons en passant le travail créatif de l'infographiste Liette Provost.
Vous êtes donc invités membres et amis de la Société à venir à l'inauguration officielle de notre nouveau site le mercredi 15 septembre prochain à 20h00. Nous vous parlerons aussi de nos divers outils informatiques servant à la recherche historique et généalogique. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.

- Au jour le jour, septembre 1999
Appel à tous !
Besoin urgent de collaborateurs bénévoles… (voir l’article à l’intérieur)
Un appel à l’aide !
La Société historique de La Prairie subit actuellement les impacts des nombreuses compressions budgétaires provenant des instances gouvernementales, ce qui entraîne une réduction importante du personnel nécessaire à la poursuite de ses activités.
Par conséquent, la Société historique sollicite la collaboration de tous ses membres. Elle a présentement besoin de personnes intéressées à donner quelques heures par semaine pour effectuer diverses tâches telles que: faire des recherches généalogiques ou historiques, entrer des données à l'informatique (à la maison ou au local), classer des documents, accueillir des visiteurs, etc …
Votre disponibilité ou celle de vos amis(es) serait grandement appréciée. Pour plus d'information, contacter le 659-1393.

