
- Au jour le jour, juin 2019
Nouveaux membres au conseil d’administration
Afin d’assurer le bon fonctionnement de notre société d’histoire, les règlements généraux prévoient la tenue d’une assemblée générale au moins une fois l’an et ce dans les trois mois qui suivent la fin de l’année financière.
Lorsqu’il y a vacance au sein du conseil d’administration suite à la démission d’un des membres, les règlements prévoient que le C.A. coopte un remplaçant par intérim qui demeure en fonction pour le reste du mandat. Sa nominationdevra plus tard être entérinée par la prochaine assemblée générale.
Les membres du C.A. sont élus pour un mandat d’une durée de deux ans. Trois membres sont élus lors des années paires et les deux autres membres sont en élection l’année suivante.
Au cours de la première réunion du conseil nouvellement élu, les administrateurs s’entendent pour désigner qui occupera chacun des postes prévus au C.A.
Ainsi donc, suite aux élections tenues lors de l’assemblée générale annuelle du 19 mars et de la réunion des membres du C.A. du 11 avril dernier, voici la composition du conseil d’administration de la SHLM pour l’année 2019/2020. Dans l’ordre habituel (de gauche à droite):

M. Stéphane Tremblay (président),

M. Gilles Blanchard (1er vice-président),

M. Jean-Pierre Labelle (trésorier),

M. Antoine Simonato (secrétaire)

et M. Samuel Castonguay (2e vice-président).

- Au jour le jour, juin 2019
Lancement du livre sur les Filles du Roy
C’est le 9 juin dernier qu’avait lieu au complexe multifonctionnel Guy-Dupré de La Prairie, le lancement de la plus récente publication de la Société d’histoire des Filles du Roy (SHFR) intitulé Les Filles du Roy–Pionnières de la Seigneurie de La Prairie (Éditions du Septentrion).
Dans cet ouvrage de plus de 570 pages illustré avec talent, le chapitre intitulé « La Prairie au temps des Filles du Roy (1667-1732) » est dû au travail de l’historien Gaétan Bourdages, un membre de longue date de la SHLM. Ce dernier, invité d’honneur du lancement, a donné une brève conférence sur l ’évolution du territoire de l’ancienne seigneurie de La Prairie. Ensuite, 18 membres «jumelées» de la SHFR (chacune représentant l’une des 18 Filles du Roy de La Prairie) nous ont offert une série de saynètes illustrant leur vie en Nouvelle-France à la fin du XVIIe siècle.
Il a fallu aux nombreuses collaboratrices plus de deux années de recherches et de travail avant de concrétiserce qui n’était au départ qu’une proposition sans prétention.
À l’automne 2017, à l’occasion du lancement du livre de Stéphane Tremblay (président de la SHLM) sur les familles pionnières de La Prairie, deux membres de la SHLM, mesdames Solange Lamarche et Manon Thibert, ont suggéré à la SHFR de produire un ouvrage historique sur les Filles du Roy qui s’étaient établies dans la seigneurie de La Prairie.
Cette suggestion n’allait pas rester lettre morte. Au début de l’année 2018, un groupe de travail dirigé par Michelle Desfonds et Marie Royal voyait le jour. Lors de la phase «recherche historique», le groupe de travail de la SHFR a été épaulé par le comité de paléographie de la SHLM, dirigé par Lina Chopin. En plus de madame Chopin, Jocelyne Brossard, Yvon Hébert, Solange Lamarche, Marie-Josée Macchabée, Francine Saint-Onge et Lisette Tétreault ont oeuvré à transcrire près de 50 actes notariés dont certains sont en lien avec les concessions qu’ont reçues des Jésuites les époux des Filles du Roy.
Bref, un ouvrage très intéressant que tout amateur de généalogie ou d’histoire devrait se procurer. Le livre est disponible à nos locaux au prix de 40 $.
De plus, la SHFR et le Collectif Prism’Art de La Prairie, ont conçu et bâti l’exposition intitulée « La vie des Filles du Roy au quotidien ». Cette exposition a été inaugurée le 7 juin dernier et sera en visite libre dans les locaux de la SHLM jusqu’au 30 septembre.
Nous invitons également le public, tous les jeudis de l’été en après-midi, à participer à un atelier d’animation intitulé « À la rencontre d’une Fille du Roy ».
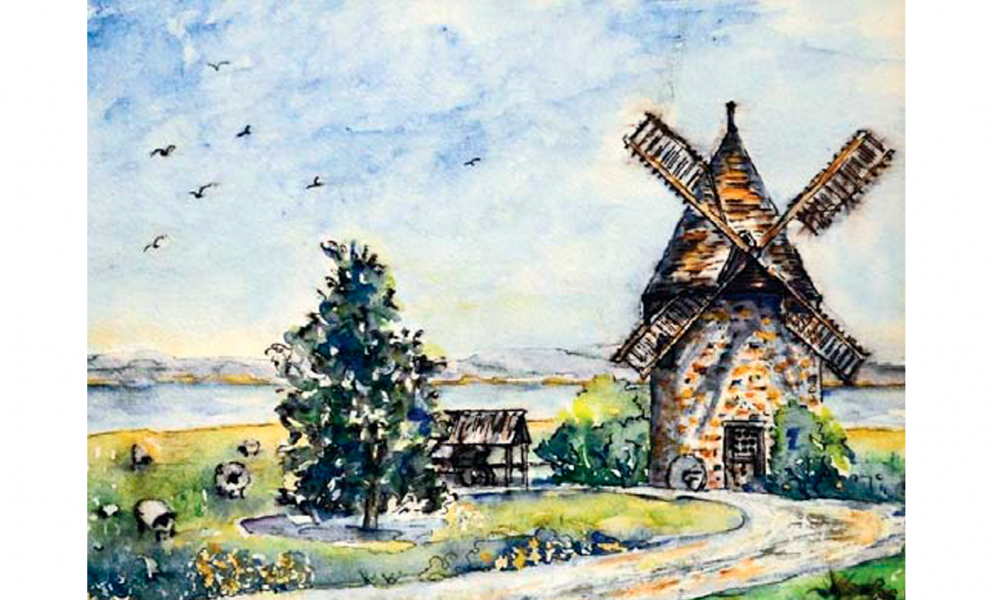
- Au jour le jour, juin 2019
Le collectif Prism’art expose
Le regroupement d’artistes peintres Prism’Art a été créé en juillet 2010. Il est né d’un désir de réunir des artistes peintres professionnels et non-professionnels de La Prairie et des environs qui souhaitent se rassembler pour promouvoir leurs activités.
En 2017, les artistes du Collectif Prism'Art ont mis leurs talents artistiques à contribution en créant des toiles originales illustrant des scènes de la vie au début de la colonie. Ces tableaux furent créés sur demande afin d’illustrer le premier tome du livre de Stéphane Tremblay intitulé « Les familles pionnières de la seigneurie de La Prairie de 1667 à 1687 ». Ces oeuvres seront exposées tout l'été dans les locaux de la Société d'Histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

- Au jour le jour, juin 2019
La vie au quotidien des Filles du Roy (1663-1673)
L’exposition estivale de 2019 vous invite à plonger dans l’histoire des Filles du Roy au quotidien afin de retrouver la fierté d’être ou de connaître leurs descendances.
Du 7 juin au 30 septembre 2019, dans les locaux de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine au 249, rue Sainte-Marie à La Prairie, découvrez ces femmes tout aussi courageuses qu’audacieuses qui ont contribué à nous «mettre au monde».
Cette exposition, qui présente à l’aide de documents transcrits, d’illustrations, et de reconstitutions miniaturisées, leur vie quotidienne, souhaite vous faire découvrir les savoir-faire de ces pionnières, qui se devaient de connaître: «quelques industries pour les ouvrages de la main..» selon les critères de recrutement établis par l’intendant Talon.
Votre ancêtre était-elle: meunière, boulangère, bouchère et savait-elle semer, récolter, transformer, conserver? Elle savait sûrement faire de la corde avec sa lucette (illustration ci-jointe) et rapidement manier le rouet pour y filer son lin. Elle savait sûrement «tirer de l’aiguille», faire son savon, ses chandelles, ses paillasses. Mais elle a surtout bien exécuté le mandat reçu, à savoir donner naissance, nourrir, soigner et défendre ses enfants et leur apprendre l’essentiel.

- Au jour le jour, juin 2019
Activités de l’été 2019
Visites guidées du Vieux La Prairie
Visitez le périmètre de l’ancien fort, l’église et la crypte. 5$ par adulte et 3 $ par enfant. Visites guidées à 10 h, 13 h et 15 h
Généalogie
Retracez vos ancêtres à l’aide de répertoires et de banques de données informatisés. Frais de recherche: 5$ pour une demi-journée, gratuit pour nos membres.
Le Collectif Prism'Art
Exposition de toiles originales illustrant des scènes de la vie du début de la colonisation.

- Au jour le jour, avril 2019
Déjeuner annuel des bénévoles
Afin de souligner l’édition 2019 de la Semaine de l’action bénévole au Québec (du 7 au 13 avril), la SHLM a remercié ses bénévoles en leur offrant le petit déjeuner, dimanche le 14 avril dernier, au restaurant Paolo Gattuso de La Prairie. Près de vingt convives ont ainsi pu se réunir dans une ambiance décontractée afin d’échanger sur les réalisations de la dernière année et sur les défis à venir au cours des prochains mois. Notons la présence, à ce petit déjeuner, de Madame Johanne Doyle et de son conjoint Monsieur Yvon Doyle.
Tous les bénévoles présents étaient heureux de revoir notre coordonnatrice et de prendre de ses nouvelles. La SHLM avait également invité ses deux nouvelles employées, Mesdames Lucie Filion et Marceline Moreau, contractuelles à la coordination et à la tenue des livres comptables, afin qu’elles puissent rencontrer les bénévoles et échanger avec eux. La SHLM tient à remercier tous ses bénévoles pour leur implication dans les différents comités et projets qui animent notre organisme depuis maintenant plus de 47 ans.

- Au jour le jour, avril 2019
Conférence: Histoire de l’Acadie, de la fondation aux déportations
Pour découvrir ou redécouvrir cette histoire… Un survol des premières tentatives de colonisation et de la fondation de la première capitale acadienne vous sera présenté. Par la suite, vous serez amenés dans le tumulte du développement de la colonie acadienne et de ses occupations britanniques. Pour terminer, nous vous proposerons un survol de la déportation des Acadiens et des francophones des diverses colonies des Maritimes.
Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont habituellement lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie.
Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, avril 2019
Entre rêve et réalité
Les propositions qui suivent sont tirées des procès-verbaux du conseil municipal de La Prairie.
Novembre 1887: une compagnie de téléphone est prête à établir un bureau à La Prairie à condition d’être exemptée de payer la taxe commerciale. Le téléphone était déjà installé chez le marchand général Hyacinthe Sylvestre depuis mars 1883.
Février 1888: projet d’installation d’une conserverie de viandes, de fruits et de légumes qui emploierait une cinquantaine de personnes.
Août 1923: le conseil discute de l’installation probable sur le rue Sainte-Rose de la cie de de construction automobile Anglo American Motors Limited.
Décembre 1927: lettre à la Wright Aircraft Co. lui offrant terrain, eau et électricité pour l’établissement de leur manufacture d’aéroplanes.
Juin 1927 : les membres du conseil discutent de l’établissement d’une école d’aviation et d’une base aérienne
Septembre 1928: lettre à la General Motors pour lui offrir d’installer à La Prairie son usine de fabrication ou d’assemblage automobile.
Octobre 1929 : Suite à ces projets sans suite, la terreur envahit les marchés boursiers de l’Amérique du Nord. C’est le début de la grande crise économique qui frappe durement La Prairie.

- Au jour le jour, avril 2019
Les officiers des troupes de la Marine à La Prairie en 1691
En 2017 une importante consultation de documents d'archives en France et au Québec a permis au généalogiste émérite Marcel Fournier et à ses collègues de réaliser une forme de dictionnaire inédit intitulé «Les troupes de la Marine au Canada entre 1683 et 1760» dans lequel livre nous retrouvons également un index des noms de tous les 889 officiers de la Marine qui ont servi au Canada pendant cette période.
Cette recherche est une invitation à enrichir nos connaissancesEn 2009 dans «1691 – La Bataille de La Prairie» les auteurs affirmaient (p.131): «Nous savons également peu de choses sur les miliciens et sur les compagnies Franches de la Marine engagés dans ces combats». sur la présence et le nombre exacte d'officiers des compagnies franches de la Marine au Canada lors de la guerre Franco-Iroquoise et surtout au moment de la grande opération militaire qui eut lieu durant l'été de l'année 1691.
L’analyse rétrospective de cet index nous permet de savoir avec certitude qu'il y avait 168 officiers de la Marine présent au Canada en 1691. Le décompte des grades est le suivant: 30 capitaines, 16 capitaines réformés, 35 lieutenants, 27 lieutenants réformés, 35 enseignes, 9 enseignes réformés ainsi que 16 cadets. De ces 168 officiers de la Marine, 115 sont d'origine française et 53 sont canadiens.Ce total de 168 officiers de la Marine est exactement le double de l'estimé établi par René Chartrand dans: Le Patrimoine Militaire Canadien, Tome I, 1000 – 1754, Montréal, Art Global,1993, page 111.
Donc, un total de 168 officiers pour seulement 28 compagnies présentes dans la colonie, soit 6 officiers par compagnie. Si nous excluons de ce nombre les officiers d'État-Major et de la garde personnelle des trois gouverneurs présents en Nouvelle-France; soit à Québec, Trois-Rivières et Montréal, il restait environ 5 officiers pour chaque compagnie. Il est important de souligner que cette situation de surplus d'effectifs militaires avec expérience de combat représentait un très grand avantage en temps de guerre.

Une compagnie de la Marine était normalement composée d’un maximum de cinquante hommes incluant un capitaine, un lieutenant ainsi qu’un enseigne. En 1691, suite à plusieurs années de petite guerre, il ne restait au Canada que plus ou moins 1100 soldats de la Marine en plus de leurs officiers, soit des formations réduites à un nombre de 42 à 43 hommes en moyenne par compagnie.
Louis-Hector de Callières, le gouverneur militaire de Montréal, ainsi que le baron de LaHontan nous confirmaient qu'il y avait 15 compagnies à La Prairie le matin du 10 août 1691 et donc de conclure qu'il y avait aussi 75 à 80 officiers présents. Suite au départ du bataillon du commandant de Valrennes, pour se rendre au fort Chambly, il restait toujours 11 compagnies à La Prairie avec environ 55 à 60 officiers.
Tôt le matin du 11 août, après l'escarmouche qui eut lieu devant le fort La Prairie, c'est bien le feu et les nombreuses embuscades de l'ennemi le long du sentier menant vers le fort Chambly qui expliqueraient la poursuite inefficace de la part de l'armée française. En effet Pieter Schuyler, le commandant des envahisseurs newyorkais, avait donné ordre à son arrière-garde de mettre le feu dans les champs de blé de La Prairie «burning their corne and hay» et tout au long du sentier lors de la retraite de son armée. Cette action eut l'avantage d'empêcher l'anéantissement complet de son armée newyorkaise par les troupes françaises qui, elles, tentaient d'appliquer la stratégie militaire énoncée par Callières, à savoir, «mettre l'ennemi entre deux afin qu'ils ne nous eschapassent pas».
Une fois arrivé à la traverse de la petite rivière Mont-Royal (l’Acadie) «à mi-chemin» entre les deux forts de La Prairie et de Chambly, Schuyler affirmait dans son Journal qu'il faisait face à un bataillon composé d'environ 300 soldats français ainsi qu'une quarantaine de leurs alliés. Cette troupe composée de 6 compagnies de la Marine et d'une compagnie de miliciens canadiens avait environ 35 à 40 officiers à sa têteLes six compagnies de la Marine avaient pour capitaines plusieurs hommes ayant combattus en Europe dans la grande armée du Général Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. Il s'agit des capitaines, Philippe Clément sieur du Vuault et de Valrennes, 47 ans; monsieur le Marquis Antoine de Crisafi-Grimaldi, 39 ans; son jeune frère, le Chevalier de Malte monsieur Thomas de Crisafi-Grimaldi, 25 ans; monsieur Nicolas Daneau de Muy, 40 ans; monsieur Claude Guillouet d'Orvilliers, 33 ans; monsieur le capitaine et Major des troupes Joseph de Monic, 35 ans. Se rajoutant à ceux-ci, le jeune capitaine de la milice de Montréal le sieur Vincent LeBer du Chesne, âgé de 24 ans.. De ces chiffres il faut retenir a posteriori que la mort de 3 ou 4 jeunes officiers et de quelques soldats lors des durs combats qui ont suivi ne pouvait être considérée comme une lourde perte militaire pour les forces françaises.
Par contre, dans une lettre écrite 3 jours après la bataille, le gouverneur Frontenac nous résume les faits au sujet de la victoire française et des lourdes pertes de l'ennemi: «après un combat qui dura près d'une heure et demie…le Sieur de Valrennes les fit plier et les mit entièrement en déroute, leur ayant tué plus de six-vingt (120) hommes sur la place parmi lesquels il y avait cinq ou six de leurs principaux chefs tant Anglais que SauvagesSelon Charles de Monseignat, premier secrétaire de Frontenac, sur le champ de bataille le grand Sachem du nom de « Onnonragewas » avait été une des nombreuses victimes du côté des envahisseurs. Également connu sous le nom de «Janetje» par les Hollandais et de «Lawrence» par les Anglais, Onnonragewas avait été qualifié de «bel entremetteur» ou fourbe par les Français car il avait passé l’automne et l’hiver précédents à Montréal, à négocier pour la paix avec le gouverneur Callières. Il avait quitté Montréal au printemps 1691 ayant pris l’engagement d’y revenir avec les membres de sa famille et de son clan pour s’établir au «Sault» avec les Agniers chrétiens. En fait, comme Callières s’en doutait, Onnonragewas n’était là qu’afin de mieux espionner pour le compte de ses alliés et fournisseurs d’Albany. , blessé un bien plus grand nombre, pris leurs drapeaux et fait quelques prisonniers ».
Lors de ces événements Monsieur le comte de Frontenac était aux Trois-Rivières avec son État-Major ainsi que le commandant des troupes de la Marine en Nouvelle-France, le colonel Philippe Rigaud de Vaudreuil. Et, suite aux rapports qu'on lui fit, il nous confirmait également dans sa lettre du 14 août les pertes françaises pour toute cette journée: «Nous y avons perdu, de notre côté, 7 ou 8 officiers des plus braves et trente ou quarante soldats et habitants sans quelques blessés».

Rétrospectivement, il serait illogique de croire, comme l'ont fait plusieurs historiens canadiens, que la perte de 4 des 55 à 60 officiersLes quatre officiers décédés suite aux affrontements malheureux du 11 août, 1691 devant le fort La Prairie sont: le capitaine Pierre d’Escayracde l’Autheur et de Reau, 24 ans; le capitaine réformé le sieur d’Hosta, 29 ans; le lieutenant réformé le sieur Domergue de Saint-Médard, 28 ans; et enfin le dénommé «Saint-Cirque» qui est plutôt le capitaine Jean-Louis Jadon de Cirgues et de Malmort âgé de 43 ans. présents au fort La Prairie le matin du 11 août 1691 avait été catastrophique pour l'armée française. La même conclusion s'imposerait pour la perte des 4 officiersLes quatre officiers décédés suite à la grande bataille du 11 août, 1691 à «mi-chemin» entre le fort Chambly et La Prairie sont:le lieutenant réformé Maurice Le Varlet de Saint-Maurice, 26 ans; le cadet Jean-Baptiste Denys de La Bruyère, 22 ans (filleul du comte de Frontenac); le lieutenant de la compagnie de Valrennes, Monsieur Antoine d’Aubusson du Verger-Dumas-Dupuys, 27 ans (beau-frère de Madeleine de Verchères); ainsi que le capitaine de la milice de Montréal, le sieur Vincent LeBer du Chesneâgé de 24 ans (frère de Jeanne LeBer, première recluse d’Amérique du Nord). sur un total de 35 à 40 officiers présents lors de la grande bataille qui suivi à «mi-chemin entre les deux forts».
Monsieur de Callières, le grand stratège de cette opération d'encerclement de l'ennemiLe roi Louis XIV avait créé au mois d’avril 1693 «l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis» dans le but de récompenser les officiers les plus valeureux de son royaume. En Nouvelle-France, dès l’automne de cette année 1693, le premier sujet du roi à recevoir ce grand honneur a été nul autre que Louis-Hector de Callières. Ceci, afin de souligner sa contribution stratégique, facteur clé de la victoire décisive des troupes françaises lors des opérations militaires dans la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine, le 11 août 1691., avait encore à sa disposition un très grand nombre d'officiers aguerris ayant l’expérience de combat sur les champs de batailles européens, capables d'assumer le commandement des troupes et de les mener à la victoire … tel que nous le confirment ces nouvelles recherches sous la direction de Marcel Fournier.
NB: Kahnawake, le grand village du «Sault» récemment palissadé par les alliés Agniers était situé à 6 km au nord-ouest du fort de La Prairie. Suite à la mort tragique du Grand Agnier «Togouirout » en 1690 ce village fut par la suite, en 1691, commandé par «Tatakwiséré » le plus grand de ses capitaines de guerre. Afin d'en assurer la sécurité et surtout pour empêcher le va-et-vient d'espions ou de certains Agniers sympathiques aux Mohawks, M. de Callières y avait posté une demi-compagnie de soldats avec de jeunes officiers canadiens de la Marine. Cette troupe était commandée par le lieutenant Nicolas d'Ailleboust de Manthet (28 ans) qui, accompagné de ces mêmes Agniers, avait aussi commandé l'expédition punitive de l'année précédente sur Schenectady, N.Y. L'enseigne Augustin Le Gardeur de Repentigny (28 ans), cousin de Nicolas, était également présent en plus d'un autre enseigne de la région de Montréal, Zacharie Robutel de LaNoue (26 ans).
Jean-François Lozier – Université d'Ottawa: Flesh Reborn … The Saint-Lawrence Valley Mission Settlements through the Seventeenth Century. – McGill-Queen's University Press -2018

- Au jour le jour, avril 2019
Mille fois merci !
Le bulletin Au jour le jour a, depuis sa naissance, toujours été pour notre organisme un instrument incontournable de diffusion.
Avec le temps, cette publication s’est également imposée comme un dénominateur commun ralliant tous les membres de la SHLM.
De facture modeste et imprimé en noir et blanc durant plus de 15 ans, notre bulletin a connu un nouvel essor en octobre 2008 avec la contribution de M. François-Bernard Tremblay, un infographiste professionnel.
Président de l’entreprise Bonmelon depuis 2006, celui qui se définit comme un designer graphiste, allait durant près de 11 ans assurer bénévolement la mise en page couleur de pas moins de 105 numéros du Au jour le jour. Ce travail représente un apport inesti-mable.
De plus en plus accaparé par l’essor de son entreprise de communication, François-Bernard se voit maintenant obligé de passer la main. Pour tout ce travail de l’ombre, nous lui disons mille fois merci.
Stéphane Tremblay et Gaétan Bourdages

