
- Au jour le jour, février 1997
Généalogie de la famille Desrosiers
La présence de l’ancêtre Antoine Desrosiers (1616-1691) en Nouvelle-France est attestée dès janvier 1642 alors qu’il agit comme parrain d’un amérindien à Sillery. On ne connaît pas ses parents mais lors de son mariage, il se dit «natif du bourg de Renaison au pays de Lyonnais».
Le Journal des Jésuites mentionne, en 1645, qu’Antoine est à l’emploi de ces missionnaires comme engagé et, qu’à ce titre, il reçoit un salaire annuel de 100 livres. Dans le cadre de cet engagement, Antoine participe à l’approvisionnement de la mission de Sainte-Marie-aux-Hurons sur les bords de la baie Georgienne. Le travail n’était pas sans danger et il aurait pu y laisser sa peau. En effet, le 16 août 1659, il est écrit dans le Journal des Jésuites que «Antoine des Rosiers s’était sauvé des mains des Onontageronons vers le lac Ontario et qu’il était arrivé aux Trois-Rivières.»
C’est aux Trois-Rivières qu’Antoine Desrosiers fonde sa famille, alors qu’il épouse le 24 novembre 1647 Anne Du Hérisson, fille de Michel Leneuf du Hérisson, un important et influent personnage arrivé depuis 1636. Anne est bien dotée par son père qui s’adonnait à la lucrative traite des fourrures. Elle apporte au ménage 500 livres, deux «honnêtes» habits, de la lingerie, de la vaisselle ainsi qu’une génisse et une truie en gestation. Après une première installation du couple sur une terre louée, Antoine bénéficie, le 28 octobre 1649, de la part du gouverneur d’Ailleboust, de la concession d’une terre de 20 arpents sur les bords de la rivière Saint-Maurice, à l’extérieur du bourg. En 1650, on lui octroie un emplacement dans le bourg même. En 1657, cette fois du gouverneur Pierre Boucher, Antoine reçoit une autre terre d’une superficie de 25 arpents, là où naîtra le village de la Pointe-du-Lac.
Le couple Antoine Desrosiers et Anne du Hérisson aura huit enfants, cinq garçons et trois filles. Quatre des garçons fondèrent des foyers dont Jean qui, en 1682, unit sa destinée à Marie-Françoise Dandonneau. Ils eurent dix enfants dont six fils. Des quatre fils de Jean et de Marie-Françoise qui fonderont des foyers, Michel, qui épousera Anne Moreau le 29 mai 1716 à Rimouski, est l’ancêtre de Arthur et Léandre Desrosiers qui, de la région du Bas-du-Fleuve vinrent s’établir à La Prairie à la fin du siècle dernier.
Antoine Desrosiers est décédé à Champlain en 1691. Son épouse, Anne du Hérisson, mourut en 1711.
Arthur Desrosiers, en 1895, n’ayant pu obtenir la permission d’épouser sa promise (Pacifique de Montigny), décide d’aller l’épouser à Montréal à la Paroisse du Sacré-Cœur le 30 octobre 1895. Il semble qu’ils ont dû traverser sur le pont de glace reliant St-Lambert à Montréal. Ils ont demeuré à Côte Ste-Catherine, la dernière terre touchant le territoire Mohawk de Caughnauwaga.

- Au jour le jour, janvier 1997
Généalogie de la famille Joly (suite)
Nicolas (I), fils de Jean et de Marguerite Duquesne de Bosc-Guérard-Saint-Adrien en Normandie, épouse Françoise Hunault, fille de Toussaint et de Marie Lorgueil, (tous deux de la recrue de 1653), le 9 décembre 1981, à Montréal. Françoise est canadienne; elle est baptisée à Montréal le 5 décembre 1667.
Nicolas est engagé chez Julien Bloys à Montréal en 1671. Depuis 1674, il cultive une terre située non loin du ruisseau Desroches, à Rivière-des-Prairies. Son fils, Pierre, a été le premier enfant baptisé figurant au registre de cette paroisse. Nicolas, lors du recensement de 1681, est âgé de 33 ans et possède un fusil et 11 arpents de terre en valeur.
Il a été tué par les Iroquois le 2 juillet 1690, lors de la bataille de la coulée Grou. À son décès, Nicolas laisse quatre enfants dont trois se marient par la suite : Marie- Françoise en 1699 avec Jacques Vaudry à Pointe-aux-Trembles, Jacques dit Jean-Baptiste (II) en 1711 avec Marie-Madeleine Poupart à Montréal et Nicolas en 1723 avec Marie Beaudet à Laprairie. Marguerite Duquesne, sa veuve, se remarie en 1691 à Jean Charpentier
Nicolas (II), fils de Nicolas (I), est baptisé à Pointe-aux-Trembles en 1686; on le retrouve à Laprairie vers 1723, marié à Marie Beaudet (ou Saint-Jean selon René Jetté). Nicolas reçoit en 1730 une commission d'huissier royal dans l'étendue des seigneuries de Laprairie de la Magdeleine et de Châteauguay. Nicolas est mort en 1774 à Saint-Philippe.
Louis Lavallée, dans son livre "La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760", le décrit comme l'un des plus remarquables cabaretiers de Laprairie et qualifie son auberge de l'un des hauts lieux de la sociabilité villageoise, sous le Régime français.
Jean Joly (X) est né à Montréal en 1943, marié à Claudette Locas, ils ont deux enfants : Claire et Yves. Jean est membre de la S.G.C.F. et de la S.H.L.M. Jean et sa famille demeurent dans la région depuis 1971 et il est à l'emploi de la commission scolaire du Goéland depuis 1968. Il a occupé un poste d'enseignant, puis de coordonnateur aux Services éducatifs depuis 1972, en 1996 M. Joly a été nommé Secrétaire général.

- Au jour le jour, janvier 1997
Généalogie de la famille Joly
|
Jean Joly Claudette Locas |
Saint-Alphonse-d’Youville de Montréal 20 août 1966 |
Léo Locas Cécile Morency |
|
Éliodore Joly Claire Beauchesne |
Saint-Jean-Baptiste de Montréal 09 juin 1923 |
Charles Beauchesne Alexina Paré |
|
Wilfrid Joly Alphonsine Gauthier |
Saint-Augustin 15 mai 1899 |
Jean-Baptiste Gauthier Adélia Verdon |
|
François Joly Rose-Délima Labelle |
Sainte-Scholastique 07 novembre 1865 |
Pierre Labelle Victoire Pineau |
|
Paul Joly Marie-Adélaïde Ouellet |
Sainte-Scholastique 09 janvier 1832 |
Alexis Ouellet Suzanne Desnoyers |
|
Louis Joly Marie Desjardins |
Saint-Eustache 09 mai 1791 |
Jean Desjardins Josephte Vermette |
|
Jean-Baptiste Joly Angélique Valière |
Sainte-Rose 21 novembre 1768 |
Louis Vallière Angélique Morin |
|
Jean-Baptiste Joly Véronique Paris |
Terrebonne 06 juin 1735 |
François-Gilles Paris Catherine Mezeray |
|
Jacques dit Jean-Baptiste Joly Marie-Madeleine Poupeau |
Notre-Dame de Montréal 19 mars 1711 |
Vincent Poupeau Marie-Madeleine Barsa |
|
Nicolas Joly Françoise Hunault |
Notre-Dame de Montréal 09 décembre 1681 |
Toussaint Hunault Marie Lorgueil |
|
Jean Joly Marguerite Duquesne |
Nicolas est de Bosc-Guérard-Saint-Adrien, arrondissement et archevêché de Rouen, Normandie (Seine-Maritime) France |
Françoise, qui a eu 4 enfants avec Nicolas, se remarie en 1691 à Jean Charpentier, avec qui elle aura 11 autres enfants |

- Au jour le jour, janvier 1997
Constitution de la SHLM
Faire avancer l'étude de l'histoire locale et régionale par des recherches, des publications, des conférences, des musées;
S'intéresser aux monuments historiques, les sauver de la destruction, les conserver à l'admiration des compatriotes et des visiteurs;
Faire l’étude du sol el du sous-sol, l’étude des vieilles familles et faire des recherches généalogiques:
Imprimer, éditer, distribuer toutes publications pour les fins ci-dessus et établir une bibliothèque de publications se rapportant à l'histoire locale et régionale.
Lettres patentes – 18 septembre 1972
LE MINISTRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES, COMPAGNIES ET COOPÉRATIVES DU QUÉBEC, sous l’autorité de la troisième partie de la Loi des compagnies et à la requête de Réal Legault, jointeur, S.-Yves Duclos, restaurateur, Ernest Rochette, historien, Denise Landry, graphiste, épouse de Michel Aubin, Claudette Houde, professeur, célibataire, Réal Cuillierrier, magasinier, tous de La Prairie,
leur accorde les présentes lettres patentes constituant la corporation
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA PRAIRIE DE LA MAGDELEINE
avec siège social à La Prairie, dans le district de Montréal.
Sont administrateurs provisoires de la corporation :
Tous les requérants
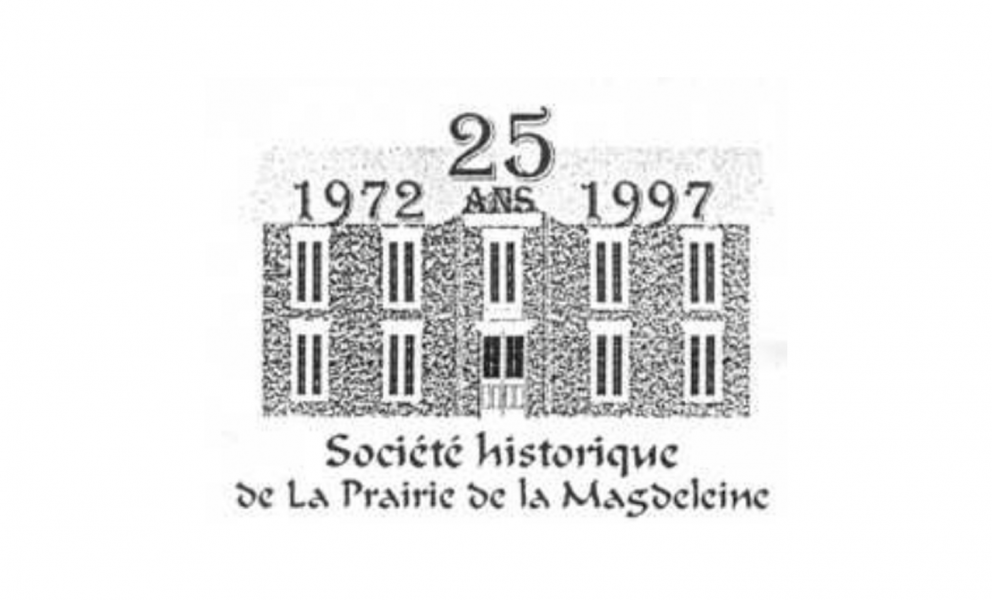
- Au jour le jour, janvier 1997
SHLM: Un solide départ en 1972 (suite)
Tout aussi important est le rôle joué par le conseil municipal de l'époque sous la direction du maire Jean-Marie Lamoureux. Les élus municipaux manifestent un grand intérêt pour le projet.
Dans un quartier qui a mal vieilli, ils entrevoient une vie nouvelle et un apport important pour toute la municipalité. Leur enthousiasme et leur précieuse collaboration stimulent les membres de la SHLM et s'avèrent un encouragement de taille.
Pour sensibiliser les résidents du secteur à la valeur patrimoniale du "Vieux", la SHLM organise en 1972 et 1973 les fêtes de la St-Jean. Ces fêtes attirent plusieurs milliers de visiteurs et participants. La population du quartier participe activement en décorant les maisons, plantant des fleurs, etc. La ville collabore généreusement sous la direction de monsieur Guy Dupré, alors directeur général.
L'arrondissement historique de La Prairie devient réalité en 1975. La déclaration officielle reconnaît la valeur patrimoniale des édifices dans le secteur. Il devient donc très important de préserver les édifices existants et de s'assurer que les interventions architecturales des extérieurs ainsi que les usages permis respectent la nouvelle vocation du quartier. Par les règlements de zonage, la ville peut jouer un rôle essentiel. Faire revivre un secteur qui a un grand besoin de rénovation signifie quelquefois des négociations ardues avec certains propriétaires. Les résidents qui ont investi beaucoup de temps et d'argent pour faire revivre un bâtiment expriment leurs craintes devant certains projets de commerce qui se présentent comme une menace à la qualité de vie qu'offre un quartier majoritairement résidentiel.
À ce jour, le dernier élément pour solutionner ce dilemme se trouve dans l'adoption par le Conseil municipal du règlement PIA (Plan d'Intégration Architecturale). Le quartier s'embellit plus particulièrement entre les années 1976- 1980 lorsque, par un PAQ (Projet d'Amélioration de Quartier), les gouvernements fédéral, provincial et municipal et les propriétaires participent financièrement à la réfection des infrastructures et au dégagement de bâtiments vétustes qui font place à des parcs et autres utilités publiques. Le local du 249 Ste-Marie, où loge la SHLM depuis 1974, est rénové et on y fera des aménagements de qualité.
Les membres-bénévoles de la SHLM utilisent le local pour leurs nombreuses activités. Une précieuse collaboration s'organise pour la recherche et la classification de documents d'ARCHIVES. Les documents écrits sur l'histoire de La Prairie, éléments essentiels pour la connaissance de notre passé, s'accumulent.
Aux Archives nationales du Québec à Montréal, on conserve les archives de l'abbé E. Choquet, historien de La Prairie. Pendant deux années, à raison d'une journée par semaine, trois membres de la SHLM se rendent à Montréal pour classer ces documents dont 20,000 sont photocopiés pour devenir propriété de la SHLM et un index est publié. C'est le début d'une longue aventure qui fera qu'en 1996, nos Fonds d'Archives, qui ont pris de l'ampleur de par leur nombre et qualité, sont devenus des instruments de connaissance d'une grande importance pour tous les chercheurs qui viennent les consulter.
À suivre …..

- Au jour le jour, janvier 1997
Conférence: La géologie de la Rive-sud par M. Robert Bergeon.

- Au jour le jour, janvier 1997
Journal de bord 1887 – Jean-Baptiste Racine de La Prairie – Capitaine de baleinier (suite)
Tout le long du voyage, le capitaine se préoccupe de son fils Paul, 15 ans, qui est à bord du bateau. Il s’initie au métier de marin.
Mardi, le 19 juillet 1887
« Rafales violentes du nord-ouest, forte mer tournante et plongeante ce qui nous donne le mal du pays mais dès le premier beau jour, tout est oublié. Aujourd'hui, Paul a réparé son fond de culotte et je pense que ça va être durable car il a employé tout un rouleau de fil. »
Il lui apprend aussi à lire et à écrire mais il n'est pas très fort en calcul.
Vendredi, le 5 août 1887
« Paul vit dans son élément quand il s'agit de repérer les baleines. Il monte et descend dans les cordages, de I 'aube au soleil couchant. Il a un regard perçant. Il se fait une gloire de les voir le premier. »
Au sujet de la chasse elle-même, parfois il se décourage et dit que c’est comme chercher une aiguille dans un tas de foin.
«C'est bien dur après avoir cherché depuis vingt jours au moment où nous les trouvons de ne pouvoir rien faire à cause des rafales de mer. Penser que je vois juste devant moi quarante à cinquante mille dollars dans la mer et ne pouvoir rien faire. J’espère que nous aurons plus de chance demain.»
La description de la chasse est palpitante.
Tout le long de ce récit, il montre une grande sollicitude à l’égard de son fils, de même qu'envers ses marins qu'il prend en pitié. C'est un récit plein de nostalgie pour la terre abandonnée. A la fin du récit, il demande que son livre de bord soit envoyé à sa soeur Emma. Il recommande à sa soeur de prendre soin de sa mère.
« Si quelque chose arrivait à maman, ce que je n'espère pas, je voudrais que tu prennes en charge la maison et faire du mieux selon ton jugement et je serai satisfait.»
Plus tard, Jean-Baptiste Racine fut mis à la retraite par la compagnie américaine pour laquelle il pilotait des baleiniers. Il mourut assez âgé. Étant un jour à la chasse, son fusil explose, lui arrachant une partie de la main droite. La gangrène se mit dans la blessure et il mourut avant l'arrivée des baleiniers écossais ou américains qui eussent pu le sauver car ils étaient presque toujours accompagnés d'un médecin.
La veuve de Jean-Baptiste vint alors demeurer chez son fils Paul.
La Société historique a la copie du manuscrit du livre de bord de 1887. Ce récit est en anglais et parfois difficile à déchiffrer. Nous en avons fait une traduction qui peut être consultée ainsi que la copie anglaise.
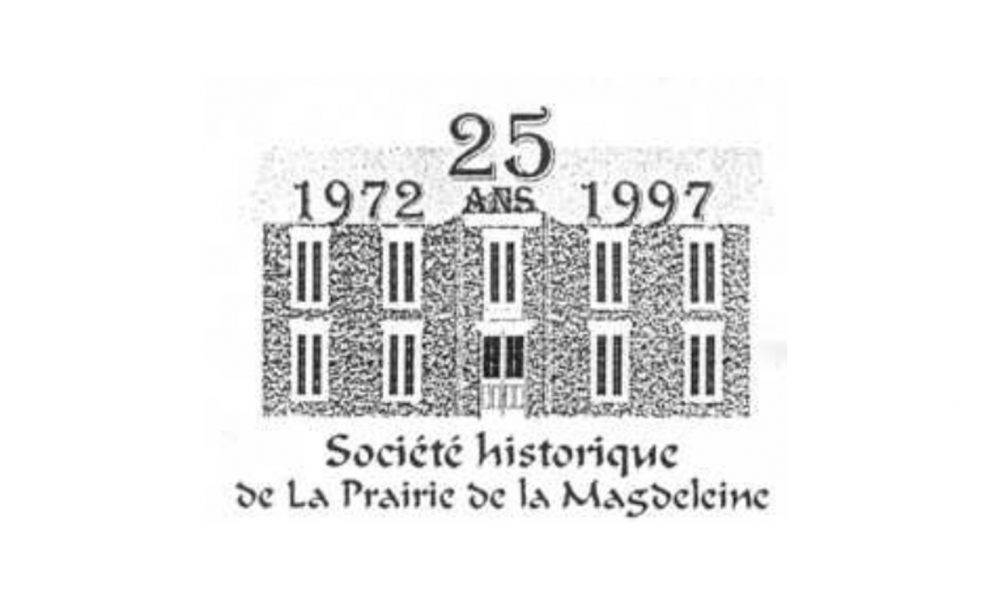
- Au jour le jour, janvier 1997
SHLM: un solide départ en 1972
Les fondateurs de la Société historique qui se réunissent fréquemment au restaurant « Le Vieux Fort » sont chaleureusement accueillis par Gisèle et Yves Duclos, les propriétaires. Afin de s'assurer d'une crédibilité lors des démarches entreprises pour «sauver» le Vieux-La Prairie, ces pionniers demandent au notaire Maître François Lamarre de rédiger avec eux une constitution et de faire les démarches pour asseoir la Société sur une solide base juridique. Dès le 18 septembre 1972, le Ministère des Institutions financières accorde à la Société les lettres patentes qui donnent à l'Association une existence légale sous l'autorité de la troisième loi des compagnies.
Sept membres signent la requête et depuis, la SHLM est devenue une Société à but non lucratif. Les nombreuses subventions reçues au long des années de la part des gouvernements fédéral, provincial et municipal nous sont accordées en s'appuyant sur cette existence légale.
Les réunions du groupe se tiennent à l'étage du restaurant Le Vieux Fort pendant quelques années et tous les documents historiques que les membres vont chercher aux Archives publiques du Canada et du Québec sont soigneusement conservés chez les FIC, maison provinciale de La Prairie. Après la restauration du local de la SHLM, rue Ste-Marie, celle-ci pourra rapatrier ses documents et les conserver en lieu sûr.
Voilà donc qu'une société historique existe légalement et que, de plus, ses membres s'activent à recueillir des documents d'archives qui seront la preuve que le Vieux La-Prairie a un passé digne d'être conservé puisque son histoire est très riche et que l'aménagement du village représente un quartier au patrimoine bâti diversifié qu'il faut sauvegarder.
Au cours de la même période, un intervenant majeur vient s'ajouter au dossier. Michel Létourneau, étudiant en architecture, travaillant en équipe sous la direction de Lazlo Déméter, professeur à la Faculté d'architecture de l'Université de Montréal, présente l'historique de La Prairie avec le support d’un diaporama. Le patrimoine bâti du Vieux-La Prairie y est particulièrement mis en valeur. Ce travail servira de base pour appuyer la demande de déclaration du quartier en ARRONDISSEMENT HISTORIQUE, en 1975. Michel Létourneau, aujourd'hui architecte, continue d'apporter à la SHLM sa précieuse collaboration.

- Au jour le jour, janvier 1997
Journal de bord 1887 – Jean-Baptiste Racine de La Prairie – Capitaine de baleinier
Grâce à madame Thérèse Bonneterre, parente du capitaine Racine, qui était un chasseur de baleines au siècle dernier, la société a acquis une copie du livre de bord du baleinier Eva, commençant en juin 1887 jusqu'au 18 septembre de la même année.
Capitaine de bateau à l'emploi d'une compagnie américaine au Massachusetts, il conduisait un navire baleinier dans les eaux de l'île de Baffin. A Pond lnlet, il fait la connaissance d’une jeune esquimaude dont le mari s'est récemment noyé, laissant une petite fille à son épouse. De cette femme autochtone, le capitaine Racine a un fils, né à Pond Inlet, le 17 février 1872. Plus tard, à la fin 1878, le capitaine ramène son fils pour le faire baptiser à La Prairie, le 22 janvier 1879, sous les prénoms de Paul, Jean-Baptiste, François. Son père le confie alors à sa famille avec instruction de l’élever selon les habitudes des Canadiens de l’époque et de le faire instruire.
Le livre de bord raconte jour par jour ce qui se passe à bord du bateau, partant de New Bedford au Massachusetts, passant au large de l’île de Sable, puis dans le golfe, contournant Terre-Neuve et remontant jusqu'au Groenland pour se rendre près des côtes de l'Islande.
Nous suivons les péripéties de la recherche de la bonne baleine c'est-à-dire celle qui donne le plus d’huile. Au début, le capitaine Racine ne rencontre que des requins Popasas puis des baleines «Fineback» (rorqual commun) en quantité, puis des baleines à bec communes (Bottlenose), aussi des baleines bleues (Sulphur Bottom) mais la baleine franche noire lui échappe. Puis enfin, il la trouve et réussit après multiples péripéties, même mort d'homme, un nommé John Owens de la 57e rue à New York qui mourut à la suite d'une chute et fut inhumé en mer le jour même.
Ayant réussi à prendre la baleine, il commence à la faire bouillir pour recueillir environ 64 barils d’huile ainsi que 800 livres d’os.
Sur le chemin du retour, il s'arrête au Kichestan, au port de Black Lead en terre de Baffin où il termine le travail de bouillage et le chargement du bateau. Les marins et le capitaine en profitent pour se faire des petites soirées de danse à bord des autres bateaux amarrés.

- Au jour le jour, décembre 1996
Décès
Monseigneur Bernard Courville, résidant à la Maison Léonie-Paradis de La Prairie depuis 3 ans, est décédé le 16 novembre dernier. M. Courville était un de nos membres

