
- Au jour le jour, décembre 2006
Emmanuel Desrosiers, écrivain
Présentation : M. Laurent Houde est le neveu d’Emmanuel Desrosiers, il a réalisé à l’été 2006 avec l’aide de sa cousine, Claire Desrosiers-Leroux (la fille d’Emmanuel Desrosiers), un travail destiné à des membres de leurs familles respectives. Ils en ont tiré sept copies plus une destinée à la SHLM. Le texte qui suit est un texte de présentation préparé pour le « Au jour le jour ».
Emmanuel Desrosiers est né, le 5 octobre 1897, à la côte Sainte-Catherine, dans la demeure de ses grands-parents maternels, François Demontigny et Claire Marotte dit Labonté. Il était le deuxième fils d'Arthur Desrosiers et de Pacifique Demontigny.
En 1903, ses parents viennent s'établir sur une terre, en bordure sud de la Commune de La Prairie. Il fait ses études à l'Académie Saint-Joseph de La Prairie et les poursuit à l'École normale Jacques-Cartier, de Montréal. Au terme de ces études il enseigne pour une courte période dans une école rurale de la côte Sainte-Catherine.
Vers 1918, il débute comme apprenti linotypiste à l'imprimerie des Frères de l'Instruction Chrétienne de La Prairie.
En 1924, il entre au journal Le Devoir comme linotypiste. Il y demeure six ans pour ensuite continuer d'exercer son métier dans des imprimeries sises dans l'île de Montréal.
En novembre 1927, il épouse Jeannette Brosseau de La Prairie. Ils auront trois enfants. Pendant qu'il réside à La Prairie, jusqu'à 1928, Emmanuel Desrosiers s'intéresse activement, avec quelques concitoyens, à l'histoire de sa « petite patrie ». Il est particulièrement désireux de faire connaître par l'écrit les accents du terroir local.
Le 24 décembre 1926, La Presse publie Conte de Noël qui serait le premier de ses textes à avoir été édité. Sa carrière d'écrivain est lancée. Ses textes publiés, de 1926 à 1928, dans La Presse et La Patrie, sont des récits et des contes qui mettent en cause des gens, des lieux et des événements reliés à La Prairie.
Ces premières publications le font connaître. S'ensuivent des collaborations attitrées à quelques périodiques. En mars 1927, il entreprend la publication régulière de « Billets hebdomadaires » dans le journal La Parole de Drummondville. En août 1930, son dernier billet sera le 99e à y paraître.
D'octobre 1930 à juin 1932, alors que cette revue, soignée tant dans sa présentation que dans son contenu, cessera de paraître, il aura publié dans Mon Magazine 41 articles de nature variée : récits, contes, nouvelles et reportages sur les arts, le tourisme et des personnages de marque.
Alors qu'il collabore régulièrement au journal La Parole Emmanuel Desrosiers entreprend la rédaction d'un premier roman. La fin de la terre paraît en 1931. C'est une œuvre d'anticipation qui raconte la série des cataclysmes destructeurs de l'habitat humain et les moyens entrepris par les hommes pour tenter d'échapper à cette situation catastrophique. À l'époque, ce roman s'avère une nouveauté dans la production littéraire québécoise.
L'auteur écrira une suite à ce premier roman qu'il intitule provisoirement : « Rien que des hommes », où il décrit l'installation sur la planète Mars de millions d'hommes qui avaient quitté la Terre en voie de se détruire. Le roman dont l'ébauche a été conservée n'a pas été publié.
De 1935 à 1942, il fait partie de l'équipe rédactionnelle de la revue Le Pharmacien. Il y fait paraître une quarantaine de textes, surtout de petites histoires.
Lors de la seconde guerre mondiale, en 1941 et 1942, il fournit une cinquantaine de nouvelles au Service fédéral de l'information en temps de guerre. Le Service distribue ces textes à divers journaux et revues. Trente-deux ont été publiés.
Au cours de l'année 1941, huit courts romans policiers, écrits pour l'éditeur J. E. L'Archevêque, sont publiés par ce dernier.
Après 1942 on ne lui connaît pas d'autres écrits publiés. Il décède des suites d'un accident vasculaire cérébral, le 28 janvier 1945. Il avait 47 ans.
Emmanuel Desrosiers avait conservé dans ses archives personnelles une bonne part des écrits qu'il avait publiés ainsi que plusieurs ébauches de textes non publiés. Ces archives sont actuellement conservées par sa fille, Claire Desrosiers-Leroux et une partie, photocopiée, se retrouve dans la collection d'archives de la SHLM.
Claire Desrosiers-Leroux et moi-même avons entrepris de regrouper dans des recueils la plupart des textes publiés ou les ébauches destinées à l'être. Cette tâche a été complétée et ces recueils auront été remis à la SHLM au moment où vous lirez cet article dans Au jour le jour. En voici les titres :
Romans et écrits divers.
Billets parus dans La Parole de Drummondville de mars 1927 à août 1930.
Écrits parus dans Mon Magazine d'octobre 1930 à juin 1932.
Écrits parus dans Le Pharmacien.
Contes et nouvelles de guerre.
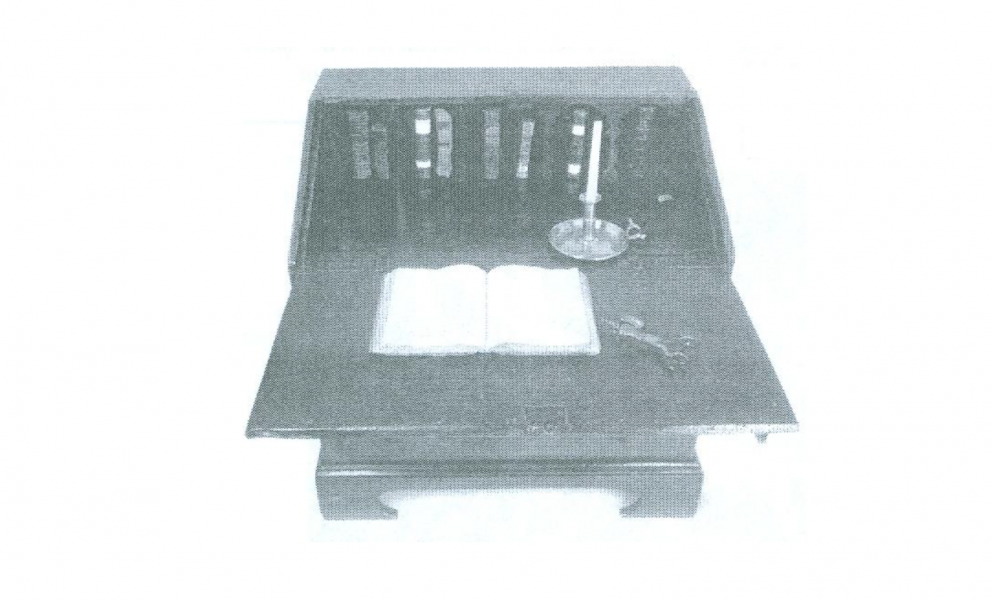
- Au jour le jour, juin 2006
En feuilletant de vieux dictionnaires
Le court récit qui suit contient quelques mots et expressions, présentés en italiques, dont vous êtes invités à trouver le sens. Ce sont des exemples du langage populaire français du XVIIIe siècle. La scène pourrait se passer à Lyon, rue Du Bœuf, vers 1800.
Chez le marchand de vin, deux compères sont attablés près d'une fenêtre et sirotent un bon petit blanc tout en portant jugement sur les passants de la rue.
Passe près de la fenêtre un quidam titubant qui fixe un moment la bouteille des deux amis.
– Lui as-tu vu le portrait? un abreuvoir à mouches sur le museau et un autre dans le front.
– T'as trop pinté, bonhomme, remarque l'autre en aparté, tu me fais penser à mon beau-frère. Tu sais, ajoute-t-il pour son compère, c'est un fameux biberon. Quand on lui demande quel temps il fait, il vous répond : Il fait soif.
– Eh? regarde-moi ça. Vois-tu cet algonquin qui bouscule tout le monde?
– Ça se conduit en argousin.
– Et celui-là qui se hâte en serrant les dents.
– J'te parie qu'il s'en va où le roi ne va qu'à pied. Après un moment de silence :
– Eh! l'ami, il me semble que ton regard s'attarde sur cette créature qui m'a tout l'air d'une gourgandine.
– Tu te méprends.
– Holà! fais pas la sainte n'y touche.
Abreuvoir à mouches : Plaie large et profonde, faite au visage avec le tranchant d'un sabre, ou quelquefois même avec un instrument contondant. L'abreuvoir à mouches provient fort souvent de blessures que les enfants de Bacchus se font, soit en se battant à coups de poings, soit en donnant du nez contre terre.
Algonquin : Terme injurieux et de mépris, qui signifie balourd malotru; homme audacieux et grossier. On se sert particulièrement de ce mot pour désigner un étranger ou un inconnu dont la figure est dure et rebutante, et qui se présente en un lieu avec hardiesse et incivilité.
Argousin : Sobriquet injurieux qui équivaut à iroquois, butor, lourdaud, homme stupide et grossier. C'est aussi le nom qu'on donne aux officiers subalternes qui surveillent les galériens.
Où le roi ne va qu'à pied : i.e. aux privés, à la chaise percée, où on ne peut envoyer personne à sa place.
Gourgandine : coureuse, femme qui a passé sa jeunesse dans la débauche et la prostitution.
Références :
D'Hautel, Dictionnaire du bas langage ou des manières de parler usitées par le peuple… 1808
Lorédan Larchey, Les excentricités du langage, 5e édition, 1865
L'ouvrage de Lorédan Larchey est restreint et se limite aux « excentricités », mais il est facile à consulter et sa présentation est particulièrement intéressante.
Le dictionnaire de D'Hautel ne dispose pas, dans sa version numérique, d'un logiciel qui donne un accès direct à des mots ou des pages. Il faut pratiquement le parcourir une page après l'autre et il est volumineux. Comme le précédent, sa typographie se lit bien.
Ces dictionnaires et bien d'autres peuvent être consultés sur le site LEXILOGOS.
Choisir Langue française, puis, dictionnaires anciens du VIIIe au XIXe s., puis, français du XIXe s., puis, français populaire.
Le site offre à la consultation un ensemble de dictionnaires et encyclopédies, conservés par la Bibliothèque Nationale de France, à partir des plus anciens. L'histoire de l'évolution de la langue française depuis ses débuts est aussi bien exposée sur le site, entre autres aspects de la langue.

- Au jour le jour, avril 2006
Conférence : La Prairie, « Une tante m’a raconté… »
Prochaine conférence
La Prairie, « Une tante m’a raconté… »
par : Monsieur Laurent Houde
Le mardi, 18 avril 2006, à 19h30

- Au jour le jour, avril 2005
Lignée des ancêtres d’Ernest Poupart
|
Poupart, Ernest |
Montréal, 19 juillet 1941 |
Jocelyne Vinette Antonio – Élodie Gervais |
|
Poupart, Arthur |
Saint-Rémi, 28 août 1904 |
Albertine Hébert Jean-Baptiste – Mélina Bessette |
|
Poupart, Arthur |
Saint-Isidore, 3 février 1880 |
Marie-Sophie Dubuc Louis – Sophie Bazinet |
|
Poupart, Louis |
Saint-Constant. 25 octobre 1852 |
Zoé Benoit François – Desanges Bonneville |
|
Poupart, Julien |
Longueuil, 13 juin 1814 |
Josette Cadieux Louis – Josette Ste-Marie |
|
Poupart, Constant |
La Prairie, 11 février 1742 |
Marie-Louise Vacherau Julien – Angélique Leber |
|
Poupart, Jean-Baptiste |
La Prairie, 20 octobre 1742 |
Marie-Madeleine Deniger Pierre – Catherine Têtu |
|
Poupart, Jean-Baptiste |
La Prairie, 23 février 1716 |
Marie Gervais Mathieu – Michelle Picard |
|
Poupart, Pierre |
La Prairie, 11 août 1682 |
Marguerite Perras Pierre – Denyse Lemaitre |
|
Poupart, Jean |
De St-Denis, arrondissement de Bobigny, archevêché de Paris. |
Marguerite Frichet |

- Au jour le jour, avril 2005
Un anniversaire spécial
C’est avec plaisir et fierté que nous consacrons cet espace de notre bulletin mensuel à la mention du centième anniversaire de naissance de l’un de nos membres, monsieur Ernest Poupart.
Ernest Poupart est né le 4 avril 1905 dans le rang Petit Saint-Régis, à Saint-Constant. Quand il a commencé à fréquenter l’école, ses parents demeuraient au 41 de la rue Ste-Marie, à La Prairie. Il a terminé ses études à l’Académie Saint-Joseph en 1921. Dans la dernière partie de son cours, il a eu comme professeur le Frère Damase qui enseignait à ses élèves la pratique des opérations commerciales de base.
Dès sa sortie de l’école, il obtient un emploi comme commis de bureau chez Jean-Baptiste Doré et Fils, manufacturiers de machines aratoires.
Au début de 1922, il entre à l’imprimerie des Frères de l’Instruction Chrétienne, à La Prairie. Il y reste jusqu’en 1926. Il y acquiert la formation de linotypiste et prend de l’expérience dans le métier. En 1926, il entre au journal Le Progrès du Saguenay, à Chicoutimi, à titre de linotypiste. Six ans plus tard, le journal éprouvant des difficultés financières, il laisse Chicoutimi pour Montréal. Il est rapidement engagé, dans son métier, au Montreal Star et y demeure jusqu’à l’âge de 65 ans. C’est à Montréal qu’il épouse Jocelyne Vinette, le 19 juillet 1941.
Encore très en forme après avoir laissé le Montreal Star, il entreprend avec succès une nouvelle carrière de plusieurs années dans l’assurance.
Dès les débuts de sa vie professionnelle, Monsieur Poupart s’est intéressé à la photographie comme amateur. Il a conservé avec soin la collection des appareils qu’il a utilisés au cours de sa longue vie. Il possède aussi d’intéressantes photos qu’il utilise pour illustrer des causeries où il a la réputation d’être un conteur plein d’entrain et captivant. À cent ans, le 4 avril 2005, Monsieur Poupart continue d’épater son entourage par sa vivacité d’esprit, la richesse de ses souvenirs et son amabilité.
Vous trouverez, à la page suivante, la lignée directe des ancêtres de monsieur Ernest Poupart.

- Au jour le jour, février 2005
Elle n’avait pas froid aux yeux
Albina Guérin (1861-1938) était la fille de Aimé Guérin (1832-1909) et de Léocadie Beauvais. Elle a épousé Domina de Montigny, comme elle de la côte Sainte-Catherine, en 1886.
Le couple a deux enfants quand, en 1898, avec Lorenzo Létourneau, Domina va participer à la ruée vers l'or, au Klondike. Les jours sont longs quand le mari est si loin, d'autant plus que, même si c dernier lui écrit de temps à autres, il est difficile d'imaginer comment il vit alors au Yukon. Qu'à cela ne tienne. Elle ira voir de quoi il en retourne.e
Sans prévenir son époux de sa venue, elle part seule pour le rejoindre avec un fils dernier né. On est peut-être en 1899. De La Prairie au Yukon, la distance est de plusieurs milliers de kilomètres. De Montréal à la Colombie-Britannique le trajet se fait en train. À partir de là, il lui reste environ 2500 km à franchir pour atteindre le lieu où habite Domina. Pour s'y rendre, elle utilise les moyens de transport alors disponibles. Ces moyens de transport et les lieux où il faut arrêter, chemin faisant, pour se restaurer et dormir sont loin d'offrir le confort, les services et la sécurité qu'on connaît de nos jours. Elle effectue la dernière partie de son voyage dans un traîneau à chiens.
Quand Albina arrive à la simple habitation de bois rond que Domina partage avec un compagnon, ce dernier est seul. Domina s'est absenté pour quelques heures. Eh bien? Ça va! Elle en profite pour lui concocter un bon repas avec les produits de base disponibles qu'elle trouve sur place. Encore à l'extérieur du logis, en revenant, Domina n'en croit pas ses oreilles. N'est-ce pas la voix ferme et bien connue de sa Bina qu'il entend? Pour un moment, il se croit en proie à une hallucination. Pas croyable! Mais c'est bien elle. Albina séjournera plusieurs mois avec son époux dans la nature sauvage du Yukon.
Plusieurs années plus tard, de 1907 à 1922, les époux sont hôteliers sur la rue Sainte-Marie, à La Prairie. En 1907, Domina a acquis l'établissement de Louis Pantaléon Pelletier. Sous leur gouverne l'hôtel prospère. Domina y est un hôte bien présent auprès de sa clientèle. À l'occasion des repas, il circule entre les tables, prend des nouvelles de chacun et leur en donne de leurs connaissances. Le verbe haut associé au geste, il se plaît également à raconter de ses aventures au Klondike ou à discourir des merveilles de la Floride où il passe quelque temps chaque hiver. Il y possède une propriété avec un potager et quelques arbres fruitiers dont il aime vanter les beaux produits. Son animation à la salle à manger constitue une sorte de prime ajoutée à la qualité de la table qui attire chez lui les voyageurs de commerce qui opèrent dans la région. La cuisine d'Albina Guérin, dont les rôtis de boeuf sont particulièrement renommés, assure à l'établissement une clientèle fidèle.
Il n'y a cependant pas que les voyageurs de commerce qui fréquentent l'Hôtel de Montigny. Les fins de semaine surtout, des amis viennent y discuter de choses et d'autres tout en buvant la bonne bière Dow ou Black Horse. L'effet de l'alcool, comme on sait, n'est pas toujours propice, chez certains, au maintien de la sérénité dans les échanges. Pour défendre son point de vue, il arrive qu'on en vienne à crier de gros mots, à menacer et, parfois, à se lever pour se battre.
Passe encore de parler fort, mais non de passer aux actes. Dans ces circonstances, il arrivait à Albina de se charger du maintien de l'ordre en tentant de faire comprendre à certains petits groupes trop éméchés de retrouver leur calme. Arrivant dans la salle avant de l'hôtel où ces scènes se passaient, elle se plaçait près du poêle destiné à chauffer la pièce. D'une voix impérieuse elle ordonnait aux excités de se tranquilliser, sinon, de prendre la porte. L'avertissement n'était pas nécessairement reçu d'emblée comme il aurait convenu. La patronne se voyait rétorquer de se mêler de ses affaires tout en s'entendant invectiver de surnoms malséants.
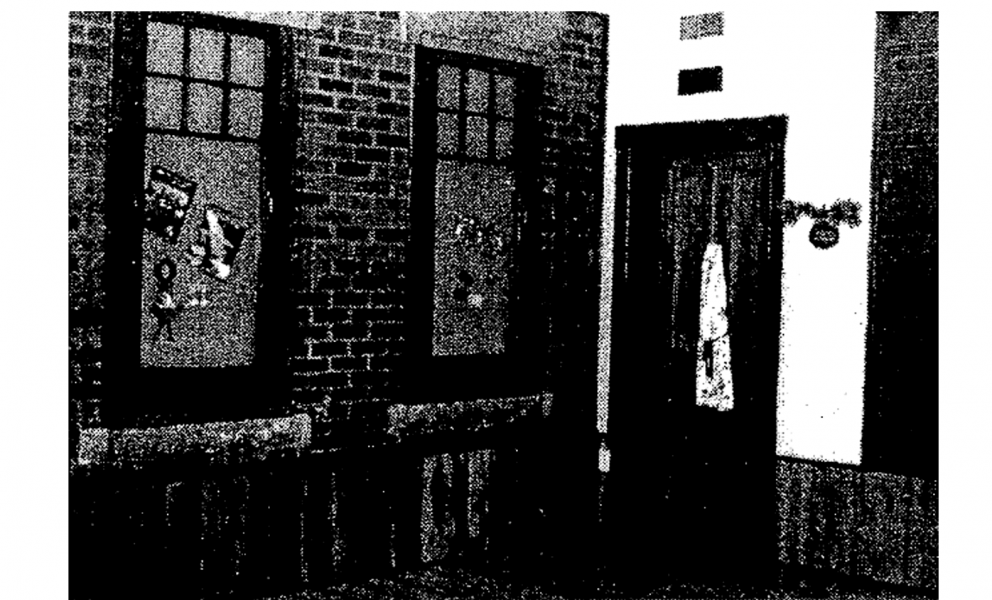
- Au jour le jour, février 2005
Elle n’avait pas froid aux yeux (suite)
C’était la méconnaître. Calmement, elle s’armait du tisonnier rangé près du poêle, l’élevait d’une main ferme et avançait résolument vers les récalcitrants. Bien que de grandeur moyenne, elle avait le port imposant grâce à un coffre thoracique bien garni et une audacieuse devanture; ce qui, associé à son expression et sa façon de tenir son arme, produisait l’effet désiré. Inutile alors de répéter deux fois son retentissant Dehors! Les indésirables avaient compris. Sortons. les gars, la vieille… est capable de nous tuer.
Peu portée à s’en laisser imposer, on raconte, qu’un jour, sur le chemin de la côte Sainte-Catherine qui longeait le fleuve, un résident du lieu lui barrait le passage, une hache à la main. Cet individu, probablement paranoïaque, avait de ces crises de folie où il se plantait ainsi au milieu de la voie publique, menaçant de sa hache quiconque ne consentait pas à rebrousser chemin. Habituellement, les gens obtempéraient quitte à revenir quand l’individu était retourné au logis.
Peu impressionnée par le type qu’elle connaît, Albina continue de se diriger vers lui et, de sa voix autoritaire, l’apostrophe en ces termes : Range-toi si tu ne veux pas avoir affaire à moi. L’ordre suffit à faire recouvrer ses esprits au belliqueux personnage. On peut se demander de qui Albina Guérin avait hérité son audace et sa maîtrise des situations dangereuses. Probablement de son père, Aimé Guérin, reconnu comme l’un des plus habiles cageux de son temps, une occupation qui l’avait attiré dès son entrée dans le monde adulte. Son habileté à descendre les rapides du Sault Saint-Louis et sa force de caractère lui valurent d’occuper le poste de contremaître sur les cages ou trains de bois qui convoyaient le bois de l’Outaouais jusqu’au port de Québec. Il a occupé cette responsabilité de 1875 jusqu’à son décès, en 1909, à l’âge de 77 ans. On le surnommait Le Vieux Prince, le prince des cageux.
Sources : Rodrigue de Montigny, petit-fils, et Viviane Desrosiers, filleule de Domina de Montigny et Albina Guérin.

- Au jour le jour, décembre 2004
Prophète
Présenté par monsieur Laurent Houde (277), le texte qui suit met en évidence un personnage typique d’autrefois qui en a inspiré d’autres, fictifs ceux-là, comme le Survenant de Germaine Guèvremont, ou Jambe-de-Bois, dans les Belles Histoires des Pays d’en Haut. Soumis aux hasards de la loi non écrite de l’hospitalité, ces itinérants d’une autre époque faisaient partie du décor et du folklore de nos villages et de nos campagnes.
Septembre, vers 1920. « On est à la veille de voir arriver Prophète », disait grand-mère. Prophète, de son vrai nom Stephen Seaman (ou quelque chose d’approchant), était quêteux. Il venait frapper à la porte des Desrosiers à la fin de l’été. Arthur Desrosiers et sa famille demeuraient alors au bord du fleuve, juste en dehors de la limite de l’angle sud-ouest de la Commune.
Prophète venait à pied sur la route qui longeait le fleuve. Souvent, le jour précédent, il avait fait une halte chez les Lefort Les Lefort habitaient ce qu’on appelle aujourd’hui la Maison Melançon dans le parc de Candiac situé en bordure du fleuve, là où le boulevard Marie -Victorin tourne vers Sainte-Catherine., dans leur vieille maison de pierre où, après l’avoir restauré, on l’avait gardé à coucher. Quand grand-mère lui demandait où il avait couché, il décrivait le lieu où c’était, mais sans nommer ses hôtes. Il ne semblait pas retenir le nom des familles où il s’arrêtait dans ses pérégrinations, mais il avait la mémoire des lieux qui l’avaient bien accueilli et y revenait annuellement. Si grand-mère insistait pour connaître son lieu d’origine, il répondait simplement : « Les Cèdres ».
En arrivant chez grand-père, il s’offrait toujours à aider. Une fois, grand-père entrait à la cave des patates qu’il avait mises en poches après la récolte. Spontanément Prophète se met à la tâche, saisit une poche et entreprend de la descendre où elle doit aller. C’est trop lourd pour lui. Petit homme plutôt malingre, il échappe son fardeau qui, en tombant, déchire son enveloppe et laisse échapper son contenu. Grand-père qui a pitié du pauvre hère lui dit tout simplement : « Laisse faire, Prophète, c’est trop dur pour toi. »
Dépendant de son heure d’arrivée, par exemple en après-midi, Prophète soupe avec la famille et on le garde à coucher. Il va dormir sous les combles dans la grande pièce qui sert de chambre commune aux garçons de la famille. Avant de se mettre au lit, il s’agenouille et, à voix haute, fait sa prière : « J’aime Dieu, je me donne à Dieu, j’ai un regret d’avoir offensé Dieu. » Ses façons de faire portent les garçons, adolescents et jeunes gens, à l’agacer. Après sa prière il se fait demander : « As-tu une blonde, Prophète? – T’as pas peur d’aller en enfer? » et autres questions ou remarques du genre. Pour cette âme simple, ce genre de propos est un peu scandalisant. Il se défend en se mettant à raconter toutes sortes d’histoires qui n’en finissent plus. Si bien que les garçons que le besoin de dormir a fini par gagner ne le trouvent plus drôle. « Ferme-la, lui crie l’un deux, ou je vais aller te la fermer moi-même. » Cela suffit et le débat est clos.
D’ascendance irlandaise, Prophète parlait le français sans accent. Comme les gens de son peuple, il avait les pommettes saillantes et roses. Il portait la barbiche et une petite moustache, avait d’épais sourcils et une chevelure abondante et frisée. C’est grand-mère qui lui avait donné le surnom de Prophète. Pressentant un changement dans le temps, il prédisait, par exemple, qu’on aurait de la pluie. « Comment peux-tu savoir ça? » lui demandait grand-mère. « Parce que je le sais. » Pour confirmer la chose, il frappait le mur des jointures d’une main tout en plaçant l’autre près de son oreille pour mieux entendre et répétait : « On va avoir de la pluie. »
Quand venait le temps de partir après le déjeuner, Prophète était triste et grand-mère l’était également. Elle éprouvait de la compassion et de l’affection pour cet homme, un grand enfant à l’esprit simple qu’elle jugeait bon et dénué de malice. Probablement un errant sans famille, il ressentait la chaleur d’une certaine tendresse dans l’accueil reçu. Son statut l’obligeait toutefois à mettre fin à ce court séjour. Le cœur un peu gros, mais sans le dire, il remerciait son hôtesse d’un jour, reprenait sa route de quêteux et retrouvait les incertitudes qui l’accompagnaient dans ses déplacements.
(Les souvenirs évoqués dans ce texte sont ceux de Viviane Desrosiers.)

- Au jour le jour, avril 2004
Mots et maux d’amour
1ère partie
Aujourd’hui, alors que le téléphone est à la portée de tous, que les moyens de transport sont nombreux et rapides pour se visiter, les amoureux ont moins tendance à s’écrire pour communiquer. Ce qui n’empêche pas qu’il y ait à l’occasion des sentiments particuliers que l’écrit permet d’exprimer avec plus de facilité et avec de plus jolis mots.
La lettre ou la note d’amour qu’on fait parvenir à l’être aimé n’est pas toujours le fait d’une lointaine et douloureuse séparation. Elle peut être préparatoire à une rencontre en touchant des sujets chargés d’émotivité trop difficiles à aborder en face à face. On l’emploie aussi après coup pour dire ce qu’on n’a pas osé alors qu’on était ensemble.
Mes grands-mères paternelle et maternelle avaient conservé des pièces de ce genre de correspondance datant de leur temps de jeune fille, dans les années 1887 et 1894. Un aspect intéressant de ces lettres et mots d’amour est le fait qu’assez souvent on s’y exprimait en vers. À l’époque, plusieurs journaux inséraient entre les articles qu’ils publiaient des pensées et des poèmes d’écrivains d’ici ou d’ailleurs, ce qui était apprécié d’une partie de leurs lecteurs et lectrices. Certains s’en inspiraient quand cela correspondait à leurs sentiments et les utilisaient même dans leurs écrits en les modifiant ou non.
Ma grand-mère paternelle avait conservé dans un petit carnet le texte de messages destinés à son amoureux dont on ne peut dire s’ils lui furent tous expédiés. Au début de la vingtaine, elle allait découvrir bientôt que celui qu’elle aimait était en voie de la laisser pour une autre. Un soir, elle a l’âme romantique et écrit à son amoureux :
Lorsque le doux zéphyr ira te caresser
Sur ses ailes oh Zémir
Renvoie-moi un baiser
Ces vers ont sans doute été inspirés par des lectures. Le zéphyr est ce vent d’ouest tiède, léger et agréable que les Grecs avaient divinisé et qui a par la suite été utilisé comme symbole poétique. Zémir(e) est un personnage d’un opéra-comique italien datant du 18ième siècle. Les vers qui suivent sont plus simples et de sa propre création :
Tu sais combien je t’aime
Toi mon bonheur suprême.
Que tu m’aimes de même
Vient me rendre l’espoir.
Tiens toujours ta promesse
Ha pour moi quelle ivresse
Quand je vais te revoir.
Puis, quand le rêve s’est brisé :
Éloigne-toi, ne sois plus mon idole
Laisse-moi libre et reçois mes vrais adieux.
J’ai trop vécu sous ta vive auréole
Mes sens glacés ne sont plus soucieux…
Quelques années plus tard, grand-mère s’unit à un homme fidèle avec qui elle vécut jusqu’à sa mort. Mais elle conserva son petit carnet et les élans de son cœur qu’elle y avait consignés.

- Au jour le jour, janvier 2004
Le coût de la vie dans les années 1930
Est-ce que le coût de la vie était réellement moins élevé que de nos jours dans les années 1930, à La Prairie? À première vue, on le croirait. Surtout si on se limite à comparer ce que le dollar permettait de se procurer en comparaison de son pouvoir d'achat actuel. Il faut cependant, pour établir le coût de la vie, l'assortir du revenu des consommateurs. Pour une somme correspondant à une heure de travail, par exemple, qu'est-ce qu'un consommateur moyen pouvait alors et peut maintenant se procurer?
Mon père avait conservé un certain nombre de vieux papiers datant de cette époque. Ils contiennent des données sur le coût de la vie dans les années 1930. Il fit construire sa première maison, au coin des rues Saint-Georges et Saint-Laurent en 1934-35. Il achète alors le bois nécessaire à la construction à Saint-Moïse, comté de Matapédia. Le Canadien National en effectue le transport jusqu'à La Prairie pour la somme de 20.76$. Un wagon de 40 pieds rempli à sa capacité visible contient 17459 pieds de bois d'épinette de diverses dimensions, 11 paquets de lattes de cèdre no.1 et 25 paquets de bardeaux clairs. Le tout a coûté 572.39$. Dans le lot, la planche d'épinette embouvetée (à rainure et languette) de 1 par 5 pouces vaut 24$ le 1000 pieds et le paquet de bardeaux, 3,50$. Le bardeau était destiné à la couverture et les lattes de cèdre, légèrement espacées les unes des autres, constituaient une structure pour recevoir le plâtre des murs et plafonds. On utilise aujourd'hui pour ces surfaces des panneaux de gypse. Les clous de 4, 5 et 6 pouces se vendent alors 3e la livre et le rouleau de papier noir goudronné vaut 1.50$. La brique achetée de The Laprairie Co. est vendue à 35$ le mille.
Le menuisier Joseph Bisaillon qui agit comme contremaître de la construction est payé tantôt 0.40$, tantôt 0.50$ l'heure. Le plombier Benoit Bonneterre est rémunéré au tarif de 0.50$ l'heure. Tous les autres ouvriers reçoivent 250 l'heure. Toutefois, un homme qui travaille avec son cheval pour excaver ou transporter de la terre ou des matériaux le fait au tarif de 0.350. Le peintre J.W. Comeau exécute, pour la somme-de 25$, le travail de peinture des murs intérieurs du rez-de-chaussée et de l'étage de la maison comprenant une couche d'apprêt et deux autres couches. Dix ans après cette construction, les salaires ont doublé. En 1945, le contremaître gagne de 0.90$ à 1.00$ et les ouvriers non spécialisés, 0.50$. Aujourd'hui, le tarif horaire d'un plombier a centuplé par rapport à celui de Benoit Bonneterre, en 1935, mais il en coûte énormément plus cher à cet ouvrier pour vivre.
Dans les années 1930 on achetait les denrées nécessaires à son alimentation au magasin général dont certains avaient un secteur alimentaire plus développé. On prenait sa viande chez le boucher. Le boulanger Edmour Lussier faisait sa tournée de livraison de pain frais auprès de la clientèle. Les laitiers faisaient de même. Chez nous, c'est Ismaël Favreau qui apportait, chaque jour, le lait frais tiré de ses vaches et non pasteurisé et la crème si on en voulait. Une pinte de lait coûtait 80. Le panier de patates valait 250 et 100 s'il s'agissait de petites patates. De nos jours les grelots se vendent plus cher que les pommes de terre régulières. En saison, on pouvait manger des haricots frais au coût de 50 la livre. Un gros pallier d'oignons valait 200. On conservait les aliments périssables dans une glacière. Dans une voiture tirée par un cheval, le marchand de glace faisait la livraison des blocs congelés. En fin de tournée, par les jours de grande chaleur, les clients en avaient un peu moins pour leur argent. Il en coûtait environ 10$ pour une année de livraison s'étendant de mai à octobre ou novembre.
Les médecins qui soignaient les maladies des gens de la région devaient adapter leurs tarifs aux capacités de payer de leurs malades. Plusieurs n'avaient pas les moyens de les payer; d'autres n'étaient pas pressés de le faire. Il n'y avait pas de dentiste résidant à La Prairie mais le dentiste Lane Charpentier de Montréal avait un cabinet sur la rue Sainte-Marie où il prodiguait ses soins quelques heures par semaine. Une visite chez ce dentiste pouvait coûter 2$. Si on devait être hospitalisé pour une opération, on en assumait tous les frais à moins d'être considéré comme réellement démuni. Pour une hospitalisation à l'Hôpital général de Verdun, il en coûtait 5$ par jour pour soins, chambre et pension. Le malade assumait aussi, en plus de payer son chirurgien, une charge de 10$ pour usage de la salle d'opération et les frais de 20$ de son anesthésiste.
Le peu de citoyens qui possédaient un véhicule moteur payaient l'essence 260 le gallon en 1932. Soit, 50 le litre. L'huile à moteur valait 300 la pinte (260 le litre). En 1945, l'essence avait augmenté à 330 le gallon et l'huile à 490 la pinte.
À tout considérer, le coût de la vie était-il réellement moins élevé il y a environ 70 ans? Tout dépend des biens qu'on évalue. Compte tenu du pouvoir d'achat du dollar entre alors et maintenant que répondre? La réponse doit être nuancée et, pour la formuler, chacun tiendra compte de ses moyens et de ses besoins en fonction des valeurs sur lesquelles il fonde sa qualité de vie. Si on considère l'espérance de vie, l'accès et la qualité des services de santé et d'éducation disponibles, la variété des loisirs et des activités culturelles, le niveau de bien-être matériel des milieux de vie, le bon vieux temps était-il préférable à celui d'aujourd'hui? À savoir si on était alors plus heureux qu'aujourd'hui est une autre question. Une chose est certaine : on y avait moins envie de toutes sortes de biens. Les cartes de crédit étaient inconnues et l'incitation à la consommation ne bénéficiait pas de la pléthore des moyens de publicité que nous connaissons.
Alors? Le coût de la vie, les statistiques gouvernementales en établissent périodiquement le niveau relatif. Pour chacun, selon sa situation personnelle, ces fluctuations sont plus ou moins ressenties. C'était comme ça, c'est comme ci. Tirez-en vos propres conclusions.

