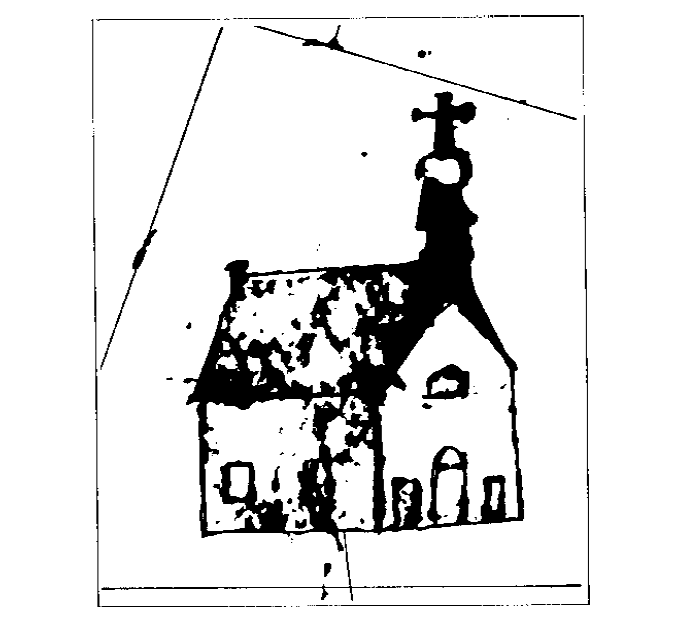Nous poursuivons ce mois-ci avec le deuxième article portant sur les églises de La Prairie. Comme nous l'expliquions dans l'article précédent (septembre), il s'agit d'un extrait de la correspondance que la Société historique de La Prairie a échangée avec les étudiants de l'école La Magdeleine (La Prairie) dans le cadre du projet Dialogue avec l'histoire.
Aujourd'hui je vais te parler de la deuxième église de La Prairie qui a été construite en 1705. Comme je l'avais dit dans ma dernière lettre, la première église était de bois. En 1702, la pourriture avait déjà commencé à faire son œuvre. De plus, suite au traité de paix signé avec les Iroquois en 1701, de plus en plus de colons venaient s'établir à La Prairie. La vieille église était devenue trop petite, il fallait en construire une nouvelle.
Cette nouvelle église sera faite en pierre. A partir du 18e siècle, on commença de plus en plus à construire les églises dans ce matériau en Nouvelle-France. Elles pouvaient ainsi mieux affronter les rigueurs de notre climat et être moins sujettes aux incendies. On fit appel à Gilbert Maillet, un maçon de Montréal, pour la conception et la construction de l'église. Malheureusement, on n’a aucun plan de celle-ci. Ceci est peut-être dû à la coutume de l'époque qui voulait que le maître maçon soit à la fois l'architecte et l'entrepreneur. Il construisait donc à partir de modèles déjà établis sans avoir recours à des plans. Avec l'aide des habitants de La Prairie, M. Maillet construisit une église rectangulaire de 80 pieds de long par 30 pieds de large avec une élévation de 20 pieds. La façade présentait un œil-de-bœuf (fenêtre ronde) et deux portes. Les murs étaient épais et percés de quatre fenêtres. L'intérieur était modeste, un plancher de bois, des murs crépis et blanchis à la chaux. Au début, la toiture était recouverte de bardeaux. Un siècle plus tard, le bardeau sera remplacé par le fer blanc à cause des risques d'incendie. Les premières années, les fenêtres furent couvertes de papier ciré. Une pratique courante à l'époque car la vitre était rare. C'est pourquoi les contrevents ou volets de planches s'imposent pour fermer les fenêtres. Toutefois, le curé Gaschier fera don de 500 carreaux de vitre après 1708. On ne sait pas si l’église avait un clocher les premières années. Un document de 1713 parle de dépenses importantes relatives au clocher. On ne sait si c'est pour la construction d'un premier clocher ou pour la réparation de l'ancien. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a un à partir de cette date. L'alignement de cette seconde église est différent de la première, en ce que la façade regarde vers le fleuve. Elle est donc perpendiculaire avec l'église actuelle.
L'église sera réparée et agrandie à plusieurs reprises. En 1725, on ajoute deux chapelles latérales (chapelles Saint-François-Xavier et du Rosaire) ainsi qu'une abside semi-circulaire où se retrouvera le chœur. On passe donc d'une église rectangulaire à une église ayant la forme d'une croix latine, un modèle de plus en plus populaire au 18e siècle. De plus, une sacristie attachée à l'abside viendra compléter le tout. En 1774, l'ajout de bas-côtés de part et d'autre redonne une forme rectangulaire à l’église. Une tour pour le clocher sera ajoutée en façade en 1784. Enfin, une nouvelle sacristie viendra s'additionner à l'ancienne en 1813. Finalement, l'église sera démolie en 1840 pour faire place à la troisième, celle qu'on peut voir encore de nos jours.