Quand, en janvier 1998, Jean-Paul Brossard est chassé de sa vieille maison ancestrale du chemin des Prairies par la crise du verglas, il quitte à regret le seul endroit où il a vécu et où cinq générations de la famille Brossard se sont succédé depuis la construction de la maison à la fin du XVIIIe siècle. Alors âgé de 84 ans, resté seul après le décès de ses sœurs Yvonne et Annette, il se résigne à loger dans une résidence pour personnes âgées située à La Prairie.

Malgré tout, il garde l’espoir de retourner vivre dans sa maison natale. Avec sa voiture, il vient chaque jour visiter les lieux et entreprendre quelques travaux d’entretien. Des obstacles majeurs s’opposent à son retour. À l’intérieur de la maison, les services sanitaires sont déficients. Il n’y a pas d’eau courante, et par conséquent, ni toilette ni salle de bain. Le système de chauffage se limite à une chaudière au charbon et à un poêle à bois tandis que l’éclairage électrique est rudimentaire. Maison Brossard et son annexe, Claude Sauvageau, architecte, le 20 mars 2007. Le peu de confort moderne apporté à la maison Brossard a certes préservé son cachet d’authenticité et un mode de vie ancien. Cette époque étant révolue, il faut se résoudre à restaurer l’habitation et l’adapter au temps présent tout en respectant ses éléments architecturaux anciens.

C’est dans ce but que Jean-Paul Brossard demande à son cousin, Robert Brossard, son mandataire et futur héritier de la maison paternelle, d’évaluer la possibilité d’entreprendre quelques travaux de rénovation. Conscient de l’ampleur de la tâche et désirant respecter le caractère unique du bâtiment, Robert Brossard fait appel à la firme d’architectes Fournier Gersovitz Moss et associés de Montréal, connue pour son expertise en conservation du patrimoine.Dossier Cour Supérieure No. 505-17-002294-058, Brossard c. Brossard (Succession de)
« The house is a treasure »
À l’été 1998, les démarches visant l’évaluation et la description de l’état de conservation de la maison s’amorcent et se poursuivent jusqu’en 2002. Au printemps 2001, l’architecte Julia Gersovitz effectue une visite de la maison ancestrale en présence du propriétaire, Jean-Paul Brossard, et de son cousin, Robert Brossard. Ayant participé au sauvetage de la maison Hurtubise à Westmount et de la maison Beaudry à Pointe-aux-Trembles, Julia Gersovitz est grandement impressionnée par les qualités architecturales du bâtiment et son état de conservation tout à fait remarquable.
« It was a most remarkable experience, and of course demonstrated more graphically than any words why the house is a treasure, and why you wish to protect it, as your family has done the past 3 centuries »Lettre de Julia Gersovitz, architecte, à Robert Brossard, le 2 juillet 2001. Dossier Cour Supérieure précité.
Un compte rendu des relevés extérieur et intérieur de la propriété accompagnés de plans et d’une liste des « interventions prioritaires requises pour maintenir l’intégrité de l’enveloppe et de la structure du bâtiment » sont acheminés à Robert Brossard en juillet 2002. Il fallait d’abord réparer la maçonnerie extérieure et intérieure, les parties hors toit des cheminées, la couverture ainsi que les portes et fenêtres.Fournier Gersovitz Moss architectes et associés, Maison Brossard, Brossard. Compte-rendu du relevé extérieur, 3 janvier 2002. Compte-rendu du relevé intérieur, 18 juillet 2002.
Cette première étape d’une restauration renseigne sur les différentes caractéristiques de l’habitation. Construite dans le dernier quart du XVIIIe siècle, la maison Brossard représente, tout comme ses voisines du chemin des Prairies, la maison Banlier et la maison Sénécal, un modèle d’architecture rurale d’esprit français qui s’est adapté à son milieu.
« La maison française devient québécoise parce qu’elle remporte une victoire sur l’hiver en faisant un usage intelligent et nouveau des matériaux locaux, en améliorant les techniques de chauffage et aussi en modifiant différentes parties structurales de l’habitat pour mieux affronter les éléments. »Lessard, Michel. Marquis, Huguette. Encyclopédie de la maison québécoise : trois siècles d’habitation. Montréal, Les éditions de l’Homme, 1972. p.254.
On apprend que la maçonnerie du bâtiment principal est composée de pierre des champs grossièrement équarries provenant du voisinage immédiat. Après 250 ans, les murs extérieurs d’une épaisseur moyenne de plus ou moins 30 pouces, ont conservé leur aplomb et « … portent la charpente de gros bois d’œuvre des planchers et du toit dont l’assemblage est à tenons, mortaises et chevilles. »

Les ouvertures des deux âtres situées dans le salon et la cuisine sont maintenant fermées et recouvertes d’un panneau de bois. Au rez-de-chaussée, on note la présence d’armoires encastrées dans la muraille, alors qu’à l’étage, une échelle de meunier à limons français donne accès aux combles. Les fondations de la cuisine d’été ont tout probablement intégré une certaine quantité de pierre des champs provenant des ouvertures faites dans le bâtiment principal lors de la construction de l’annexe au courant du XIXe siècle.Fournier Gersovitz Moss architectes et associés, Maison Brossard. Compte-rendu précité.
Les travaux pouvant débuter à l’automne 2002, la firme s’est déjà assuré de la disponibilité d’un maçon réputé pour son expertise dans la réfection de la pierre ainsi que d’un artisan spécialiste de la restauration des fenêtres anciennes.Fournier Gersovitz Moss architectes et associés. Maison Brossard, Brossard. Estimation préliminaire et honoraires, le 27 septembre 2002, p.3.
Mais le décès de Jean-Paul Brossard au CHSLD de La Prairie le 13 avril 2002 et une poursuite judiciaire liée aux clauses testamentaires du défunt mettent un frein au projet de restauration et de réaména-gement de la maison Brossard. Au cours du procès, soit en mars 2007, la firme Claude Sauvageau, architecte, soumet en contre-expertise un rapport contenant des esquisses de réaménagement qui visent à rendre la maison habitable.Maison Brossard et son annexe, rapport de l’architecte Claude Sauvageau, le 20 mars 2007.
Malgré le règlement du litige en 2011 et l’offre de services de professionnels de la restauration, aucun travail majeur de rénovation n’est entrepris. La maison bénéficie tout de même d’un chauffage d’appoint permettant d’éviter un endommagement par le gel. Un système d’alarme est en place, mais le responsable de la propriété a dû récemment placarder portes et fenêtres afin de contrer les intrusions.
Déjà en mars 2000, des citoyens s’inquiètent de l’état des lieux et adressent au ministère de la Culture et des Communications ainsi qu’à la ville de Brossard une requête visant à obtenir la sauvegarde de la plus vieille habitation de la ville.
L’intervention ayant eu peu d’effet, nous verrons plus loin le résultat de l’action citoyenne d’un nouveau comité mis en place en 2014.
Localisation du site et de la maison
La maison Brossard est située au 4240, chemin des Prairies à Brossard. Le lot actuel, de forme irrégulière, possède une superficie de 15 928,2 mètres carrés et porte, depuis la rénovation cadastrale, le numéro 4 223 089 de la circonscription foncière de La Prairie du cadastre du Québec. Sur le même emplacement se trouvent une laiterie en pierre, une grange, un garage construit au milieu des années 1930 ainsi qu’une bâtisse ayant servi de poulailler derrière laquelle il y a un appentis faisant office de latrines.
Des projets résidentiels se sont récemment développés à l’arrière et du côté sud-est de la maison, bornée en front par le chemin des Prairies et d’un côté, à l’ouest, par la voie ferrée du CN. La vaste étendue du terrain et un couvert végétal constitué d’arbres centenaires et d’arbustes feuillus évitent une trop grande rupture avec le voisinage immédiat et mettent en valeur la maison et ses dépendances. L’habitat conserve ainsi un environnement qui rappelle l’ancienne vocation agricole du lieu. En plus de la laiterie, de la grange et du poulailler, cette habitation rurale traditionnelle comportait autrefois plusieurs bâtiments, la plupart situés à l’arrière de la maison.
1950 : des personnalités visitent la maison Brossard
Pionnier du patrimoine, Gérard Morisset entreprend de 1937 à 1968 le grand projet d’inventaire du patrimoine artistique et architectural du Québec. Il fait le tour du Québec à la découverte des œuvres d’art anciennes et met en lumière les trésors de notre architecture. Ses relevés photographiques sont reconnus parmi les exemples les plus représentatifs de cet inventaire.BAnQ Trois-Rivières. Inventaire des œuvres d’art (IOA).- 1937-1970 cote : ZA235
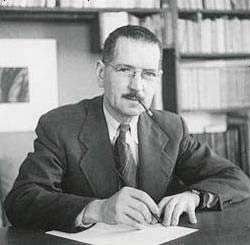
Au printemps 1950, Gérard Morisset se promène dans la région de La Prairie. Sur le chemin des Prairies, il s’arrête devant la maison Brossard et prend des clichés qui montrent le cadre ancien du site. Granges et remises se profilent à l’arrière-plan. Les contrevents attendent d’être fixés aux cadres des fenêtres alors que deux chemins d’accès traversent une pelouse ombragée. Le vieux carré de pierre se dresse au centre, en parfaite harmonie avec son environnement.BAnQ Québec. La Prairie, La Prairie. Maisons. Habitation au sud du boulevard Taschereau près du pont de la petite rivière de Montréal/ Gérard Morisset.- 1950. Cote E6,S8,SS1,SSS874.
Quelques mois plus tard, soit à l’été 1950, la photographe new-yorkaise Lida Moser parcourt le Québec en vue d’un reportage pour le magazine américain Vogue.
En compagnie de Paul Gouin, conseiller culturel du premier ministre Maurice Duplessis, de Luc Lacourcière, ethnologue et historien, ainsi que de l’abbé Félix-Antoine Savard, auteur de Menaud, maître-draveur, elle fixe sur la pellicule plus de 1500 photos sur une période de deux mois constituant ainsi un documentaire unique sur le Québec rural des années 1950.


à l’été 1950.
À son retour à Montréal, elle est l’invitée de l’historien de l’art, ethnologue et réalisateur Jean Palardy, qui publiera en 1963 son volume de référence, Les meubles anciens du Canada français. À cette époque, selon l’index rédigé par Lida Moser, Jean Palardy et sa compagne Jori Smith habitent à La Prairie. Avec ses hôtes, elle visite Alexandre Brossard et son fils Jean-Paul, « des voisins de Jean Palardy et Jori Smith à La Prairie. ».Bouchard, Anne-Marie. 1950 Le Québec de la photojournaliste américaine Lida Moser, Musée des beaux-arts du Québec, Les Publications du Québec, 2015, p.114
Moser produit alors une suite photographique sur la maison Brossard et ses occupants. Nous voyons Alexandre Brossard et son fils Jean-Paul posant fièrement devant leur maison, Jean Palardy et Alexandre Brossard assis dans la cuisine d’été, la laiterie de pierre derrière laquelle on aperçoit le verger. Les clichés se retrouvent maintenant aux Archives nationales du Québec dans le Fonds Lida Moser.BAnQ-Québec. Fonds Lida Moser 1946-1990, cote P728.

Grands personnages de l’histoire culturelle du Québec, Gérard Morisset, Jean Palardy et Lida Moser ont laissé un témoignage précieux sur l’aspect et l’aménagement du site et de la maison Brossard au début des années 1950. Bientôt, l’établissement d’une nouvelle ville en 1958 sonnera le glas de la vocation agricole du chemin des Prairies et le caractère historique et champêtre du lieu sera irrémédiablement transformé par le prolongement de l’autoroute 30 en 1996.
Historique
À l’origine, l’emplacement sur lequel est érigé la maison Brossard fait partie de la Seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine. Les premiers colons s’établissent d’abord sur les rives de la rivière St-Jacques où se trouvent des prairies naturelles plus faciles à exploiter. Ainsi, à la fin de l’année 1672, le terrier de la seigneurie fait mention de 14 contrats de concession concédés aux censitaires sur le front de la rive droite de la rivière Saint-Jacques. (rive bornant l’actuelle ville de Brossard)Lacroix, Yvon. Les origines de La Prairie, 1667-1697, Montréal, Bellarmin, 1981. P.174 On désignera le secteur du nom de côte des Prairies, inspiré tout probablement par la topographie.

Une donation des Bisaillon
Le premier occupant du terrain sur lequel sera construite la maison Brossard est François Bisaillon, fils d’Étienne.
Établi sur le terrier 13, en bordure de la rivière St-Jacques, il a « maison, grange étable et quinze arpents de terre labourable. »Aveu et dénombrement du Père Dablon pour la seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine, le 4 mars 1723, Fonds Biens des Jésuites, BAnQ-Q.
En 1717, les seigneurs Jésuites ouvrent un deuxième rang à la colonisation et concèdent à François Bisaillon (1686-1749) une continuation de sa terre du premier rang, soit 2 arpents de front sur 20 arpents de profondeur « en bois debout », qu’il doit défricher et ensemencer.25 juin 1717, notaire Guillaume Barette. Concession d’une continuation de terre à François Bisaillon. BAnQ-M
Ce prolongement du terrier 13 deviendra le futur site de la maison Brossard.
Le chemin des Prairies s’amorce alors entre le premier et le deuxième rang, mais ce n’est qu’en 1754 que le sous-grand voyer, Paul Jourdain dit Labrosse, confirme la ligne du tracé dans un procès-verbal daté du 14 septembre 1754.Cité dans notaire Pierre Lalanne, 21 juin 1780. Procès verbal du chemin de l’Ange-Gardien-BAnQ-M acte no. 2112 et dans notaire Pierre Lalanne, 31 mai 1782. Procès verbal du chemin entre la première et deuxième concession du nord-est de la Rivière St-Jacques (des Prairies). Fonds Élisée Choquet, no 3.151, SHLM.
François Bisaillon s’est marié à La Prairie le 23 novembre 1711 avec Marie-Anne Moquin, fille de Mathurin. Mais à l’aube de la soixantaine, « n’ayant aucun enfant issus de leur mariage pour les secourir dans leurs besoins », le couple va utiliser la donation entre vifs comme l’un des moyens pour assurer son bien-être et la transmission de ses biens.
Et c’est « … en reconnaissance des bons services peine et soin que les dits donataires ont apporté de leur propre personne depuis les années précédant…… » que le 17 avril 1743, devant le notaire Guillaume Barette, François Bisaillon et Marie-Anne Moquin vont céder à Claude Brossard et Marie Marguerite Bisaillon, nièce de François, le lopin de terre concédé par les seigneurs Jésuites en 1717.17 avril 1743, notaire Guillaume Barette. Donation d’une terre par François Bisaillon et Marianne Moquin. BAnQ-M
L’acte de donation de 1743 pose donc les assises de la présence de la famille Brossard sur la terre qui sera transmise de père en fils jusqu’à l’aube du XXIe siècle.
La famille Brossard
Claude Brossard est le premier de la lignée à occuper le site où s’élève actuellement la maison Brossard. Né à Montréal le 8 avril 1711, il est le petit-fils d’Urbain Brossard, maître maçon de Montréal venu en Nouvelle-France avec la grande recrue de 1653. Sa présence dans la seigneurie de La Prairie est confirmée par un contrat de mariage passé à l’étude du notaire Guillaume Barette le 15 mai 1740. La future épouse de 22 ans, Marie Marguerite Bisaillon, est la fille de Claude Bisaillon et de Marguerite Marie Ste-Marie, de la paroisse de La Prairie. Le mariage est célébré le lendemain à l’église de La Prairie.Sur le prolongement de terre donné par François Bisaillon, Claude Brossard construira une maison de pieux sur pieux de 30 pieds de long sur 26 pieds de large pour loger sa famille.22 mai 1765, notaire Joseph Lalanne. Inventaire des biens de la communauté de Claude Brossard, veuf de Marie-Marguerite Bisaillon. BAnQ-M
Marie Marguerite Bisaillon s’éteint le 18 février 1764 à l’âge de 45 ans et laisse neuf enfants survivants, dont Paul, qui est à l’origine de la lignée du maire fondateur de la ville de Brossard, Georges-Henri Brossard. Le cadet Louis deviendra l’héritier de la terre paternelle et le bâtisseur de la maison de pierre, l’actuelle maison Brossard.
De la maison de pieux sur pieux à la maison de pierre
Louis Brossard (1760-1829) et Marie Josephe Brosseau (1767-1803) se sont unis à l’église de La Prairie le 16 février 1784. Le même jour, Claude Brossard profite du mariage de son fils pour lui céder la terre donnée par François Bisaillon, maintenant composée d’une superficie de 2 arpents 1/2 sur 25 arpents de profondeur où est érigée la maison de pieux sur pieux ainsi que les bâtiments.16 février 1784, notaire Pierre Lalanne. Division de biens immobiliers situés à la deuxième concession du nord-est de la rivière St-Jacques. BAnQ-M.
Cette terre sera désignée sous le numéro 18 dans le cadastre abrégé de la Seigneurie de Laprairie de la Madeleine et, à partir de 1867, elle portera le numéro 228 de la Paroisse de Laprairie de la Madeleine.
À la suite du décès de Marie Josephe Brosseau, le 1er mars 1803, Louis Brossard obtient la tutelle de ses enfants et convoque le notaire Théophile Pinsonaut pour la rédaction de l’inventaire des biens qui ont été communs entre les époux. Le 4 avril 1804, à 9 heures du matin, le notaire se rend à la maison du dit Louis Brossard « agriculteur demeurant en la Paroisse Laprairie la Madeleine ». Avec l’aide des estimateurs, Pierre Lefebvre et Pierre Poupard, le notaire procède à l’évaluation des biens meubles et immeubles, des agrès d’agriculture, des bestiaux, des titres papier, de l’argent monnayé et des dettes.4 avril 1804, notaire Théophile Pinsonaut. Inventaire des biens qui ont été communs entre Louis Brossard et Marie Josette Brosseau, BAnQ-M.
« Dans une maison en pierre située à la côte des Prairies appartenant au dit Louis Brossard s’est trouvé… »
Lors de cet inventaire des biens fait par le notaire Pinsonaut, le poêle de fonte à deux étages d’Angleterre et un devant de poêle de pierre de taille sont prisés 234 livres. Le cheptel à lui seul est évalué à 2376 livres. En 1804, Louis Brossard a accumulé un patrimoine foncier important constitué de six terres à la côte des Prairies, deux terres à la côte voisine de l’Ange-Gardien et d’une terre à bois à la côte Sainte-Catherine.
À la page 29 de l’inventaire, sous l’item impenses et améliorations, le notaire Pinsonaut donne une description précise de la maison et mentionne les dimensions, le nombre de cheminées, les divisions ainsi que la couleur des murs. Il spécifie surtout la date de construction : « faite durant la dite communauté », soit entre les années 1784 et 1803, ce qui représente la durée du mariage de Louis Brossard et de Marie Josephe Brosseau.
Nous reproduisons le texte de l’inventaire, feuillet 29.
Savoir :
Primo, une maison en pierres de trente quatre pieds de longueur sur trente deux de largeur couverte en bardeaux avec deux cheminées, planchers haut et bas en madriers embouffetés, garnis de ses croisées et portes vitrées et ferrées divisée en quatre appartements par cloisons et portes peintes en bleu et jaune
Faite durant la dite communauté, prisée quatre milles francs, sur laquelle somme il faut déduire celle de trois cent livres qu’a effectué la vente d’une maison en bois qu’il y avait sur la dite terre lors de la construction de celle en pierres sus dite, dont le prix a été employé à payer les frais de cette dernière.»4 avril 1804, notaire Théophile Pinsonaut précité.
La date de construction de la maison Brossard se situe donc dans le dernier quart du XVIIIe siècle.
Au cours de ces années, Marie Josephe Brosseau a donné naissance à treize enfants dont six seulement atteindront l’âge adulte. Étant devenu prospère, Louis Brossard érigera à l’aide des artisans du lieu une maison de pierre solide et spacieuse qu’il pourra transmettre à ses enfants.
Bâti pour durer des siècles, le bâtiment témoigne désormais de l’histoire d’une famille pionnière qui a donné son nom à la municipalité de Brossard.
Un statut patrimonial pour la maison Brossard
Depuis 2014, un groupe de citoyens se mobilise afin d’inciter les différentes instances gouvernementales à se porter au secours de la maison Brossard. Au début janvier 2015, une demande de citation est acheminée à la Ville de Brossard. La Ville donne suite en commandant une étude patrimoniale auprès de la firme Bergeron Gagnon Inc. Entre-temps, soit en novembre 2015, une demande de classement est également transmise au ministère de la Culture et des Communications. Au printemps 2016, les intervenants du ministère demandent la permission au propriétaire actuel de visiter le site et l’intérieur de la maison Brossard. Ne s’opposant pas a priori à une éventuelle reconnaissance patrimoniale du lieu, le propriétaire
préfère remettre la rencontre. Il veut d’abord obtenir l’approbation d’un plan d’aménagement qui autorise le lotissement de la portion de terrain située à l’arrière de la maison ancestrale.
Cette éventualité n’est pas sans susciter une réelle préoccupation puisque l’habitation serait amputée d’une partie de son environnement naturel en plus d’entraîner le déménagement ou la démolition de la laiterie de pierre.Ville de Brossard, Direction du génie. Projet terrain Brossard, des Prairies, numéro de plan 16Gr357, Feuille T3, 29-03-2016.
Inoccupée depuis 1998, la survie de la maison Brossard n’est pas assurée. Il est donc urgent que la ville de Brossard et le ministère de la Culture et des Communications arrivent à une entente avec le propriétaire de la maison Brossard et qu’un plan d’action soit mis en place afin d’assurer la sauvegarde et la restauration de ce témoin exceptionnel de notre patrimoine architectural.





