
- Au jour le jour, mai 1997
Létourneau ou L’Estourneau
|
Élisabeth, Virginie et Flavie |
|
|
|
Michel Létourneau Francine Langlois |
La Visitation de Notre-Dame de Château-Richer 02 septembre 1994 |
Richard Langlois Claire Lauzon |
|
Gilles Létourneau Berthe Riendau |
Saint-Zotique de Montréal 18 octobre 1947 |
Léopold Riendeau Bertha Legris |
|
Elzéar Létourneau Marie-Lucrèce Esméralda-Lefebvre |
Saint-Constant, cté de La Prairie 13 février 1893 |
Isaïe Lefebvre Marie Alaire |
|
Siméon Létourneau Marie-Réa Cardinal |
Saint-Constant, cté de La Prairie 10 octobre 1865 |
Solime Cardinal Marie Trudeau |
|
Hubert Létourneau Marguerite Laslin |
Saint-Constant, cté de La Prairie 6 octobre 1834 |
Jean-François Régia-Lasselin Joseph Lanctôt |
|
Joseph Létourneau Dorothée Dupuis |
Saint-Constant, cté de La Prairie 27 octobre 1809 |
Jean-Baptiste Dupuis Charlotte Saurel |
|
Michel Létourneau Marie-Anne Desbois |
La Nativité de La Prairie 17 juin 1782 |
François Desbois Marie-Anne Monelle |
|
Joseph Létourneau Marie-Angélique Bouteillier |
Saint-Antoine de Padoue, Longueuil 13 janvier 1738 |
Antoine Bouteiller Marie-Louise Goyau |
|
Bernard Létourneau Hélène Paquet ou Pasquier |
Saint-François de l’Île d’Orléans 31 juillet 1703 |
René Paquet ou Pasquier Hélène Lemieux |
|
David Létourneau Françoise Chapelain |
Château-Richer 6 juin 1664 |
Louis Chapelain Françoise Dechaux |
|
David Létourneau Sébastienne Guéry |
David est de Muron, arrondissement de Rochefort, évêché de Saintes, Saintonge (Charente-Maritime) France. |
Sébastienne (n’est pas venue au Canada) |

- Au jour le jour, mai 1997
Généalogie de la famille Létourneau
L’ancêtre David L’Étourneau, originaire de Muron, arrondissement de Rochefort, en Saintonge, marié à Sébastienne Guéry a eu trois enfants : une fille, Marie, et deux fils, David et Jean. Après le décès de Sébastienne, David se marie en 1654, en deuxièmes noces, à Jeanne Baril, qui lui donne deux autres enfants. On ne sait pas exactement pourquoi David s’embarqua sur un navire (peut-être le Taureau) en partance pour la Nouvelle-France en mai 1658. Il est accompagné de ses deux fils nés d’un premier mariage. En arrivant au pays, David et ses fils se mirent sans doute au service d’un fermier, à Château-Richer, semble-t-il. Cependant, personne n’a pu trouver leur contrat d’engagement pour 36 mois.
David mit tout en œuvre pour installer ses deux fils, nés du premier mariage, et préparer son foyer pour recevoir son épouse et ses autres enfants, Marie étant demeurée en France. David achète une terre en 1661 dans la paroisse Sainte-Famille à l’Île d’Orléans. Il semble s'être installé avec sa femme à Beauport dès 1665. David prit la charge du moulin à farine du seigneur Giffard puis celui de Château-Richer en 1667. David Létourneau mourut marchand-meunier "demeurant au moulin et à la ferme du Château-Richer" en 1670.
Michel Létourneau est né à Montréal (Ville Émard) en 1951. Il vit à Châteauguay depuis plusieurs années. Architecte de profession, il enseigne la restauration de bâtiments anciens dans un collège privé depuis 1990. Membre de la Société historique depuis 22 ans, Michel a contribué par ses recherches historiques à la déclaration de l'arrondissement historique de La Prairie. Il fut actif lors des fouilles archéologiques du site de l'ancienne Académie Saint-Joseph, et il a collaboré à la rédaction et à l'illustration du bulletin "Le Bastion" et à de nombreuses autres publications. Michel est actuellement très actif au sein de la Fondation Royal-Roussillon où il siège comme vice-président, et continue de promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de notre région.
En collaboration avec Yves Bellefleur, président de la fondation, il dirige actuellement l'important projet de restauration de l'ancien presbytère de Saint-Constant.

- Au jour le jour, avril 1997
Généalogie de la famille Girard
En 1666, les recenseurs notent la présence d’un certain Pierre Girard, qui est à l’emploi des Jésuites à Québec. Pierre épouse Suzanne Lavoie (De Lavoye) en mars 1669 à La Rochelle et reçoit durant la même année sa première concession de terre dans la seigneurie du Maure à Saint-Augustin avec droit de chasse et pêche. Pierre et Suzanne ne manquaient pas d’imagination pour augmenter leurs revenus. En effet, Suzanne, ne craignit pas d’héberger une petite pensionnaire, Madeleine Arrivée, qu’elle garda pendant trois ans, ce qui lui rapporta la somme de cent vingt livres. De son côté, Pierre trouva lui aussi le moyen de faire quelque argent dans le commerce. Il était maître d’une barque appelée “Le Samuel ”. Cette barque était assez considérable pour se rendre dans les Pays d’en haut. Les marchandises ordinaires étaient l’eau-de-vie et le tabac que Pierre allait échanger pour des pelleteries.
Après bien des démarches, Pierre Girard obtint une réduction sur les droits que les autorités du pays exigeaient sur ces marchandises. Cela lui permit sans doute d’augmenter ses revenus, de mettre moins d’eau dans son eau-de-vie, d’en réduire le prix et d’en vendre davantage. Il pratiqua aussi le métier de défricheur. Dans la même lignée que Pierre, Joseph, son cinquième petit-fils marié à Philomène Garceau, défriche lui aussi sa terre à Sainte-Perpétue de Nicolet. Joseph et Philomène ont élevé dix enfants. La famille conserve encore le souvenir d’un homme fort, un notable de la place qu’on consultait régulièrement et qui a été élu maire de sa paroisse. Philomène, elle, a été enseignante. De son vivant, Joseph a acquis plusieurs terres pour y établir tous ses enfants. Son fils Édouard a hérité de la terre paternelle, lieu où sont décédés Joseph et Philomène.
Édouard et Yvonne Alie ont eu douze enfants dont l’aîné des garçons a continué la tradition sur la terre paternelle. Il a été durant les années 1950 – 60 le plus gros éleveur de poulets au Québec. Les trois autres garçons ont complété leurs études universitaires et les filles se sont dirigées soit dans l’enseignement ou comme infirmières. Réjean a obtenu son diplôme en optométrie en 1963. Il a enseigné pendant huit ans et a pratiqué pendant trente cinq ans. Maintenant, Réjean est à sa pension, bien méritée, en compagnie de Thérèse (madame oiseaux) sa conjointe).
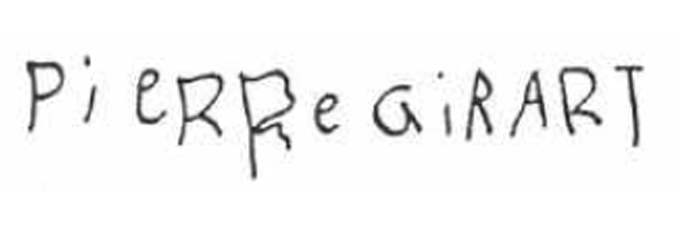

- Au jour le jour, avril 1997
Généalogie de Réjean Girard
|
Réjean Girard Thérèse Nadeau |
Maple Grove, cté de Beauharnois 18 septembre 1965 |
Joseph Nadeau Hélène Lamontagne |
|
Édouard Girard Yvonne Alie |
Sainte-Valérie, Trois-Rivières 06 juin 1922 |
Azilda Alie Salomée Dionne |
|
Joseph Girard Philomène Garceau |
Pointe-du-Lac, Trois-Rivières 12 février 1884 |
Edphrem Garceau Justine Lesieur-Desaulnier |
|
Pail Girard Marie-Dina Girard |
Saint-Grégoire de Nicolet 30 juillet 1850 |
Isidore Prince Julie Gagnon |
|
Michel Girard Marie Biron |
Pointe-du-Lac, Trois-Rivières 22 juin 1801 |
Biron |
|
Modeste Girard Marguerite Bellisle dit Lefebvre |
Trois-Rivières 20 novembre 1769 |
Antoine Bellisle dit Lefebvre Marie-Josephte Beaudoin |
|
Joseph Girard Marie-Anne Vanasse dit Précourt |
Trois-Rivières 25 février 1732 |
François Vanasse dit Précourt Marie-Josephte Le Jetty |
|
François Girard Antoinette Lemay |
Sainte-Croix de Lotbinière Mariés vers 1709 |
Michel Lemay Michelle Oinville |
|
Pierre Girard Suzanne de La Voye |
Notaire Rabusson de La Rochelle Contrat passé le 27 mars 1669 |
Suzanne était veuve de Jean Tesson décédé sans postérité |
|
Étienne Girard (laboureur) Marguerite Giboulleau |
Pierre est de la ville et arrondissement de Les Sables-D’olonne évêché de Luçon, Poitou, (Vendée) France |
|

- Au jour le jour, mars 1997
Généalogie de la famille Bourdages
Raymond Bourdages es1 l'ancêtre désigné des Bourdages et Bordage d'Amérique. Né vraisemblablement en 1728 dans la région de Saint-Jean d'Angoulême en Charente-Maritime, il est le fils de Pierre Bourdages et de Marie-Anne Chevalier mariés en Acadie en 1721. En 1756 Raymond épouse en Acadie Esther LeBlanc, fille du notaire René LeBlanc et de Élisabeth Melançon de Grand-Pré.
Raymond Bourdages vit en Acadie, à la rivière Saint-Jean, à titre de maître-chirurgien de la garnison du lieutenant Charles de Boishébert. Lors de la déportation, notre ancêtre reçoit l'ordre de ses supérieurs de se rendre à Québec où il habite jusqu'en 1755. En 1760, il effectue un voyage en France, probablement dans le but de régler une succession ou de recevoir sa pan d'héritage de ses parents. On ignore à quel moment il est de retour, mais on sait qu'en 1772 il accompagne à Bonaventure et à Carleton le Père de la Brosse, missionnaire du golfe Saint-Laurent.
C'est vers cette époque qu'il quitte Lorette et s'installe à Bonaventure (village fondé par des Acadiens ayant dû fuir l'Acadie au moment de la déportation) avec sa famille. Il y fut le premier marchand de l'endroit et y posséda des moulins à farine et à scie. Lors de son décès en 1787, survenu prématurément à l'âge de 59 ans, il y était le propriétaire de vastes domaines
En 1776, des corsaires américains en état de guerre vinrent à Bonaventure, firent prisonnier Raymond, incendièrent sa maison, son magasin, ses dépendances et les alentours. Le 22 mars 1779, seize Micmacs allèrent piller son établissement à Caraquet, enlevant pour 12 000 livres de marchandises, alléguant aussi le fait de guerre. Bien plus, trois concessionnaires anglais, les sieurs Holland, Collins et Finlay obtinrent de grandes étendues de terrain en Gaspésie, y compris les terres de Raymond Bourdages.
Raymond Bourdages eut onze enfants dont un fils, Louis, qui siéga à l'Assemblée législative à plusieurs reprises. Pendant plus de deux décennies, il y défendit avec vigueur les intérêts des Canadiens. Établi à Saint-Denis-sur-Richelieu en 1790 où il exerça la profession de notaire jusqu'à sa mort, Louis eut un fils, David, qui prit une part active à la rébellion des Patriotes de 1837.
Quoique peu nombreux, les descendants de Raymond Bourdages se retrouvent aujourd'hui principalement en Acadie, en Gaspésie et dans les régions de Québec et de Montréal, où partout ils affichent fièrement leur ascendance acadienne.
Gaétan Bourdages est né à Chandler (Baie des Chaleurs) le 23 décembre 1946. Il enseigne les sciences humaines au niveau secondaire depuis 1968. Membre de la société depuis 20 ans, il exerça de nombreux rôles dont celui de président. Il a collaboré à de nombreuses publications de la Société historique et continue de s'intéresser de près à la recherche et à la diffusion des connaissances en histoire.

- Au jour le jour, février 1997
Généalogie de la famille Desrosiers
La présence de l’ancêtre Antoine Desrosiers (1616-1691) en Nouvelle-France est attestée dès janvier 1642 alors qu’il agit comme parrain d’un amérindien à Sillery. On ne connaît pas ses parents mais lors de son mariage, il se dit «natif du bourg de Renaison au pays de Lyonnais».
Le Journal des Jésuites mentionne, en 1645, qu’Antoine est à l’emploi de ces missionnaires comme engagé et, qu’à ce titre, il reçoit un salaire annuel de 100 livres. Dans le cadre de cet engagement, Antoine participe à l’approvisionnement de la mission de Sainte-Marie-aux-Hurons sur les bords de la baie Georgienne. Le travail n’était pas sans danger et il aurait pu y laisser sa peau. En effet, le 16 août 1659, il est écrit dans le Journal des Jésuites que «Antoine des Rosiers s’était sauvé des mains des Onontageronons vers le lac Ontario et qu’il était arrivé aux Trois-Rivières.»
C’est aux Trois-Rivières qu’Antoine Desrosiers fonde sa famille, alors qu’il épouse le 24 novembre 1647 Anne Du Hérisson, fille de Michel Leneuf du Hérisson, un important et influent personnage arrivé depuis 1636. Anne est bien dotée par son père qui s’adonnait à la lucrative traite des fourrures. Elle apporte au ménage 500 livres, deux «honnêtes» habits, de la lingerie, de la vaisselle ainsi qu’une génisse et une truie en gestation. Après une première installation du couple sur une terre louée, Antoine bénéficie, le 28 octobre 1649, de la part du gouverneur d’Ailleboust, de la concession d’une terre de 20 arpents sur les bords de la rivière Saint-Maurice, à l’extérieur du bourg. En 1650, on lui octroie un emplacement dans le bourg même. En 1657, cette fois du gouverneur Pierre Boucher, Antoine reçoit une autre terre d’une superficie de 25 arpents, là où naîtra le village de la Pointe-du-Lac.
Le couple Antoine Desrosiers et Anne du Hérisson aura huit enfants, cinq garçons et trois filles. Quatre des garçons fondèrent des foyers dont Jean qui, en 1682, unit sa destinée à Marie-Françoise Dandonneau. Ils eurent dix enfants dont six fils. Des quatre fils de Jean et de Marie-Françoise qui fonderont des foyers, Michel, qui épousera Anne Moreau le 29 mai 1716 à Rimouski, est l’ancêtre de Arthur et Léandre Desrosiers qui, de la région du Bas-du-Fleuve vinrent s’établir à La Prairie à la fin du siècle dernier.
Antoine Desrosiers est décédé à Champlain en 1691. Son épouse, Anne du Hérisson, mourut en 1711.
Arthur Desrosiers, en 1895, n’ayant pu obtenir la permission d’épouser sa promise (Pacifique de Montigny), décide d’aller l’épouser à Montréal à la Paroisse du Sacré-Cœur le 30 octobre 1895. Il semble qu’ils ont dû traverser sur le pont de glace reliant St-Lambert à Montréal. Ils ont demeuré à Côte Ste-Catherine, la dernière terre touchant le territoire Mohawk de Caughnauwaga.

- Au jour le jour, février 1997
Desrosiers dit Du Tremble
|
Claire Desrosiers Jérôme Leroux |
Saint-Alphonse-d’Youville de Montréal 30 août 1952 |
Émile Leroux Béatrice Leduc |
|
Emmanuel Desrosiers Jeannette Brosseau |
Sacré-Cœur de Montréal Octobre 1927 |
Isidore Brosseau Ernestine Racine |
|
Arthur Desrosiers Pacifique de Montigny |
Montréal 30 octobre 1895 |
François de Montigny Claire Marotte dit Labonté |
|
Élie Desrosiers Praxède Caron |
Matane 14 juin 1860 |
Caron |
|
Joseph Desrosiers dit Du Tremble Maxellande Lepage de Molais |
Saint-Germain de Rimouski 16 janvier 1816 |
Charles Lepage de Molais Marie-Anne Hion |
|
Louis-Gabriel Desrosiers dit Du Tremble Geneviève Lepage de Molais |
Baie Saint-Paul 27 avril 1775 |
Antoine Lepage de Molais Marie Côté |
|
Louis Desrosiers dit Du Tremble Marie-Judith Guyon dit Després |
Saint-Germain de Rimouski 1754 |
Guy-Joseph Guyon dis Després Marie-Geneviève Gagné |
|
Michel Desrosiers dit Du Tremble Marie-Jeanne Moreau |
Saint-Germain de Rimouski 29 mai 1716 |
Jean-Baptiste Moreau Marie-Anne Rodrigue |
|
Jean Desrosiers dit Du Tremble Françoise Dandonneau dit Dandons |
Notre-Dame-de-la-Visitation de Champlain 20 janvier 1682 |
Pierre Dandonneau dit Dansons Françoise Jobin |
|
Antoine Desrosiers Anne Le Neuf du Hérisson |
Immaculée-Conception des Trois-Rivières 24 novembre 1647 |
Michel Le Neuf du Hérrison |
|
Deux origines sont possibles, selon Ferland il est de Renaison, arrondissement de Roanne, Forez (Loire) France. |
ou de Vernaison (selon Sulte) arrondissement et archevêché de Lyon, Lyonnais (Rhône) France |
|

- Au jour le jour, janvier 1997
Généalogie de la famille Joly
|
Jean Joly Claudette Locas |
Saint-Alphonse-d’Youville de Montréal 20 août 1966 |
Léo Locas Cécile Morency |
|
Éliodore Joly Claire Beauchesne |
Saint-Jean-Baptiste de Montréal 09 juin 1923 |
Charles Beauchesne Alexina Paré |
|
Wilfrid Joly Alphonsine Gauthier |
Saint-Augustin 15 mai 1899 |
Jean-Baptiste Gauthier Adélia Verdon |
|
François Joly Rose-Délima Labelle |
Sainte-Scholastique 07 novembre 1865 |
Pierre Labelle Victoire Pineau |
|
Paul Joly Marie-Adélaïde Ouellet |
Sainte-Scholastique 09 janvier 1832 |
Alexis Ouellet Suzanne Desnoyers |
|
Louis Joly Marie Desjardins |
Saint-Eustache 09 mai 1791 |
Jean Desjardins Josephte Vermette |
|
Jean-Baptiste Joly Angélique Valière |
Sainte-Rose 21 novembre 1768 |
Louis Vallière Angélique Morin |
|
Jean-Baptiste Joly Véronique Paris |
Terrebonne 06 juin 1735 |
François-Gilles Paris Catherine Mezeray |
|
Jacques dit Jean-Baptiste Joly Marie-Madeleine Poupeau |
Notre-Dame de Montréal 19 mars 1711 |
Vincent Poupeau Marie-Madeleine Barsa |
|
Nicolas Joly Françoise Hunault |
Notre-Dame de Montréal 09 décembre 1681 |
Toussaint Hunault Marie Lorgueil |
|
Jean Joly Marguerite Duquesne |
Nicolas est de Bosc-Guérard-Saint-Adrien, arrondissement et archevêché de Rouen, Normandie (Seine-Maritime) France |
Françoise, qui a eu 4 enfants avec Nicolas, se remarie en 1691 à Jean Charpentier, avec qui elle aura 11 autres enfants |

- Au jour le jour, janvier 1997
Généalogie de la famille Joly (suite)
Nicolas (I), fils de Jean et de Marguerite Duquesne de Bosc-Guérard-Saint-Adrien en Normandie, épouse Françoise Hunault, fille de Toussaint et de Marie Lorgueil, (tous deux de la recrue de 1653), le 9 décembre 1981, à Montréal. Françoise est canadienne; elle est baptisée à Montréal le 5 décembre 1667.
Nicolas est engagé chez Julien Bloys à Montréal en 1671. Depuis 1674, il cultive une terre située non loin du ruisseau Desroches, à Rivière-des-Prairies. Son fils, Pierre, a été le premier enfant baptisé figurant au registre de cette paroisse. Nicolas, lors du recensement de 1681, est âgé de 33 ans et possède un fusil et 11 arpents de terre en valeur.
Il a été tué par les Iroquois le 2 juillet 1690, lors de la bataille de la coulée Grou. À son décès, Nicolas laisse quatre enfants dont trois se marient par la suite : Marie- Françoise en 1699 avec Jacques Vaudry à Pointe-aux-Trembles, Jacques dit Jean-Baptiste (II) en 1711 avec Marie-Madeleine Poupart à Montréal et Nicolas en 1723 avec Marie Beaudet à Laprairie. Marguerite Duquesne, sa veuve, se remarie en 1691 à Jean Charpentier
Nicolas (II), fils de Nicolas (I), est baptisé à Pointe-aux-Trembles en 1686; on le retrouve à Laprairie vers 1723, marié à Marie Beaudet (ou Saint-Jean selon René Jetté). Nicolas reçoit en 1730 une commission d'huissier royal dans l'étendue des seigneuries de Laprairie de la Magdeleine et de Châteauguay. Nicolas est mort en 1774 à Saint-Philippe.
Louis Lavallée, dans son livre "La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760", le décrit comme l'un des plus remarquables cabaretiers de Laprairie et qualifie son auberge de l'un des hauts lieux de la sociabilité villageoise, sous le Régime français.
Jean Joly (X) est né à Montréal en 1943, marié à Claudette Locas, ils ont deux enfants : Claire et Yves. Jean est membre de la S.G.C.F. et de la S.H.L.M. Jean et sa famille demeurent dans la région depuis 1971 et il est à l'emploi de la commission scolaire du Goéland depuis 1968. Il a occupé un poste d'enseignant, puis de coordonnateur aux Services éducatifs depuis 1972, en 1996 M. Joly a été nommé Secrétaire général.

- Au jour le jour, décembre 1996
Généalogie de Pierre Sénécal
La famille Senécal
Jean Senécal, né le 20 septembre 1646 à Saint-Martin de Paluel en Normandie (Seine-Maritime), décédé à Montréal le 11 Février 1723, se marie à Catherine De Seine le 15 octobre 1672 à Montréal. Jean est domestique engagé de Charles d'Ailleboust à Montréal en 1666.
Dans les archives de notre société, dans le fond Élisée Choquet, nous constatons sur plusieurs générations l'implication marquée pour la vie paroissiale. Pierre (1731) marguillier, François (1788) marguiller, François (1818) marguillier en charge, Julien (1864) marguillier en charge et commissaire d'école. Nous avons aussi retracé un important personnage de la famille. L'Honorable Louis Adélard Senécal, né en 1829, décédé en 1887, fils de cultivateur, sans fortune et sans instruction, a su s'élever aux rôles les plus éminents dans les affaires comme dans la vie politique. En 1853, Louis Adélard achète le vaisseau Georges Fréderic pour faire le service entre Montréal et Sorel. Un peu plus tard, il en fait construire deux autres, le Yamaska et le Cygne. Il fait le commerce de bois et de grains avec les États-Unis À ce moment, il possédait onze bateaux à vapeur et quatre-vingt-neuf barges. Il a aussi possédé des scieries et des moulins à farine. Il a construit huit chemins de fer, et a été sommé surintendant général du Québec. Dans le but de créer de l'emploi pour ses concitoyens, il a perdu 400 000 $ dans une malheureuse transaction dans l'achat de limites de bois et des Moulins des Hall. Nommé principal directeur des élections générales du Québec, il a été appelé au Sénat par l'Honorable Joseph-Adolphe Chapleau. En 1882, le gouvernement français le décore de la croix de commandeur de la légion d'honneur. Louis-Adélard s'est fait élire député libéral dans Yamaska puis député conservateur dans Drummond / Arthabaska. Il quitte le gouvernement conservateur d'Ottawa sur la question Riel.
La maison Senécal, construite en 1799 par François (1788), existe toujours. Vous pouvez la voir sur le boulevard des Prairies à Brossard. Elle fut habitée pendant 173 ans de père en fils (six générations). Yves a vu le jour dans cette maison. Expropriée en 1972 pour le prolongement de l'autoroute 30, elle a été classée monument historique en 1975 et complètement rénovée en 1986.
Yves Senécal se marie le 10 juin 1961 à Suzanne Denault à La Prairie, ils ont trois enfants : Pierre, Sylvie, Julie et quatre petits-enfants : Cyndy, Martin, Maxime et Samuel. Yves a œuvré dans le domaine de la fonderie et a occupé plusieurs postes de direction. Aujourd'hui, Yves travaille avec son fils Pierre qui est propriétaire d'une firme d'équipement de manutention. Comme loisirs, Yves fait du bénevolat et, bien entendu, de la généalogie.
René Jolicoeur
Senécal
|
Pierre Senécal Monique Achim |
La Nativité de La Prairie 9 juillet 1961 |
Edgar Achim Nicole Lévesque |
|
Yves Senécal Suzanne Denault |
La Nativité de La Prairie 10 juin 1961 |
Wilfrid Denault Noella Crevier |
|
Arthur Senécal Alice Sainte-Marie |
Saint-Rémi de Napierreville 28 septembre 1938 |
Adélard Sainte-Marie Léona Meunier |
|
Jules Senécal Eudoxie Brosseau |
La Nativité de La Prairie 30 janvier 1900 |
Jérimie-Vital Brosseau Martine Senécal |
|
Julien Senécal Christine Surprenant |
Saint-Hubert 11 octobre 1864 |
Jean-Baptiste Surprenant Anastasie Racine |
|
François Senécal Marie-Louise Lefebvre |
La Nativité de La Prairie 5 octobre 1818 |
Toussaint Lefebvre Marie-Louise Lefebvre |
|
François Senécal Marie-Louise Sainte-Marie |
La Nativité de La Prairie 11 juillet 1788 |
Louis Sainte-Marie Marie Marcil |
|
François Senécal Josette Normandin |
La Nativité de La Prairie 1er février 1762 |
Joseph Normandin Marie-Anne Plamondon |
|
Pierre Senécal Suzanne Bourdeau |
La Nativité de La Prairie 10 juin 1731 |
Pierre Bourdeau ou Bordeau Marguerite Lefebvre |
|
Pierre Senécal Marguerite Pinsonneau dit Lafleur |
Notre-Dame de Montréal 4 novembre |
François Pinsonneau dit Lafleur Anne Le Ber |
|
Jean Senécal Catherine Desenne ou Deseine |
Notre-Dame de Montréal 15 octobre 1692 |
Pierre Desenne ou Deseine Marguerite Léger |
|
Martin Senécal Jeanne Lappert |
Le père de Jean est maître cordonnier de Saint-Martin de Paluel, arrondissement de Dieppe, archevêché de Rouen, Normandie (Seine-Maritime), France. |
Le père de Catherine est potier d’étain de Notre-Dame-du-Chemin, ville, arrondissement et évêché d’Orléans (Loiret), France. |

