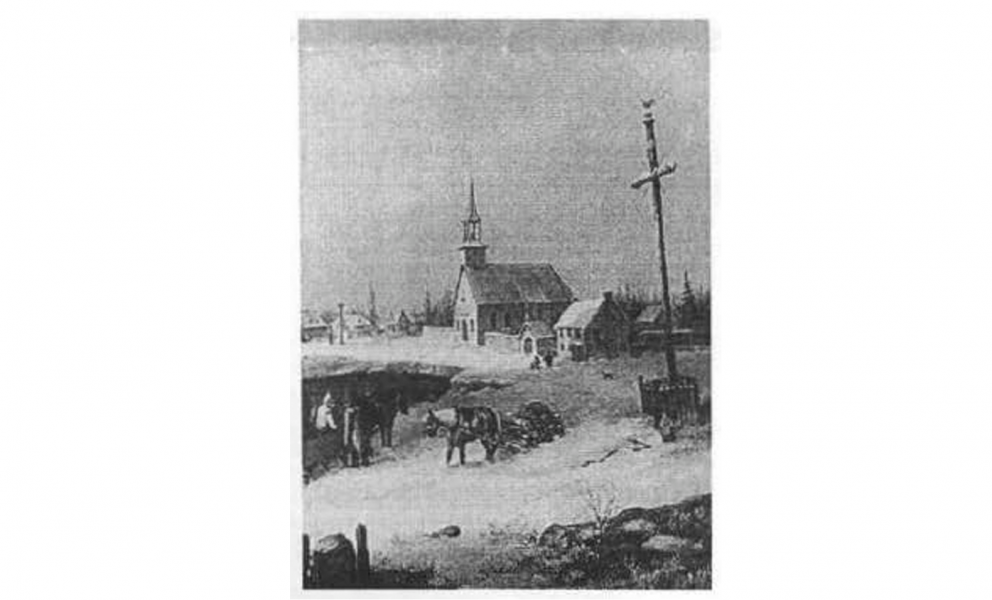
- Au jour le jour, septembre 1996
Jean L’Heureux sur Internet
Notre président M. Jean L'Heureux est devenu bien malgré lui une célébrité internationale depuis que son nom apparait sur internet. Pour s'en convaincre il suffit de consulter la liste des sociétés d'histoire membres de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec; l'internaute a accès à cette liste à travers le site de l'Association des archéologues du Québec. Mais attention, il est toujours possible d'accéder à cette information à travers d'autres sites ou web (www).
D'ailleurs il m'a suffi d'à peine quelques heures de navigation sur internet pour constater qu'il existe de l'information sur La Prairie disponible sous de nombreuses rubriques. En voici quelques exemples parmi plusieurs :
- Le CD Canadisk (http://www.schoolnet.carleton.ca/cdisk/) propose près de 2000 images sur l’histoire du Canada dont « Le premier train » par J. D. Kelly ou encore cette vue de Longueuil par Krieghoff que l’on retrouve dans cet article.
- Le CD E-Stat offre à travers le site CANSIM des tonnes de statistiques sur le Canada et il est donc possible d’y consulter et de télécharger des données sur La Prairie.
- Le site des Ressources naturelles du Canada, section Toponymes, propose également de l’information sommaire sur La Prairie.
- Le site « Francêtres : la page de généalogie du Québec! » fera l’envie de tous les généalogistes, particulièrement pour ses informations sur les premiers Acadiens. Ce site est en progression continuelle.
- Le site « 1775 : The French and Indian War », hélas uniquement en anglais, fournit la liste des noms de tous les soldats des régiments français venus combattre en Nouvelle-France entre 1755 et 1760. On y retrouve donc tous les soldats du régiment de Roussillon. L’auteur prépare la publication d’un volume qui contiendra des informations sur chacun de ces soldats et particulièrement sur ceux qui se sont installés ici après la guerre. Un site à surveiller de près…
Bien sûr la liste qui précède est loin d'être exhaustive et j'invite tous les membres de la société qui sont branchés sur internet à nous faire part de leurs découvertes. L'information abonde pour les amateurs d’histoire, de généalogie et d'archéologie. Les sites francophones intéressants se multiplient. N’oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger l'information offerte et choisir de la conserver sur disquette ou l'imprimer. Il est également possible de communiquer avec les auteurs des sites (la plupart réclament des commentaires) grâce au courrier électronique (E-mail) et ce quel que soit l'endroit où ils habitent sur la planète.
Je vous souhaite une excellente ballade à travers le réseau des réseaux.
Gaétan Bourdages

- Au jour le jour, septembre 1995
Le nom de Rousillon
Comme nous parlons du Royal-Roussillon dans la généalogie de ce mois-ci, nous vous présentons les résultats d'une recherche qui avait été faite il y a quelques années sur les origines du nom Rousillon.
Mentionnons d'abord que Rousillon est relié au nom d'un régiment français qui s'est illustré pendant la guerre de Sept Ans (1756-63), le Royal Rousillon, et dont le 2e bataillon s'est battu ici en Nouvelle-France.
À cette époque, l'empire colonial était très étendu puisqu'il englobait les Grands Lacs et même la Louisiane au sud. Il ne comptait pourtant que 75 000 Français qui étaient constamment menacés par 1 300 000 Anglais dans la Nouvelle-Angleterre. Le bataillon dut se déplacer souvent et faire face à des conditions pénibles à cause du climat, des grandes distances et des difficultés de ravitaillement.
Les soldats du Royal Rousillon étaient surtout chargés de la défense du sud du Québec actuel. Ils ont donc sillonné notre région dans tous les sens. Leurs quartiers d'hiver furent installés à La Prairie pendant quelques années. Le Royal Rousillon s'est illustré à la plupart des batailles qui se sont déroulées entre 1756 et 1760. Il a également participé à la guerre de la Conquête et a déployé ses énergies jusqu'à la bataille des Plaines d'Abraham. L'histoire mentionne que c'est le régiment dont le pourcentage de soldats tués fut le plus faible.
Ce régiment connut une existence assez longue et même contemporaine puisqu'il ne fut dissous qu'après la défaite française de 1940.
Le nom de Rousillon perpétuera donc la mémoire de ces défenseurs de la patrie qui ont évolué sur notre sol, dans notre coin de pays.
Tiré du journal Communic-Action, mars 1982, extrait de la conférence du 16 décembre 1981 de Gaétan Bourdages

- Au jour le jour, septembre 1994
Passé, présent et … à venir?
Nous sommes trois sur le site par un matin incertain de la mi-juillet; l'archéologue, un technicien en archéologie et moi-même. L'objectif de cette dernière journée d'activité sur le lot 94 (angle Sainte-Marie et Saint-Georges) est de procéder à trois sondages d'un mètre carré chacun en des points stratégiques sur les restes de la palissade.
Bien que l'empreinte des pieux soit visible en plusieurs endroits, le choix demeure ambigu car la palissade semble s'étirer dans toutes les directions à la fois. L'archéologue décide donc d'un premier sondage à l'angle du bastion, d'un second plus au nord et d'un troisième là où la ligne des pieux s'oriente vers la rue Sainte-Marie en direction du Vieux Marché.
Les travaux s'amorcent lentement, il nous faut y aller avec prudence et éviter de poser les pieds dans le réseau de rigoles imposé par un sol saturé d'eau. D'ailleurs nos travaux de drainage n'ont qu'un succès mitigé, car dès que nos truelles creusent à plus de 15 centimètres nous sommes forcés d'extraire à mains nues une boue sablonneuse et lourde qui laisse peu d'espoir à la découverte d'artefacts de petites dimensions. N'oublions pas que nous travaillons sur le sol originel à près de deux mètres sous le niveau actuel de la rue.
Malgré les difficultés du site les fouilles avancent et après quelques heures l'émotion est grande lorsque je réussis à dégager la base d'un second pieu en très bon état de conservation. Il me faut beaucoup de patience et de minutie avant de l'extraire complètement de sa gaine de boue. Les coups de hache y sont encore très visibles. Songez qu'après plus de trois siècles j'imagine nos ancêtres là devant moi, ahanant sous le soleil à creuser un fossé dans lequel ils enfoncent des pieux afin d'établir une enceinte qui assurera la sécurité du village naissant. Cette découverte représente pour moi un moment privilégié.
Enhardis par ces trouvailles, nous poursuivons les fouilles pendant une heure ou deux encore pour découvrir qu'à l'angle du bastion on solidifiait le fortin en entourant la base des pieux de mottes d'argile et pour constater que, pour notre malheur, le tracé de la palissade n'était pas aussi simple qu'il y paraissait et que cette dernière avait sans doute, au cours des ans, subi de nombreuses modifications.
Bien que faute de fonds, le site n'ait été que partiellement fouillé, la reprise des travaux de construction marquera la fin d'une source unique d'informations sur le passé de LaPrairie. Cela doit nous inciter à la vigilance dans le futur.
Gaétan Bourdages

- Au jour le jour, mai 1993
Les travaux de la maison
Ça discutait allègrement lors de la rencontre-conférence d’avril dernier. Certains, sans doute emportés par l’ardeur de leurs souvenirs, en oublièrent même les règles les plus élémentaires des échanges en groupe. Mais qu’importe, grâce au doigté de l’animateur on a réussi, tant bien que mal, à maintenir le cap sur «les travaux de la maison».
Le sujet est vaste. Au début de ce siècle les campagnes du Québec renfermaient des sociétés agricoles, où la tendance était à l’autarcie; c’est-à-dire que les gens cherchaient à se suffire à eux-mêmes et à produire le plus possible ce dont ils avaient besoin. Les cultivateurs achetaient et vendaient le moins possible à l’extérieur. Rien n’était perdu ou gaspillé. Il est même arrivé qu’on se servit d’un chien mort pour faire du savon. Courtepointes, catalognes et tapis étaient fabriqués de vieux tissus ou de paletots d’hommes.
L’habitant faisait preuve de beaucoup d’imagination dans l’art de conserver les aliments. On arrosait les quartiers de viande à plusieurs reprises, on laissait geler et on enterrait ça. D’autres descendaient la viande dans un puits, ou encore la salaient, en faisaient des conserves ou l’enfouissaient dans les carrés à grain. Chez certains la cuisine d’été servait de glacière durant l’hiver. La viande qu’on mangeait avait été élevée et tuée sur la ferme ou au village.
La vie villageoise et les travaux de la maison abondaient aussi en occasions de socialiser et de développer des solidarités. On fréquentait beaucoup la boulangerie, la boucherie et le magasin général. Le tricot et la broderie favorisaient l’échange des dernières nouvelles. Dans nombre d’évènements sociaux les boissons à la mode, toutes fabriquées à la maison (bières de riz ou de patate, vins de cerise, de gingembre, de pissenlit ou de rhubarbe, et sirop de framboises) avaient tôt fait de délier les langues des plus timides.
On ne craignait pas les étrangers. Les maisons étaient, à intervalles réguliers, visitées par des vendeurs itinérants qui offraient, qui des légumes, d’autres des viandes ou des vêtements. Les «quêteux» racontaient des histoires aux enfants avant de proposer certains services comme l’aiguisage des couteaux ou la réparation des chaudrons. Ils repartaient toujours l’estomac bien rempli.
Venez visiter l’exposition « Les travaux de la maison » cet été au Musée du Vieux Marché.

- Au jour le jour, janvier 1986
Éditorial – Un Bastion pour tout le monde?
Que cela plaise ou non, il faut bien l’admettre, malgré ses treize années d’existence et les multiples efforts de diffusion, à l’intérieur des limites de LaPrairie la Société historique reste peu ou pas connue. D’aucuns la perçoivent toujours comme une assemblée savante qui a su garder les curieux à distance. Et pourtant elle se meut, travaille fort et avance à petits pas incertains.
Que lui faut-il faire alors pour être plus et mieux connue et attirer les collaborateurs en plus grand nombre? Certains songent à ouvrir les portes du “Vieux marché” plus fréquemment, d’autres parlent d’une présence plus assidue dans les média régionaux, tandis que des groupuscules de nos membres s’épuisent dans des recherches sans intérêt pour le grand public. Ne vaudrait-il pas mieux savoir avec sagesse repartager les énergies et repenser nos actions à long terme? La recherche pure c’est bien honorable mais ce n’est certes pas le meilleur moyen de gagner l’appui de nos concitoyens. Et puis, soyons réalistes, nous sommes si peu nombreux à mettre l’épaule à la roue.
Pourtant il y va de notre survie que nous obtenions la sympathie du plus grand nombre. Pour y parvenir (i.e. changer notre image) les publications doivent se faire plus nombreuses, moins savantes et répondre aux attentes de ceux qui composent notre vraie clientèle : écoliers, résidents des quartiers neufs, gens d’affaires, avec bien sûr ceux qui étaient déjà là il y a plus de vingt ans.
Cessons donc de produire des travaux qui n’intéressent que quelques-uns de nos membres et demandons-nous sérieusement ce que le public attend d’une Société comme la nôtre. Devenons plus populaires sans être populistes. La toponymie, la petite histoire, les légendes et la généalogie ça peut intéresser beaucoup plus de monde à condition de savoir s’y prendre.
D’ailleurs un premier pas a déjà été fait en ce sens puisque depuis peu le Bastion et les autres cahiers de la Société sont présents à la bibliothèque municipale. Allez-y, n’hésitez pas, prenez un crayon et un bout de papier et écrivez quelque chose de votre histoire qu’il vous plairait de raconter simplement. Essayez et vous verrez que l’exercice n’est pas si difficile. Et c’est ainsi que peu à peu nous rendrons ensemble l’histoire plus séduisante.
Cette nouvelle attitude ne limiterait en rien la poursuite d’études plus savantes; elles demeurent tout de même l’un de rôles majeurs de notre groupe. Mais toute recherche ne doit-elle pas servir la diffusion? Mieux connaître notre histoire pour mieux la transmettre à nos concitoyens c’est faire œuvre de patriotisme et de culture. Et une production qui ne servirait qu’à garnir tablettes et classeurs serait peine perdue.
Bref profitons de l’attrait des fêtes de 150e anniversaire du premier train pour pénétrer dans tous les foyers de LaPrairie. Sachons écrire des choses que les gens souhaitent lire et vous verrez comme nous serons mieux appréciés de tous. Sous peu on viendra d’ailleurs prendre exemple ici.
N.L.D.R. Les propos qui précèdent n’engagent que leur signataire.

- Au jour le jour, janvier 1986
Les noms des lieux
Fontarabie
Les Pères Jésuites, seigneurs de la Seigneurie de LaPrairie, décident en février 1699 de l’ouverture d’une nouvelle côte : c’est Fontarabie. L’arpentage en est fait par Gédéon de Catalogne.
Il semble bien que ce range doive son nom à Pierre Legros dit Fontarabie, jeune soldat français du fort des Trois-Rivières. Accoutumé à la vie des “sauvages” et fidèle compagnon des Jésuites, Pierre Legros accompagnait souvent ces derniers dans leurs périples chez les amérindiens. Le 10 mai 1652 lui et le Père Jacques Buteux furent surpris, attaqués et tués par les Iroquois. Leurs corps furent par la suite dénudés et jetés à la rivière St-Maurice près de la chute de Shawinigan. Il est loisible de croire que les Jésuites aient décidé de laisser le nom de Fontarabie à une côte de leur seigneurie en souvenir de ce courageux compagnon mort avec l’un des leurs.
D’ailleurs les Ursulines de Trois-Rivières ont aussi donné ce nom à un rang dans la paroisse de Sainte-Ursule dans le comté de Maskinongé.
Rivière Saint-Jacques
Le 7 juin 1611, Champlain part en reconnaissance sur la rivière Saint-Jacques, “par où vont quelquefois les Sauvages à la guerre, qui va se rendre au sault de la rivière des Iroquois (riv. Richelieu)”; il la trouve “fort plaisante, y ayant plus de trois lieues de circuit de prairies et force terres qui se peuvent labourer”. Cependant, sur la carte de la région qu’il dresse à cette époque, Champlain désigne la rivière Saint-Jacques sous l’appellation de “petite rivière”. Deux hypothèses ont été retenues quant à l’origine du nom actuel : la première porte à croire que les Jésuites lui auraient donné le nom de Jacques de la Ferté, abbé de la Madeleine supposé donateur de la seigneurie. Or, il n'est pas du tout certain que Jacques de la Ferté soit le bienfaiteur des Jésuites, du moins en ce qui concerne LaPrairie.
La seconde hypothèse voudrait que ce soit Jacques Frémin s.j. qui ait laissé son nom au cours d’eau. Né à Reims le 12 mars 1628, il entre au noviciat de la Compagnie de Jésus à Paris le 21 novembre 1646 et se trouve à Québec dès 1655. L’année suivante, il est envoyé à Onnontagué et il servira au pays des Iroquois jusqu’à ce qu’il soit obligé en 1680 de se retirer à Québec à cause de nombreuses infirmités. Jacques Frémin est le second curé de la mission Saint-François-Xavier-des-Prés de LaPrairie, du 2 novembre 1671 au 20 juillet 1672. Or la première mention connue du nom de rivière Saint-Jacques apparaît dans un contrat du notaire Tissot en 1672 : est-ce suffisant pour croire en la seconde hypothèse?
Source des informations :
CHEVALIER, Joseph. Laprairie; notes historiques à l’occasion du centenaire de la consécration de l’église. Laprairie, 1941. Page 254.
ROCHEMONTEIX, Camille de. Les Jésuites et la Nouvelle-France. (au XVIIe s.). Letouzy et Ané, Editeurs. Paris, 1895. Tome II p. 406 note 2 et Tome III p. 365 note 5.
Candiac
Le nom de Candiac rappelle le domaine de Candiac où la famille de Montcalm possédait un château. Situé dans le Languedoc, cet endroit est le lieu de naissance du marquis de Montcalm.
La ville de Candiac est née le 31 janvier 1957 sur un domaine de 105 millions de pieds carrés acheté par la Candiac Development Corporation, société québécoise de placements et aménagements immobiliers. L’agglomération pourra recevoir 50 000 habitants et 400 acres seront réservés à l’industrie. Cependant, elle ne commencera vraiment à se développer qu’en 1959 et, en mars 1963, elle ne compte que 2 000 résidents. Aujourd’hui la ville peut s’enorgueillir d’un parc industriel bien garni et sa population dépasse les 8 500 habitants.
N.B. Une partie des informations qui précèdent est tirée de LA PRESSE du 22 novembre 1956.

- Au jour le jour, janvier 1986
Le chemin des sauvages
Il y a près de quatre siècle lorsque nos ancêtres colonisèrent ce coin de pays il était tout naturel que les fleuves et les rivières devinssent les principales voies de communication. Non seulement s’installa-t-on d’abord en bordure de cours d’eau, et ce pour des raisons pratiques fort compréhensibles, mais le Saint-Laurent et ses affluents accélérèrent grandement la pénétration du continent et le développement des échanges commerciaux avec les peuples autochtones.
Comme les premières agglomérations essaimèrent bientôt entre Québec et Montréal l’on dut bientôt songer à une route moins capricieuse et plus sûr que le fleuve. Ainsi le 13 mai 1665 le Conseil supérieur régla alors que “toutes les personnes qui avaient ou qui auraient des clôtures à faire sur le bord du fleuve devaient les mettre en sorte qu’il restât deux perches libres au-dessus des plus hautes marées pour la liberté tant du passage des charrettes et des bestiaux que de la navigation”. Ce chemin de deux perches de largeur, soit trente-six pieds français, fut le premier chemin du Roi de la colonie.
Nous ignorons depuis quand un chemin “semblable” existait sur la rive-sud entre Saint-Lambert et Laprairie. Nous savons par contre qu’envahie par les glaces en hiver, inondée à l’automne et au printemps et labourée par le passage des hommes et des bêtes; cette voie de terre dut souvent être impraticable. Ne l’avait-on pas baptisée avec mépris “le chemin des sauvages” ? Nul doute aussi que les amérindiens avaient dû emprunter ce passage longtemps avant la venue des Européens. De plus on devait y entretenir de nombreux ponts afin de franchir la rivière Saint-Jacques et une bonne douzaine de petits ruisseaux; sans compter cette partie basse appelée le “mouille-pied”.
Bien sûr la route était fort ancienne car les Surprenant, Moquin, Boyer, Racine et autres cultivateurs avaient pris soin depuis longtemps d’y ériger leurs demeures en bordure avec façade sur le fleuve. Et lorsqu’en 1912 on résolut, après trois ans d’hésitation, d’excommunier cette voie antique pour construire un boulevard convenable loin de la grève et de ses inconvénients, tous ces gens durent accepter que le “Chemin de la Côte Saint-Lambert” coupât maintenant leurs terres. Et qui plus est, soudain on verrait à quelque distance de la nouvelle route, non plus les jolies devantures, mais bien l’arrière des habitations. Quelques-unes de ces maisons (e.g. celle de M. Surprenant près du boulevard De Rome) témoignent encore, tristes reliques près du cher fleuve, du tracé du vieux “chemin des sauvages”.
Bref, chacun donnant gratuitement une largeur de cent pieds sur sa terre pour le passage du chemin nouveau, ce ralliement permit de mener à terme le projet. En plus d’ouvrir aux cultivateurs les marchés les plus avantageux, la nouvelle voie permettrait, aux dires de ses promoteurs, d’augmenter la valeur foncière et d’atteindre “un haut degré de développement social et industriel”. Ainsi jusqu’à la construction de la voie maritime (1959) et de l’autoroute actuelle, la route Édouard VII, depuis le pont Victoria, relia Saint-Lambert à Préville, la Côte Saint-Lambert (aujourd’hui Brossard), Laprairie, Saint-Philippe, Saint-Jacques le Mineur et Napierville.

Recherche : Héléna Doré-Désy
Texte : Gaétan Bourdages

- Au jour le jour, janvier 1986
Index des numéros précédents
LE BASTION VOL. 1 NO. 1, Janvier 1982, 16 pages
1,50$
Michel Létourneau : Architecture maison Lavallée-Pommainville.
Robert Mailhot et André Taillon : Le Royal-Roussillon.
Viateur Robert : Généalogie.
Gaétan Bourdages : Nos églises…
LE BASTION VOL. 1 NO. 2, Juillet 1982, 20 pages
1,50$
Michel Létourneau : Architecture maison Cuillerrier.
Gaétan Bourdages : Deux compagnies du Royal-Roussillon.
Gaétan Bourdages : Nos églises… (suite et fin).
Gaétan Bourdages : D’art en or (sur l’orfèvrerie à l’église de LaPrairie).
LE BASTION VOL. 1 NO. 3, Novembre 1982, 20 pages
1,50$
Jules Sawyer : Hommage au docteur André Barbeau.
Michel Létourneau : Architecture de la maison Lussier.
René Perron : Marguerite Bourgeoys.
Gaétan Bourdages : Trois compagnies du Royal-Roussillon.
Michel Létourneau et Gaétan Bourdages : Le zonage dans le vieux LaPrairie.
Gaétan Bourdages : La commune de LaPrairie.
LE BASTION VOL. 1 NO. 4, Février 1983, 28 pages
2,00$
Gaétan Bourdages : La culture : un service essentiel.
André Taillon : le Prix Thomas-Auguste Brisson.
Michel Létourneau : Histoire de l’Académie St-Joseph.
Gaétan Bourdages : le 10e anniversaire de la Société historique.
Gaétan Bourdages : Trois compagnies du Royal-Roussillon.
Gaétan Bourdages : Le dernier forgeron à LaPrairie.
André Taillon : Connais-tu LaPrairie?
Patricia McGee-Fontaine : Histoire du Fonds Élisée-Choquet.
Aussi : Outils généalogiques.
LE BASTION VOL. 2 NO. 1, juin 1983, 24 pages
2,00$
Jules Sawyer : Edme Henry.
Gaétan Bourdages: Quatre compagnies du Royal-Roussillon.
Patricia McGee-Fontaine : Histoire du Fonds Élisée-Choquet (suite).
Gaétan Bourdages : Outils généalogiques.
Michel Létourneau : Architecture de la “maison fortifiée”.
LE BASTION VOL. 2 NO. 2, décembre 1983, 36 pages
2,50$
Patricia McGee-Fontaine : Histoire du Fonds Élisée-Choquet (fin).
Anonyme : Un bedeau à LaPrairie il y a 150 ans ça travaillait fort.
Emmanuel Desrosiers : La punition de Dieu (légende sur L’île au Diable).
Michel Létourneau : Le moulin à vent de LaPrairie.
Gaétan Bourdages : L’île du Seigneur (toponymie).
LE BASTION VOL. 2 NO. 3, décembre 1984, 34 pages
2,50$
Gaétan Bourdages : le Canal de la Rive-sud et le Ruisseau de la Bataille (toponymie).
Michel Létourneau : Architecture de la maison Patenaude.
La Minerve : Le grand feu de Laprairie. (1846)
Emmanuel Desrosiers : Revenants (récit).
Ildège Brosseau : Dernière tranche de l’histoire des Communes de LaPrairie.
Relevé effectué par Gaétan Bourdages (directeur du BASTION) le 20 janvier 1986.

- Au jour le jour, décembre 1984
Le ruisseau de la bataille
Les “deux batailles” de 1691 à LaPrairie s’inscrivent dans le contexte des guerres indiennes doublées d’un conflit continuel avec les Treize Colonies. Après avoir subi deux raids français en Nouvelle-Angleterre, les Anglais méditent une revanche. Ainsi le 11 août l’attaque anglo-iroquoise commandée par le Major Peter Schuyler atteint le fort de LaPrairie vers cinq heures du matin. En quelques heures les troupes françaises sont anéanties et les pertes sont très élevées. L’envahisseur, qui sort sans contredit vainqueur du premier engagement, se replie vers Saint-Jean afin de rejoindre ses embarcations. Or pendant que se déroulait ce premier engagement au fort de LaPrairie, les deux cents hommes du capitaine de Valrennes étaient en route pour le fort de Chambly. Après avoir entendu la rumeur de l’engagement, ils font demi-tour et, à mi-chemin entre les deux forts, ils aperçoivent les troupes anglo-iroquoises. Rapidement, les forces françaises gagnent un côteau et bloquent à l’ennemi la route vers Saint-Jean. Les hommes de Schuyler n’ont d’autre choix que d’engager le combat. Après une heure les Anglais subissent un revers : la seconde bataille de LaPrairie prend fin. Le ruisseau dit de la Bataille coule encore timidement près du côteau où eut lieu le second engagement du 11 août 1691.

- Au jour le jour, décembre 1984
Canal de la Rive-sud
Depuis que Jacques-Cartier et Champlain se heurtèrent tour à tour aux eaux tumultueuses du Sault Saint-Louis, ces rapides posèrent pour longtemps un sérieux problème à la navigation intérieure. Il était pourtant impérieux pour le commerce des fourrures et plus tard pour la pénétration des Grands-Lacs de pouvoir franchir les obstacles naturels qui parsèment le Saint-Laurent.
Depuis Dollier de Casson qui, dès 1680, eut le premier l’idée de la construction d’un canal qui relierait le lac Saint-Louis et Montréal, jusqu’aux multiples élargissements que subit le canal de Lachine durant le XIXe siècle; la navigation sur le Saint-Laurent connaissait toujours des difficultés imposées par des flottes de navires de plus en plus imposantes. L’ouverture de la Voie maritime, en avril 1959, marquait donc la réalisation d’un rêve vieux de 400 ans et l’aboutissement de négociations intenses pendant 50 ans entre les gouvernements des États-Unis et du Canada. La mise au point du projet nécessita, entre autres, la création d’un canal artificiel d’environ 32 kilomètres de long qui s’étend du pont Jacques-Cartier jusqu’à l’extrémité ouest du village de Kahnawaké (Caughnawaga). Ce canal a une largeur minimum de 61 mètres lorsqu’il a deux berges, de 91,4 mètres lorsqu’il n’a qu’une berge et de 137,2 mètres sur le parcours libre. Sa profondeur atteint partout 8,2 mètres. Il porte, comme il se doit, le nom de Canal de la Rive-sud, puisqu’il longe la rive sud de l’île de Montréal.

