L’œuvre des religieuses.
Dès 1843, des dames de La Prairie, regroupées en une association appelée les Dames de la Charité, avaient loué un immeuble de pierre sur le chemin de Saint-Jean que l’on appela « Maison de la Providence », où l’une d’elles, Mlle Émilie Denaut, prenait soin des miséreux les plus délaissés.
L’œuvre gagna en importance et dépassa bientôt les capacités d’accueil de Mlle Denaut. C’est alors que le père Tellier s.j. entreprit des démarches pour confier l’hospice aux mains d’une communauté de religieuses.
Au milieu du mois de mai 1846, Émilie Gamelin, fondatrice des Sœurs de la Providence, accompagnée des Sœurs Michon, Marie et Amable, prenait la responsabilité de l’hospice de La Prairie. Elles y trouvèrent six vieilles et trois vieillards, dont l’un était âgé de 96 ans. Le 16 mai, la fondatrice quitta La Prairie, confiant la responsabilité de la nouvelle institution à deux religieuses, dont Sœur Marie (Ursule Leblanc), supérieure de l’hospice.
Les religieuses poursuivirent leur œuvre à La Prairie auprès des personnes âgées durant près de 130 ans, jusqu’à ce qu’en 1974, alors que la Maison de la Providence comptait plus de 90 pensionnaires, le Ministère des Affaires sociales demanda aux religieuses de reloger ailleurs toutes ces personnes âgées. L’ensemble des bâtiments fut ensuite converti en résidence pour les religieuses à la retraite et, jusqu’à leur départ en 1987, plusieurs d’entre elles continuèrent à visiter les malades et les personnes âgées confinées à la maison.
Dans les décennies qui suivirent, les CHSLD prirent en charge les personnes âgées malades ou en perte d’autonomie alors que s’ouvraient de nombreuses résidences capables d’accueillir des aînés autonomes ou semi-autonomes.
Malgré l’apparition de ces nouveaux services, les besoins demeurent énormes, car, comme le démontrent les statistiques suivantes, le nombre des aînés augmentant et bien qu’ils soient en bonne santé, plusieurs se retrouvent seuls à la maison et laissés à eux-mêmes.
Statistiques
Un peu plus d’une personne sur 7 (15,7 %) au Québec est âgée de 65 ans ou plus, soit 1 253 550 personnes. Parmi les personnes âgées de 65 ans ou plus, près du tiers (32,2 %) ont entre 65 et 69 ans. La population de personnes de 65 ans ou plus se compose de 43,9 % d’hommes et de 56,1 % de femmes. Les femmes sont nettement plus nombreuses dans les groupes d’âge plus avancés du fait de leur espérance de vie plus élevée.
À elles seules, les régions de Montréal, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale regroupent plus de la moitié du nombre total de personnes âgées de 65 ans ou plus au Québec.
De 2006 à 2056, la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus parmi la population totale doublera, passant de 14,0 % à 28,0 %. La proportion de la population âgée de 75 ans ou plus par rapport à la population totale du Québec passera de 6,4 % à 16,4 % entre 2006 et 2056.Les aînés du Québec : quelques données récentes, publié par le gouvernement du Québec en 2012.
Selon le recensement de 2016, à La Prairie, les personnes âgées de plus de 65 ans sont 3 500, soit 15 % de la population.
La Maison des aînés
Malgré ces statistiques impressionnantes, outre certains services offerts par les CLSC ou d’autres organismes pour le maintien des aînées à la maison, les autorités gouvernementales n’ont jamais mis en place des services permettant aux aînés non seulement de vivre chez eux, mais également de s’épanouir à travers une vie sociale harmonieuse faite de rencontres, de loisirs, d’apprentissages et du sentiment d’être utile.
À n’en pas douter, il y avait là un énorme besoin à combler et, à La Prairie, cette mission allait être prise en charge par les bénévoles de la Maison des aînés.
La Maison des aînés de La Prairie n’est pas née de façon spontanée en 2005. La fondatrice, madame Céline Desautels, y songeait depuis plus de deux ans. Ses lectures et les nombreuses rencontres effectuées dans le cadre de son travail à la paroisse de la Nativité l’avaient convaincue du besoin pressant d’un tel établissement.
Bien que les lettres patentes de mai 2004 précisent que le conseil d’administration devait être composé de 3 personnes, les règlements internes adoptés dès la première année établirent que le CA accueillerait plutôt 7 membres.
Les membres de ce premier conseil d’administration étaient : Céline Desautels, présidente, Maryse Leblanc, vice-présidente, Jean-Claude Campeau, trésorier, Jeannine Lavallée, secrétaire, Francine Désilets, administratrice, Claire Bernatchez, administratrice et Ève Cholette, également administratrice.
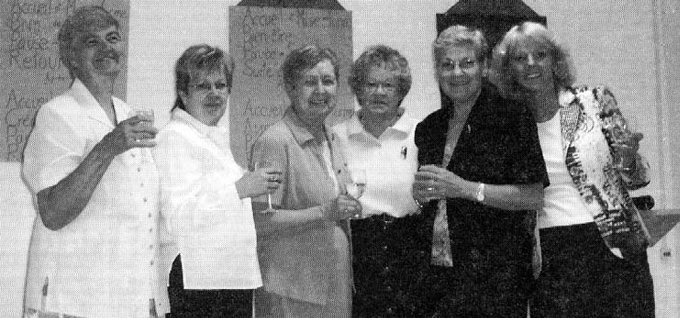
Les sept membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée annuelle en alternance pour un mandat de deux ans. Ainsi, une année, trois membres sont en élection et l’année suivante ce sont les quatre autres membres qui sont soumis au vote des membres.
Déjà, un an avant l’ouverture officielle, les membres du conseil se mirent en quête de financement. Leurs efforts ne furent pas vains, une subvention de 12 000 $ du programme fédéral « Nouveaux Horizons » et un versement de 5 000 $ du député provincial Jean Dubuc permirent de lancer l’organisme sur de solides bases financières.
La Maison des aînés de La Prairie a
donc été créée en 2005 dans le but
de permettre aux personnes de plus
de 50 ans de :
• côtoyer des personnes de leur âge ;
• suivre des cours, des ateliers et diverses formations ;
• assister à des causeries et à des conférences sur divers sujets ;
• se divertir physiquement ou intellectuellement ;
• mais surtout, avoir un endroit où trouver réconfort et amitié.
Évolution des effectifs
2005-2006 – 134 membres
2006-2007 – 217 membres
2007-2008 – 228 membres
2008-2009 – 228 membres
2009-2010 – 257 membres
2010-2011 – 273 membres
2011-2012 – 324 membres
2012-2013 – 235 membres
2013-2014 – 327 membres
2014-2015 – 402 membres
2015-2016 – 422 membres
2016-2017 – 487 membres
Les activités n’ont pas tellement changé, car plusieurs de celles-ci sont les mêmes depuis les débuts : tricot, cours d’anglais et d’espagnol, Viactive (un programme d’activités physiques), musique et mouvement, taï-chi, atelier d’écriture, atelier de théâtre, nutrition, etc.
« On aime ajouter de la nouveauté, mais toujours en respectant notre mission. Les activités sont pensées en respectant la mission du début. La différence, c’est la participation grandissante. C’est cela qui est le plus grand changement, » d’affirmer Mme Jeannine Lavallée, la présidente actuelle.

« Je suis certaine que la MDA est toujours demeurée fidèle à sa mission, car les nouvelles activités sont toujours pensées selon l’esprit de la mission qui est de briser l’isolement, de continuer des apprentissages, d’élargir le cercle d’amis (on forme une famille), et surtout des activités qui permettent de garder notre autonomie physique et intellectuelle le plus longtemps possible. »
Au cours de l’année 2017, les activités les plus fréquentées demeurent Viactive, les causeries, le déjeuner du mois, le service des commissions au IGA, le salon des tricoteuses, les mémoires (les gens écrivent le récit de leur vie) et les cours sur la tablette iPad.

La participation masculine
Le tableau ci-joint permet de constater que bien que les adhésions aient plus que doublé au cours des dix dernières années, le taux de participation des hommes est demeuré à peu près inchangé. Il y a donc lieu de s’interroger sur les causes de la faible participation masculine aux activités offertes par la MDA.
Profil des membres
2005-2006 – 92 % femmes – 8 % hommes
2006-2007 – 78 % femmes – 22 % hommes
2007-2008 – 84 % femmes – 16 % hommes
2008-2009 – 84 % femmes – 16 % hommes
2009-2010 – 88 % femmes – 12 % hommes
2010-2011 – 87 % femmes – 13 % hommes
2011-2012 – 85 % femmes – 15 % hommes
2012-2013 – 87 % femmes – 13 % hommes
2013-2014 – 83 % femmes – 17 % hommes
2014-2015 – 84 % femmes – 16 % hommes
2015-2016 – 83 % femmes – 17 % hommes
2016-2017 – 83 % femmes – 17 % hommes
Il est évident qu’au plan social et personnel, les besoins des hommes diffèrent beaucoup de ceux des femmes.
La présidente de la Maison des aînés constate qu’il est difficile de trouver des activités qui plaisent aux hommes. Le manque d’espace ne permet pas d’installer des tables de billard, des jeux de fléchettes ou des tables de tennis sur table. Les hommes aiment le vélo (souvent plus individuel qu’en groupe) et le golf, et beaucoup préfèrent s’occuper eux-mêmes par des travaux de bricolage.
Ailleurs, l’organisme « Hommes en action (Men’s Sheds) » et d’autres programmes similaires aident les hommes à surmonter certaines barrières qui les empêchent d’améliorer leur santé. Dirigés par leurs membres, ces groupes favorisent le rassemblement d’hommes pour la tenue d’activités telles que le travail du bois, la cuisine, la musique ou le sport à la télévision.
Selon Doug Mackie, si vous voulez faire parler un homme, « asseyez-vous à ses côtés » et travaillez avec lui à un projet. Il a constaté que de nombreux hommes dans son quartier ont beaucoup de temps à leur disposition, surtout s’ils sont à la retraite, et qu’ils souffrent souvent de solitude, d’isolement et de dépression. La fin d’une carrière entraîne souvent une perte d’identité.
Les chercheurs australiens Andrea Walding et Dave Fildes ont constaté que les programmes d’Hommes en action et d’autres programmes communautaires du genre contribuaient à améliorer la santé masculine et le bien-être général des hommes plus âgés. Ils aident également les hommes à développer leurs compétences et leurs réseaux sociaux et leur procurent un espace sûr.Ces informations sont tirées d’un article signé par Shannon Sampert. Directrice d’Evidence Network.ca et professeure agrégée au département de science politique de l’Université de Winnipeg. Cet article est paru dans La Presse, édition du 27 août 2017.
Bref, l’augmentation de l’adhésion masculine demeure pour l’avenir un défi difficile à résoudre pour l’équipe de direction et les bénévoles de la MDA.
Une présence indispensable
Depuis ses débuts, la Maison des aînés a manifestement fait la preuve que son existence répondait à des besoins réels et pressants dans la communauté.
Logée au 604, boulevard Taschereau (l’ancien hôtel de ville construit en 1967), au début, la Maison des aînés ouvrait ses portes trois jours par semaine avec une secrétaire pour voir à la bonne marche du bureau. Après quelques années, les activités sont devenues accessibles cinq jours par semaine.
En janvier 2009, la secrétaire comptable a été remplacée par Mme Caroline Boisvert qui agissait comme coordonnatrice 4 jours/semaine. Puis en 2011, Marie-Herline Jean remplaçait Caroline Boisvert comme coordonnatrice et passait à 5 jours/semaine, alors que Lucie Depault agissait à titre de secrétaire comptable.
Victime de son succès, la MDA se voit contrainte d’augmenter le nombre de ses employés. Plus de participation exige une solide administration et davantage de bénévoles ; ces derniers sont plus de 80 à ce jour.
C’est ainsi qu’en 2013, Marguerite Arseneault est engagée comme directrice à temps plein alors que Ghislaine Bergeron prend en charge la comptabilité et d’autres tâches connexes à raison de deux jours/semaine. Micheline Arbic s’assure des visites dans deux résidences privées de La Prairie, soit la résidence d’Estelle et la résidence Adison.
Installée depuis le printemps dernier dans les tout nouveaux locaux du Centre multifonctionnel Guy-Dupré, la Maison des aînés a visiblement le vent dans les voiles et poursuivra sans doute sa mission durant encore de longues années : briser l’isolement, promouvoir l’autonomie et le mieux-être des personnes âgées ainsi que leur intégration sociale.
Comme l’affirme Mme Lavallée, « il faut sortir les aînés de la maison afin qu’ils puissent mieux y habiter par la suite ».


